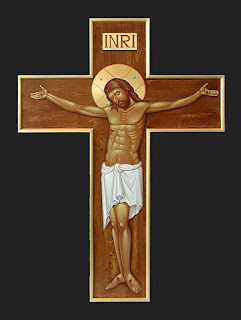Résumé de thèse - Exposé de soutenance (Paris1992)
Résumé de thèse - Exposé de soutenance
« Personne et Liberté, ou l’ « être comme communion »
« Personne et Liberté, ou l’ « être comme communion »
dans l’œuvre
de J. Zizioulas »
I. Résumé de thèse
Dans notre recherche, l'objectif est de repérer une structure théologique,
celle de Jean Zizioulas, les articulations d’une pensée qui pense l’être (identique à la vie) comme
événement de communion: l’être comme Mystère personnel, en Christ ressuscité et face au néant de la mort. Le travail
présent vise donc, d’emblée, l’ensemble de l’œuvre en question, sa structure et
ses équilibres plutôt que tel détail car, il entend offrir ici une piste
méthodologique —telle qu’elle émerge de notre lecture de l’œuvre de
J. Zizioulas— plutôt que mettre en valeur un point particulier ou quelques
thèses parmi celles de ce dernier. Car l’œuvre de notre auteur est déterminée
par une herméneutique théologique plutôt que par une thématique théologique.
Le but du travail n’est pas tellement d’analyser le sens du terme
“personne” (et “liberté” implicite au terme “personne”). Des publications de
l’auteur suffiraient largement. Mais, néanmoins, la thèse est à la recherche
d’un éclaircissement du contenu de la notion de “personne” (et corrélativement
de “liberté”) en ontologie chez J. Zizioulas. Que veut dire exactement “être personne” (personhood) et d’abord à quel
type d’ontologie fait-il référence dans l’œuvre en question ?
La différence entre “individu” et “personne” est bien connue (cf. les
“personnalismes” en philosophie). Une question majeure s’impose à nous. Du
moment que “personne” implique la relationalité, peut-on dire que le terme
connote une “nature relationnelle” ou une “nature extatique”? La “personne”
relèverait-elle de l’ordre du naturel (ferait-elle ultimement,
ontologiquement, référence à la nature) ? Ou bien l’ordre du personnel et l’ordre du naturel représentent-ils deux choses —deux approches de
la réalité ontologique, de l’ “être” lui-même— complétement
différentes (via naturæ, via personæ) ?
Autrement dit, à quoi l’“être” fait-il référence en dernière instance (en
ontologie véritable) en tant qu’hypostase
véritable (όντως υφεστηκώς") : à
l’ordre du naturel (à “nature”) ou bien à l’ordre du personnel (à “personne”)?
Un des buts de la thèse sera de montrer comment l’irréductibilité absolue de l’ordre hypostatique à l’ordre naturel (de
la personne à sa nature) —la non
confusion possible entre “personne hypostatique” [ou “hypostase
personnelle” (comme hypostase et extase simultanément)] et une “nature
extatique-relationnelle” (qui serait naturellement
extatique et relationnelle)— sont respectées et mis en œuvre dans la pensée de
l’auteur. A partir de là, il s'agit de tirer des implications pour un débat
théologique, inter-orthodoxe et inter-ecclésial (cf. “Epilégomènes”).
Dans quel type d’ontologie:
Y-a-t-il une “ontologie chrétienne” et comment (sous quelles conditions)
peut-elle être conçue? A l’être lié à la nécessité, ou à l’être lié à la
liberté?) Quelle est la différence entre “ontologie
philosophique” et “ontologie théologique” (autrement
qu’ “onto-théo-logie”) et qu’est-ce qu’elles comportent (ces deux positions)
pour la systématique ecclésiale (hétéro-interprétation/auto-interprétation du Mystère de Dieu —et de l’homme— en Christ et des déclarations
dogmatiques qui le commentent) ?
L’objectif de la thèse consistant à présenter de manière systématique
l’œuvre en question, ses articulations majeures, par le biais des “personne” et
“liberté” dans l’“événement de communion” personnelle, libre et agapétique, nous
poserons certains problèmes : quel est le champ sémantique de la “personne”,
comment nous l’utilisons en “triadologie” (théologie trinitaire), en
“christologie” et en “anthropologie” et comment s’articulent entre eux les
différents chapitres de la dogmatique —spécialement les articulations générales,
les dialectiques, Théologie-Economie et histoire-eschatologie [comme inclusion enhypostatique (en Christ et
par l’Esprit) —“sans séparation, ni confusion” de manière asymétrique— de
l’Economie à la Théologie] et histoire-eschatologie [comme inclusion enhypostatique (en Christ et par l’Esprit) —“sans séparation,
ni confusion” de manière asymétrique— de l’histoire dans l’eschatologie].
La thèse, qui porte sur la théologie systématique de l’auteur, sur son herméneutique théologique, plus précisément ‘eucharistique’, est structurée
en trois parties qui ont le sens des (1) “Prolégomènes de la Dogmatique”, (2)
“La Dogmatique” et (3) “Epilégomènes à la Dogmatique”. La première partie
correspond au moment de théologie fondamentale; la deuxième au moment de
théologie dogmatique et la troisième concerne les discussions suscitées par la
vision systématique comme par différents points de la dogmatique de l’auteur.
Il doit être mis clairement en relief que, les deux premières parties sont en
interdépendance stricte tandis que la troisième ne l’est qu’indirectement par
les éclaircissements supplémentaires qu’elle apporte éventuellement.
Relevons et pointons que le moment de la “théologie fondamentale” ne
découle pas d’a priori quelconques
extra-dogmatiques mais de la
dogmatique, mieux des dogmes eux-mêmes. Le fondamental et le dogmatique en
théologie s’impliquent mutuellement afin d’éviter le plus possible toute hétéro-interprétation des dogmes.
Serait-il pour autant un cercle herméneutique fermé et replié sur lui-même ?
Nous ne le croyons point. De quel type de non
hétéro--interprétation des dogmes s’agira-t-il alors ? Nous croyons que la réponse
est déjà donnée in nuce dans le type (ou bien/ou bien) de la dialectique
“créé/incréé”, dans une approche extatique, “communionnelle et eucharistique”,
de la Vérité dans l’eucharistie ecclésiale. Le point focal, le “lieu ouvert”
de l’herméneutique et de la systématique de notre auteur est sa vision
communionnelle de l’eucharistie. L’eucharistie “en” Christ en tant que
l’eucharistie “du” Christ est le “lieu de la Vérité”. Cela justifie, nous
semble-t-il, la structure de notre thèse et l’articulation entre les
différentes parties de la systématique de J. Zizioulas.
Le but de la recherche est commandé par un souci méthodologique. Etant donné « la priorité des
présupposés méthodologiques sur les thèses concrètes » d’après notre
auteur, nous chercherons comment la “personne” et sa “liberté” jouent dans sa
construction systématique. D’où et comment elles tirent leur origine, leur
sens, et comment elles sont utilisées dans la cohérence de l’œuvre autour de
ses catégories. Il s’agira d’un
déchiffrement du fonctionnement de la “personne” et de sa “liberté” au sein de
l’œuvre de J. Zizioulas pour y discerner les articulations qu’elles créent.
Il nous semble, en effet, que la
cohérence de l’œuvre dépend de la juste compréhension de ces termes.
Il y a aussi un souci œcuménique. J. Zizioulas lui-même affirme que «les
orthodoxes ont leurs présupposés méthodologiques» à partir desquels les thèses
théologiques doivent être comprises et discutées. Nous serons ici à la
recherche de ces présupposés (éclaircissement et discussion). Mais que veut
dire J. Zizioulas par «présupposés orthodoxes»?
S’agira-t-il des présupposés de la théologie “orthodoxe” tout court (v.
“catholique” et/ou “évangélique” —au sens confessionnel des termes) ou pire,
d’une théologie “orthodoxe” précise, celle de J. Zizioulas? Il n’en est
pas question ici. Il s’agira des présupposés ortho-doxes (= non hétérodoxes) d’une théologie ecclésiale, celle
de l’auteur, et peut-être aussi de toute théologie ecclésiale. C’est le défi
que l’auteur nous lance. Mais avant une acceptation ou un refus de la
“prétention ecclésiale” de l’auteur incluse dans ce défi, il nous faut la
comprendre et percevoir ses enjeux. La thèse pourrait contribuer ainsi à
repenser les catégories ecclésiales
(ni confessionnelles, ni culturelles) de “tradition” et d’ “ortho-doxie” dans
le dialogue interecclésial.
Les présupposés méthodologiques de
notre travail sont commandées par la méthodologie propre à notre auteur
—« la priorité des présupposés méthodologiques [en théologie] sur les
thèses [théologiques] concrètes »— en vue d’un discernement qui sous-tend
les présupposés ortho-doxes (= non
hétérodoxes) d’une théologie ecclésiale. Aussi, qu’en est-il de l’hellénisation
du christianisme et de la christianisation de l’hellénisme
(rapport Hellénisme-Christianisme) ? Qu’en est-il de la méthode herméneutique de la
patristique (en l’occurrence grecque) ?
Structurée autour de l’événement de communion personnelle, l’œuvre de J.
Zizioulas fait appel à une “ontologie relationnelle”, où l’être ne dépend plus
de lui-même et n’implique pas la nécessité de lui-même. Il dépend de la
personne, toujours autre, et implique sa liberté. L’être devient identique à la
liberté de la personne ; à la liberté personnelle comme amour dans la
communion. Chez notre auteur, le moment de “dé-construction” ontologique en
théologie concerne l’ “être en tant que nature” (είναι ως φύσις) ; le
moment de “re-construction”, théologique et ontologique, concerne l’ “être
en tant que communion” (είναι ως κοινωνία). Ce
faisant, J. Zizioulas se meut dans la perspective de la radicalité
apocalyptique du Mystèrion du dernier
Adam, le Christ (μυστήριον του Χριστού). C’est ce
type d’herméneutique et de méthodologie en théologie qui constitue l’apport le
plus original de l’auteur: apport épistémologique et, peut-être aussi ontologique.
Notre auteur, dans l’ensemble de son œuvre, cherche à dégager la vision
ontologique contenue dans la théologie
kérygmatique des pères de l’Eglise (notamment grecs) comme actualisation
existentielle pour l’homme d’aujourd’hui, dans une démarche de non-hétéro-interprétation du Mystèrion. A ce propos, l’être de
l’homme —et, en lui, celui du créé dans son intégralité— est référé à l’être de Dieu dans le cadre d’une vision
apocalyptique de la création en tant que “re-création” en Christ. L’être (είναι), qui dit la vie et la vérité de l’existant
au sens ontologique le plus fort, se dévoile à nous par la catégorie de l’eikôn (εικών): une catégorie
apocalyptique et dialectique qui trouve son “lieu” et son “sens”, ontologiques,
dans l’hypostase éternelle du Christ-Fils (Personne incréée et “personnalité
corporative” à la fois). Car, selon J. Zizioulas, c’est la christologie qui
constitue le seul point de départ
d’une intelligence chrétienne de la vérité et de la vie ; et cela dans la communion.
Cette dialectique de l’icône (hypostatique-apocalyptique) brise le monisme
de l’ “ontologie close” de la pensée hellénique qui relie l’être de Dieu à
celui de la création au sein d’un continuum
cosmologique et/ou mystique. Cela devient possible en considérant
l’arrière-plan d’une nouvelle vision du rapport “Dieu-monde”: ce que l’auteur
appelle “une dialectique ontologiquement absolue (créé/incréé). L’être ainsi
—dans le cadre d’une ontologie non
plus philosophique mais théologique—
est référé en dehors de lui-même (dans la communion personnelle, extatique
et, pour nous, eschatologique). Dans l’expérience liturgique de l’anaphore
eucharistique de l’Eglise, l’être est référé (αναφορά) à l’au-delà du créé,
pour être reçu dans l’action de grâce (ευχαριστία) en tant qu’ “être-identique-à-la-vie”.
C’est ainsi que l’être-vie est désormais expérimenté comme “être-vie-en-communion”
(εν κοινωνία) et comme
“icône de l’eschaton apocalyptique”
de Dieu qui toujours vient en Christ.
Mais cette “communion personnelle” (προσωπική κοινωνία) n’existe
pas par elle-même, ni en elle-même — comme une structure existentielle ou anthropologique:
c’est le Père de Jésus le Christ qui en est la cause personnelle (αίτιος) au niveau
de l’incréé, d’abord et fondamentalement. C’est ainsi que le Fils-Christ, étant
l’image (εικών incréée et
hypostatique de son Père, est la cause personnelle du créé propter nos. La communion se réfère donc à la personne et à sa
liberté (hypostase et extase simultanément,
catégorie comme telle, eschatologique ou plutôt apocalyptique). Comme le
Dieu incréé doit son existence au Père (à une personne concrète et libre qui
hypostasie sa liberté comme amour, par nature), de même la création créé et
l’homme, son centre, doivent leur existence au Fils-Christ (à une personne
concrète et libre qui hypostasie sa liberté comme amour, par grâce, propter nos). Si Dieu existe, non pas
parce qu’Il ne peut qu’exister, mais en
liberté personnelle, par nature à cause du Père, de même le créé doit son
existence véritable, eschatologique au Fils éternel (à la liberté comme amour
du Christ, dernier Adam eschatologique). C’est ainsi que le créé devient
“affranchi” —dans son être créé— en Christ pour exister en liberté personnelle, lui aussi comme Dieu, par grâce. Ainsi
l’être véritable est eschatologiquement donné au créé, ou, si l’on veut, le
Christ eschatologique constitue le
véritable protologique, le fondement ontologique de l’être du créé et le
contenu de sa vie incorruptible. La “liberté comme amour” de
l’ “hypostase-personnelle (ou “personne”) en communion” constitue le
fondement ontologique, personnel et libre, et de Dieu —selon sa nature— à
cause du Père, et du créé — selon la grâce de Dieu— à cause du
Fils-Christ.
Dans cette “re-construction” de J. Zizioulas —qui s’inspire particulièrement
des Cappadociens et de Maxime le Confesseur— l’ “hypostase-personnelle”
(ou tout court, “personne” au sens théologique du terme) est une réalité
incréée par nature, et pour nous, c’est-à-dire par grâce (= en Christ dans
l’Esprit), apocalyptique-eschatologique. Ici, le temps et l’histoire de la
création “ecclésialisée” acquièrent leur réalité véritable dans l’icône apocalyptique
de l’ultime (έσχατον) qu’est la
communauté du Ressuscité dans l’eucharistie. La communauté elle-même devient
dans son “mode d’existence eucharistique” la manifestation (επιφάνεια) iconique
comme communion qui renvoie aux eschata, à la réalité de l’ “ultime” au sens ontologique
et historique le plus fort. Elle devient
un “communier à l’eschaton” (κοινωνία εσχάτων). L’être créé se révèle par et dans la
communauté ecclésiale en tant qu’événement eschatologique de grâce où l’homme
lui-même en Christ a la responsabilité d’être véritablement “le berger de
l’être créé”, le “prêtre de la
création”.
Cette synthèse de notre auteur, bien qu’elle s’enracine profondément dans
cette tradition ecclésiale que l’on appelle l’ “hellénisme chrétien” (G.
Florovsky) —où les questions ontologiques des Grecs passent à travers le
baptême ecclésial—, se meut dans le cadre d’une catholicité œcuménique de
l’Eglise aussi bien de l’Orient que de l’Occident. Son apport théologique principal
consiste, à notre avis, en l’articulation en Christ entre création et
eschatologie, d’une part (articulation de l’Economie trinitaire, en Christ),
comme entre la christologie (constitutivement pneumatologique, et conditionnée
par l’ecclésiologie) et la théologie trinitaire, de l’autre (articulation de
l’Economie trinitaire à la Théologie trinitaire, en Christ). Ces articulations
présupposent une vision —apocalyptique et désindividualisée— de l’événement
Christ, à la fois “Personne” incréée et “personnalité corporative”. Or, c’est
cette vision théologique sur l’assise d’une ontologie ouverte, extatique et
eschatologique, libre de la gnoséologie — “une ontologie relationnelle”, qui
lui permet de se frayer un chemin entre l’approche onto-théo-logique, d’une
part, et phénoménologique de l’autre, en théologie. L’être s’y révèle
réellement comme don et icône (eschatologique) dans l’altérité hypostatique.
Ce ressaisissement —à travers la “dé-construction” et la “re-construction”—
d’une méthodologie théologique, réellement pertinente à son objet du point de vue
épistémologique, permet de recentrer la théologie sur son objet : la
réalité comme don eschatologique dans le mystère de Dieu en Christ ; une
réalité qui, au départ (dans l’incréé) est don libre, de l’altérité des
Personnes en communion. Une telle approche
méthodologique en théologie évite le risque d’une hétéro-interprétation de
son objet : le Dieu en Christ. Mais, en dehors de cela, une telle approche ontologique “via personæ”
pourrait peut-être constituer une “pro-vocation” pour la philosophie et la
question de l’être; question commune et primordiale aussi bien pour le
philosophe que pour le théologien.
L’évaluation de l’œuvre en question serait incomplète si l’on ne tenait en
considération la nouveauté que celle-ci peut constituer pour une théologie
chrétienne des religions ; cela précisement à cause de sa vision christocentrique,
aussi loin que possible d’un “christomonisme” et également d’un
“christoexclusivisme”. Il est vrai que dans notre travail nous n’avons pu que
suggérer une telle perspective. Nous sommes profondément persuadés de l’enjeu
que l’œuvre de notre auteur représente pour une autre approche et une autre
évaluation des religions, à cause de ses présupposés méthodologiques ; et
notamment à cause d’une approche de l’événement Christ, comme réalité
eschatologique par excellence, chez
J. Zizioulas et de sa vision iconique du mystère ecclésial du Christ, à
savoir de l’Eglise. Elles nous permettraient peut-être d’envisager autrement
le rapport “Eglise-Religions”; non plus en tant que rapport de pure extériorité,
ni de récupération totalisante, mais d’inclusion eschatologique et iconique, dans l’altérité de la vocation, selon
le plan de Dieu pour toute l’humanité
“re-créée” en Christ. Dans une telle perspective on pourrait peut-être dire que
les religions “iconisent” elles aussi, d’une certaine manière, le
Christ-Dernier Adam. Dans ce cas, elles se trouveraient enracinées
eschatologiquement en Lui. Mais ce ne sont ici que des hypothèses d’un travail
à venir qui reste à faire...
ΙΙ. Exposé de
soutenance
Le travail présent sur la pensée de J.
Zizioulas, le métropolite de Pergame vise d’emblée une œuvre complexe dans sa structure et ses équilibres,
plutôt que tel détail. Mais dans quel but? En fait, il s’agit de déchiffrer —en
proposant à une discussion— la piste
méthodologique et herméneutique de notre auteur, sous-jacente aux notions
“personne” et “liberté”, à sa vision de l’être de l’étant en tant que
communion. En effet, l’enjeu véritable de son œuvre —nous le croyons fortement—
est déterminée par une herméneutique spécifique (plutôt que
par une thématique par ailleurs
commune) ; une herméneutique qui revêt à nos yeux —pour la théologie ecclésiale
et peut-être tout simplement pour l’ontologie— une importance décisive.
Notre travail —qui procède de façon circulaire
suivant le mouvement de l’œuvre de J. Zizioulas— est structuré en trois parties
qui font suite à un chapitre préliminaire
sur l’homme et l’œuvre. Celles-ci pourraient correspondre aux trois moments
suivants: le moment herméneutique ou les prolégomènes méthodologiques à la
dogmatique (1ère Partie), le moment systématique de la dogmatique (2e Partie)
et finalement le moment d’un discernement critique comme épilégomènes à la
dogmatique (3eme Partie). Dans notre thèse, les deux premières parties doivent
être considérées en interdépendance stricte (de manière circulaire). Par
contre, la troisième partie ne concerne l’œuvre de notre auteur
qu’indirectement (par les éclaircissements supplémentaires qu’elle apporte au
lecteur).
Nous devons avouer —avant de faire une
description sommaire des parties de la thèse— que notre démarche est fondée sur
le principe herméneutique de « la priorité des présupposés
méthodologiques sur les thèses concrètes ». C’est un principe de notre
auteur lui-même. Nous nous sommes donc posés d’emblée en théologie la question
des présupposés herméneutiques de l’être
de l’étant —comme de sa vérité— dans l’optique de la Tradition orthodoxe de
l’Eglise et celà suivant J. Zizioulas. Nous nous sommes interrogés
constamment sur le type de ces
présupposés herméneutiques; ... non à
partir de nos a priori mais à partir
du mode de fonctionnement concret
de la “personne” et de sa “liberté” —qui, avec la “communion” sont les notions
clés— de l’œuvre du métropolite.
Dès lors, il a été question pour nous, d’un
déchiffrement de la structure interne
d’une œuvre dispersée dans quelques livres et de nombreuses publications. Une
telle exploration a été menée avec une double
hypothèse de travail, aujourd’hui pleinement confirmée. A savoir que la cohérence de l’œuvre de J. Zizioulas dépend
de la juste compréhension de ces catégories de base ; et cela non à l’aide de n’importe
quelle démarche herméneutique mais à partir d’une structure herméneutique et d’une
méthodologie précises. Nous nous sommes donc constamment battus avec des
questions telles que : “que veut dire exactement pour notre auteur être personne”, “quel
type de liberté implique-t-elle”, et
tout d’abord à quel type d’ontologie fait-elle référence? Comment l’expression
“être comme communion”, concernant l’être de l’étant, doit-elle être entendue
? Et dans quelle optique et à partir de quel “lieu” herméneutiques ? De quel type d’ontologie s’agit-il
?
C’est pourquoi la première partie de notre thèse est consacrée aux coordonnées herméneutiques et
épistémologiques de notre auteur dans
le cadre de ce qu’on appelle l’hellénisme
chrétien. Nous traitons ici la lecture de la rencontre conflictuelle entre
l’hellénisme et le christianisme du point de vue spécifiquement chrétien selon
notre auteur: à savoir l’identification entre le Christ et la Vérité (Jn 14,
6). Qu’est-ce qu’implique une articulation extatique, ouverte —et non repliée
sur elle-même— entre la Vérité, l’être (de l’étant) et l’histoire? Et comment
une telle articulation non-totalisante est-elle possible? Selon notre auteur,
l’axe de cette articulation est la
Personne-même du Christ Ressuscité ; et le “lieu”
épistémologique est Son expérience lors de l’eucharistie; l’expérience
eucharistique de notre communion à sa Personne comme dépassement de notre
corruptibilité naturelle, dans la participation paradoxale à son
incorruptibilité naturelle. C’est pourquoi la lecture de l’histoire, effectuée
par notre auteur, est communionnelle et iconique en tant qu’elle se situe en
Christ, Voie, Vérité et Vie à partir du “site eucharistique de la théologie”.
C’est cela que notre première partie entend offrir au lecteur: penser le problème herméneutique de
l’identification entre le Christ et la Vérité en réfléchissant sur les différents types de cette
identification. C’est pourquoi nous considérons cette partie comme étant la
base de notre thèse.
Dans le cadre du conflit
“hellénisme-christianisme”, au chapitre 2,
nous explorons en particulier, la problématique concernant la “personne” dans
l’antiquité greco-romaine (“polis” grecque et “societas” romaine); la
“personne” comme masque (et non comme hypostase) de l’être humain, et sa
liberté (ontologiquement suspendue et inhibée). Nous la traitons à partir du
conflit entre deux Weltanschauungen
(hellénisme/bible + christianisme) eu égard précisément au contenu ontologique
de la liberté de la personne. Une telle question —et sa réponse— ne se comprennent
qu’à partir de la transcendance du Dieu biblique ontologiquement libre, qui
s’offre librement en Christ, pour nous. La thématisation de cette opposition
des Weltanschauungen hellénique et
chrétienne est illustrée par notre auteur —à la suite de la patristique grecque
et à partir de l’expérience eucharistique de l’Eglise— dans la “dis-jonction
absolue” (απόλυτος διάζευξις)
“créé/incréé”. Dans le même cadre nous explorons à travers la catégorie
ontologique —et non symbolique— de l’image-icône (εικών),
l’approche eucharistique de la Vérité —qui est le Christ. Cette image-icone est
prise ici dans un sens apocalyptique —insiste J. Zizioulas— et non
platonicien. Il s’agit d’une question immense qui mérite, à nos yeux, une autre
thèse ...
La seconde partie de notre travail se termine
avec le chapitre 3 qui reprend la même
opposition “hellénisme-christianisme” du point de vue de l’hellénisme chrétien
dans le domaine de son épistémologie propre, à l’aide de sa catégorie
d’hypostase-personnelle de l’être : la connaissance, identification et
participation, “en/dans” l’hypostase-personnelle (γνώσις εν προσώπω).
C’est à l’aide de ce déchiffrement
herméneutique —à savoir de l’articulation [enhypostatique et iconique] en
Christ entre Vérité, être et histoire— que nous avons relu (à plusieurs
reprises !) et redigé la deuxième partie de
notre travail ; partie consacrée à une dogmatique ecclésiale comme “théologie
enracinée dans la personne et le mystère de communion”. Cette partie contient
trois chapitres qui en fait n’en représentent que deux : la
« Théologie » (Θεολογία) —chapitre
4— et l’ « Economie » (Οικονομία) —chapitres 5 et 6. L’ensemble, inutile de
le répéter, a sa cohérence à partir de
la liberté agapétique de la personne en
tant qu’être comme communion personnelle.
La “Théologie” —dans le chapitre 4— parle de l’être personnellement trinitaire de Dieu, en Lui-même (c’est-à-dire dans le Père),
compte tenu de son être personnellement trinitaire en Nous (c’est-à-dire en Christ, dans l’Esprit). C’est pourquoi il
s’intitule “la liberté du Père et l’être-vie de Dieu”. Nous sommes ici aux sources
de l’ontologie de la personne (ou plus précisément, de
l’hypostase-personnelle).
Les chapitres 5 et 6 traitent l’ “Economie”
du créé comme sauvé (c’est-à-dire dans son ouverture à la Théologie). Elles la
traitent sous deux angles : du point de vue “protologique” (en Adam) et du
point de vue eschatologique (en Dernier Adam, le Christ). D’où nos titres
respectifs : “la liberté de l’Adam et l’être-néant du créé” (chap. 5) ; “la
liberté du Christ, Dernier Adam, et l’être-vie du créé” (chap. 6). Or, ces deux
angles ne sont ni corrélatifs, ni complémentaires. Le point de vue
historiquement “protologique” de l’être créé (en Adam) est déchiffré à partir
du point de vue historiquement eschatologique et ontologiquement ultime de sa recréation en Christ, Dernier Adam.
Le chapitre
5 traite la “ktisiologie” (κτίσις, κτισιολογία), le créé
comme créature (le monde comme “ktisis”, créée à partir du néant). Il la
traite en conjonction stricte avec l’anthropologie. La notion paradoxale du
néant, ontologiquement absolu, —c’est-à-dire sans aucun rapport à l’être— est
un des point capitaux concernant la “ktisiologie” de J. Zizioulas. A cette
vision paradoxale du néant fait pendant la notion, également paradoxale, de la
liberté personnelle d’Adam, paradoxe de l’ “être créature”. Le sens paradoxal,
aussi bien du “néant” du créé que de la liberté d’Adam, découle en conséquence
de la disjonction absolue “créé/incréé” telle qu’elle est vécue dans
l’eucharistie. De même que pour l’être créé, le néant lui est “naturel” —lui appartient
selon sa nature créée, de même la liberté —en Adam— lui est “gracieuse” (selon
la grâce de l’incréé). Elle lui est donnée selon
la personne du Fils éternel en vue de
la personne incarnée du Fils
éternel, le Christ.
C’est ce que nous contemplons dans la lecture
eschatologique de l’Economie du créé
comme sauvé en Christ, Dernier Adam, tout au long de notre chapitre 6. Ici nous avons le développement
d’une christologie constitutivement conditionnée par la pneumatologie dans ses
implications ecclésiologiques et sotériologiques. Et cela compte tenu de la
dialectique “histoire-eschatologie”, du “déjà là” et du “pas encore”. Une telle
dialectique est fondée, en ecclésiologie —à l’aide de la notion
christo-apocalyptique de l’icône— à
partir de la personne incréée du Christ, comme communion paradoxale (déjà là et pas encore), dans l’eucharistie. C’est cette vision
de la personne —comme hypostase iconique
de l’être de l’étant— qui assure la possibilité d’affirmer avec cohérence —en
sotériologie— le paradoxe du “déjà-là” de l’accomplissement eschatologique du
salut en Christ dans l’histoire, et le “pas-encore” de la Parousie.
Les résultats de la troisième partie (chapitre 7)
ont confirmé notre hypothèse de travail et, en même temps un soupçon: à savoir
que —dans sa contestation ou son acceptation, au sein comme en dehors de la
théologie orthodoxe— l’œuvre de notre auteur est, très souvent partiellement
lue, et donc, à notre avis, source de malentendus.
Ceci exige quelques élucidations qui,
rappelant l’optique générale de notre auteur, situent mieux quelques-uns de ces
malentendus.
1) L’Hellénisme
chrétien est une catégorie forgée d’abord par G. Florovsky, le maître de J.
Zizioulas, et reprise par ce dernier la christianisation
complète de l’hellénisme dans la Tradition ecclésiale des sept Conciles
œcuméniques de l’Eglise ‘indivise’ et des Pères grecs —en particulier, mais non
pas exclusivement. Il s’agit d’une catégorie complexe —à la fois théologique,
ontologique et sotériologique— pour distinguer l’hellénisme de ladite Tradition
de l’“autre hellénisme”. Tout d’abord de l’hellénisme
païen. Ensuite, non seulement de ce qu’A. Harnack appelle l’hellénisation radicale du christianisme
(gnose) mais également de toute forme d’hellénisme
pas complétement christianisé (en regard de la théologie, de la
sotériologie et de l’ontologie). Nous comprenons ainsi que le terme “hellénisme” n’est pas simplement une
catégorie historico-culturelle; il désigne une manière de poser existentiellement
et intellectuellement la question de notre participation à l’être de Dieu (à sa
vérité et à notre salut) en impliquant une vision de l’ensemble de la réalité;
une vision globale, à la fois de l’être de Dieu, du monde et de son salut. Ce
que nous appelons une “vision du monde” dans
le sens le plus large du terme.
2) Le second point à relever est que, dans la
perspective du métropolite de Pergame, le lieu du discernement des “visions du
monde” est l’expérience eucharistique —de
l’être, de Dieu et du salut— dans la communion à la personne du Ressuscité.
C’est à partir de ce “lieu” que l‘hellénisme et le christianisme, l’hellénisme
chrétien et les autres hellénismes, se trouvent opposés. Cette opposition qui
se dit d’abord dans le “créé/incréé” comme disjonction ontologiquement
absolue, ne peut être comprise et justifiée qu’à partir de notre expérience
eucharistique du créé corruptible comme re-créé et vivant en Christ Ressuscité.
C’est ainsi que le couple “Créé/Incréé” fait référence à une ontologie autre en dehors de l’être de l’étant ; non pas
à une distance au sein de l’être de l’étant (une distance infinie à parcourir).
“Créé/incréé” comme disjonction ontologiquement absolue n’a rien à voir avec la
“différence ontologique” être/étants. Nous connaissons Dieu car nous sommes d’abord connus par Lui (en Christ). L’absoluité ontologique de la disjonction
“créé/incréé” veut sauvegarder l’inconvertibilité
absolue de cette proposition à travers une ontologie libre de la gnoséologie. D’où l’opposition entre l’ “ontologie close” (de tout hellénisme, plus
ou moins païen, c’est-à-dire non-christique) et l’ “ontologie extatique” de l’hellénisme chrétien.
Dans la même ligne, et à partir de cette expérience
eucharistique, J. Zizioulas déchiffre la même opposition
hellénisme-christianisme entre l’iconologie
platonicienne et l’iconologie apocalyptique.
L’icône —dans le cadre de la participation ontologique— se réfère non à la
nature mais à l’hypostase personnelle de l’être de l’étant; non à
l’archéologique, l’avant-des-temps mais à l’eschatologique, l’après l’histoire.
Une telle iconologie apocalyptique (mieux mystérique) n’a son origine et son
sens qu’à partir de l’hypostase-personnelle, incréée et eschatologique, du
Christ Ressuscité telle qu’elle est vécue et expérimentée dans l’eucharistie
ecclésiale.
3) Dans l’œuvre de J. Zizioulas, le sens ontologiquement absolu de la disjonction
“créé/incréé” et le sens apocalyptique
de l’iconologie ontologique, nous semblent réunis. Il en va de même pour le
sens ontologiquement absolu du néant et de la liberté eschatologiquement
agapétique. La liberté en question n’est nullement “méta-logique” (au-delà de
l’opposition “liberté/nécessité”), mais proprement incréée et
“méta-historique”. Il s’agit d’une liberté de communion, d’une liberté
identique à l’amour de l’Autre dans l’autrui.
Konstantinos Agoras