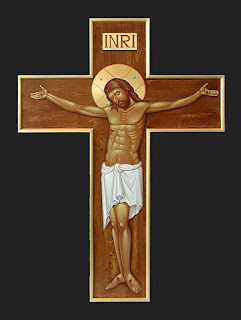Présupposés anthropologiques d'une éthique de la sexualité
XΙΙIe
Colloque de la Chaire Benjamin Edmond
Rotschild pour l'éthique bio-médicale
Ethique,
Reproduction et Sexualité: Actes du Colloque
de la Chaire Benjamin Edmond Rotschild pour l'Éthique bio-médicale, Paris, novembre 1997
Sur les présupposés anthropologiques orthodoxes d'une
éthique de la sexualité
Le
thème de cette année nous invite à une double méditation ; sur le sens de la
sexualité humaine et sur la responsabilité éthique qui incombe à chacun face à
autrui et face à soi-même ; face à soi-même et face à autrui comme
"autres".
La
tâche et la méthode que la « Chaire Benjamin Edmond De Rothschild »
pour l'éthique biomédicale s'est assignée comporte une réflexion commune,
interdisciplinaire lors d'une confrontation dialectique et critique entre la
Tradition et la Modernité mais également entre la Foi et la Science. Je
chercherai donc à me tenir dans l'évaluation critique de l'évolution du
comportement sexuel en Modernité et dans le vécu de la foi chrétienne selon
mon point de vue orthodoxe.
Le
but de l'exposé est de vous offrir quelques réflexions sur les présupposés anthropologiques pour une
éthique de la sexualité dans ses dimensions multiples (la rencontre dialogale
et l'émerveillement, le plaisir et la créativité, la procréation et l'amour).
Et ce en réaction critique à certaines voix chrétiennes qui s'élèvent en
contestation de la libération sexuelle dans nos sociétés contemporaines.
Pourquoi ai-je choisi ce point de vue?
1. Des contestations chrétiennes
et de leurs ambiguïtés théologiques. — Si nous pouvons nous épargner de
prendre en considération les voix de ceux qui approuvent de manière peu
critique (ou même carrément idéologique) la révolution sexuelle, nous ne
pouvons pas faire l'économie d'un dialogue critique
avec les voix de ceux qui, face aux changements de comportement sexuel (au
niveau individuel et social), se situent dans une attitude opposée. Et ce en
n'y discernant que des véritables «attentats à la dignité humaine», telles des
manifestations de notre «culture de mort»[1]. Étant donné le rapport
d'interaction entre le sexuel et le social (chez les individus et les cultures)
qui ne devrait faire mystère pour personne[2], telles appréciations de la
"révolution sexuelle" (et scientifique, par ailleurs) constituent un
jugement négatif sur la Modernité, sur notre actualité.
Dans
l'espace du christianisme historique et pour ne parler ici qu'à titre
d'exemple, une telle appréciation se reflète aussi bien dans les textes
officiels du Magistère catholique romain, que chez nombre d'ecclésiastiques et
de théologiens parmi les Orthodoxes et ne manque pas non plus de chez les
Protestants ... La libération sexuelle en Modernité fait visiblement problème
aux Églises institutionnelles[3]. Mais alors qu'il s'agit à
l'évidence d'un malaise commun et trans-confessionnel dans le christianisme
face à la reconnaissance du plaisir sexuel, il ne caractérise pourtant pas
l'existence ecclésiale des chrétiens dans leur ensemble. Il n'y a pas que la
contestation. Il y a aussi au sein des Églises historiques, ne l'oublions pas,
d'autres voix et d'autres appréciations de ladite révolution et de la
Modernité.
Quelles
sont les raisons profondes d'un tel malaise du christianisme historique face à
l'évolution du comportement sexuel dans la Modernité et à la reconnaissance du
plaisir ? Elles ne sont, me semble-t-il, ni instinctives, ni idéologiques,
mais elles se réfèrent à une perception spirituelle et, surtout, à une représentation théologique de l'homme
sexué —dans sa création et sa chute, sa rédemption et son eschatologie—
spécifiques à l'une des traditions chrétiennes : celle qui a finalement prévalu
en Occident (et s'est infiltré à l'Orient) et qui est vivement critiquée du
point de vue de la psychologie des profondeurs[4].
Le rapport de l'homme à sa propre sexualité
face à soi-même "comme un autre" et face à autrui "comme un
autre" n'est pas simple. Il recèle des problèmes existentiels, spirituels
et éthiques multiples et des risques pratiques considérables, nous en sommes
tous conscients. Mais je soutiens ici —et l'illustrer dépasserait le propos de
ce soir— que sous l'angle spirituel et théologique, les problèmes éthiques ne se situent pas là où d'habitude ils sont situés par certaines voix officielles
dans le christianisme mais plutôt ailleurs ; et que, par conséquent, l'affrontement
des risques pratiques (dans l'épidémie du Sida entre autres) doit être pensé
non pas avec une autre éthique mais autrement
: à l'aide d'une réflexion avec d'autres
présupposés anthropologiques et spirituels, à l'aide d'une éthique
"autre". C'est la raison profonde du choix de mon approche
anthropologique explicitement théologico-spirituelle de la question qui nous
occupe ce soir.
2. Présupposés
herméneutiques. — La conviction préalable à mon exposé
est —pour le dire avec J.M. Pohier— qu'il importe de «reconsidérer la position
générale du christianisme en matière de sexualité», de la «considérer de
nouveau et sans préjuger du résultat de cette considération»[5]. Et cela pour le bien de tout le
monde : pour le bien des non-chrétiens et des non-croyants —lorsque nous leur
compliquons, sinon la vie du moins la perception qu'ils peuvent avoir de notre
propre vision sur la sexualité et la foi dans l'Ultime— aussi bien qu'à nous,
chrétiens, et pour les mêmes raisons. Je suis persuadé —pour parler avec
l'orthodoxe T. Hopko— que
«la question de la sexualité humaine [...] est la
question cruciale de notre temps [...] celle qui sous-tend et affecte la
réflexion contemporaine portant sur tous les grands problèmes : Dieu, le
Christ, l'Esprit, l'Église, les sacrements et la Création elle-même. La réponse
que nous apporterons aux questions relatives à la sexualité humaine sera, à mon
avis, le principal critère de demain pour évaluer l'orthodoxie ou l'hétérodoxie
de notre théologie et de notre vie[6]».
La
question anthropologique et par conséquent éthique de la sexualité (ou plutôt
des sexualités, plurielles, des humains) sera ici abordée d'un point de vue
théologico-spirituel —qui se veut conforme à l'orthodoxie biblique et patristique—
dans le cadre d'un dialogue plus vaste entre Christianisme et Modernité. Il
n'est pas inutile de préciser que, suivant les données de la psychanalyse, je
distinguerai la sexualité proprement
dite en tant que structure
anthropologique, de son expression privilégiée, mais pas unique, qu'est la
génitalité. Sur ce je voudrais faire quelques précisions :
a.
L' "anthropologie sexuelle"[7] —un acquis scientifique au service de l'homme— constitue à mon sens la seule
base commune de tout dialogue critique
entre le Christianisme et la Modernité sur la sexualité. Ce que chacun de nous peut
faire, les croyants notamment, c'est de "recevoir" ou de contester,
mais de manière critique dans tous
les cas, les données de cette anthropologie. Et ce à partir de notre expérience de sens et de vie dans la foi à
l'Ultime et la communion à l'autre.
b.
Je veux parler de la sexualité selon ma double expérience, de la foi chrétienne
et de la sexualité humaine, d'un "point
de vue orthodoxe". C'est en effet dans une telle perspective que j'ai
l'honneur d'être invité à prendre la parole ce soir. Mais, permettez-moi de me
poser devant vous une question, indispensable du point de vue de l'honnêteté
intellectuelle bien qu'assez technique et apocryphe pour les non-initiés, en
vous demandant l'indulgence : que veut dire un "point de vue spécifiquement orthodoxe", comment
le déterminer et sur quelle base ?
La
réponse à cette question ne va pas de soi puisque comme J. Zizioulas —le
métropolite de Pergame et éminent théologien du Patriarcat de Constantinople—
l'exprime fort bien, contrairement aux autres confessions chrétiennes la
Catholicité orthodoxe n'a pas de
sources spéciales pour puiser son
identité confessionnelle : les Orthodoxes n'ont pas d'homologue ni par rapport au Concile Vatican II de la
Catholicité romaine, ni par rapport à la Confession d'Augsbourg du Protestantisme,
ni non plus par rapport aux "39 articles" de l'Anglicanisme ; et ce
qui fait autorité chez eux, à savoir la Bible et les Pères dans la foi, leur
est commun avec le reste des
Confessions chrétiennes. Or, il semble selon l'auteur précité —et je m'associe
pleinement à son avis— que le "point de vue spécifiquement orthodoxe"
n'est pas quelque chose que l'on puise à des sources spéciales, mais que cela
tient à l'interprétation de ces
sources mêmes que les Orthodoxes partagent avec le reste des chrétiens[8].
Parler
d'un "point de vue orthodoxe" implique pour moi parler d'abord à
partir de la "situation culturelle" (et des données scientifiques)
qui est la nôtre aujourd'hui et non pas à partir de celle d'un passé à jamais
révolu ; mais aussi parler dans la même
attitude existentielle du point de vue de l'expérience croyante, que
l'attitude des Pères lorsqu'ils assumaient la culture et les données
scientifiques qui étaient les leurs à la lumière de la foi à l'Ultime ; et
lorsqu'ils manifestaient cette assomption
critique de la culture (et de ses données) par leurs affirmations croyantes
et leurs options éthiques. Les nôtres, si vraiment elles se veulent orthodoxes,
se doivent d'être "homologues" aux leurs, correspondant à la même attitude
de foi face aux nouvelles données. Le
rapport entre notre "situation" culturelle et notre attitude
dans la foi se doit d'être égal au
rapport entre la "situation" culturelle des Apôtres et des Pères et
leur attitude dans la foi en l'Ultime. Attitude, la nôtre, qui devrait
s'exprimer à travers des assertions nullement identiques et répétitives, mais autres et nouvelles, bien qu' "homologues" dans la même existence croyante, c.à.d. dans la même foi (ομολογία πίστεως). "Non nova Sed novæ" selon l'ancien adage. Du point de vue orthodoxe, une
fidélité libre et créatrice à l'expérience croyante des Apôtres et des Pères
implique la continuité selon leur esprit à travers (et non malgré) la discontinuité selon leur lettre, en
ouverture au futur de l'homme avec
Dieu en Christ.
3. Questions capitales. — Toute anthropologie, selon
l'acquis des sciences ou selon la foi en l'Ultime, implique une certaine
perception de ce qui constitue l'humanité
des humains. L'anthropologie scientifique considère l'humanité selon l'actualité historique de l'homme et la
théologique, selon son but ultime. Je
considère à raison ou à tort à la suite de ce que je crois être la méthodologie
patristique, que les deux approches de l'humanité de l'homme loin de
s'exclure, elles se trouvent entre elles dans un rapport dialectique permanent
de manière asymétrique : la vision de
l'humanité de l'homme selon l'Ultime conditionne la perception de cette
humanité selon l'actualité humaine.
Ceci
étant dit, une vision de la sexualité humaine du point de vue orthodoxe se
doit d'être, me semble-t-il, à la fois conforme aux observations scientifiques en regard de la "nature" humaine, en regard du fonctionnement de l'humanité de l'homme en chacun des
hommes et des femmes, concrètement, telle qu'elle se révèle progressivement à
nous par les sciences. Je fais référence à une "nature" qui n'existe
que concrètement et comme "contenu" de toute particularité
existante, à une "humanité"
d'homme qui ne désigne pas une abstraction de l'esprit (objectivée en
elle-même de manière métaphysique) mais le contenu
de tout être humain.
Mais
conforme aussi à ce qui relève de l'eschaton,
à la vocation
personnelle comme but
ultime de chacun de nous, homme ou femme, telle qu'elle se révèle en
Christ "une fois pour toutes" (εφάπαξ) et constamment (εις τέλος), dans l'expérience
croyante : être aux yeux de Dieu un alter
Christus de manière unique. Je me
réfère ici à une vision de foi dans
l'"être personnel" de l'homme, créé précisément en vue de l'Ultime
en tant que "personnel"; créé "selon
l'image" (εικών)[9] —et vers la "ressemblance" (ομοίωσις) précisent les Pères— de l'
"être personnel" du Créateur.
Cette
"personnéité", qui caractérise partant l'être de Dieu et successivement
celui de l'homme, se dit en termes d'unicité
et d'altérité, de transcendance et de liberté dans la relation gratuite à l'autre et la liberté envers soi-même. Il
s'agit d'un être en tant qu'unicité libre
(de manière transcendante et autre) dans la
relation même (et non malgré cette relation) à l'autre unique et libre qui appartient proprement à Dieu en
lui-même (selon sa nature), et caractérise après coup l'homme dans sa communion
avec Dieu (selon sa vocation). Je reviendrai constamment tout au long de mon
exposé sur tous ces points qui me semblent importants du point de vue
patristique.
4. Donnés scientifiques et
expérience croyante — Le point concernant l'articulation pertinente entre
les données scientifiques et l'expérience de la foi dans la communion à
l'Ultime me semble assez délicat à propos d'une vision anthropologique
cohérente et d'une éthique de la sexualité humaine du point de vue chrétien.
Il
y a, me semble-t-il, une continuité profonde en éthique de la sexualité entre
la perception scientifique et la vision croyante — et ce malgré la spécificité
de la foi en son ordre propre (qu'est l'Ultime) comme de la science au sien
(qu'est l'actuel). Continuité due à la bonté foncière, malgré tout, de la
Création (Gen. 1,31), au non-réitérable,
malgré nos infidélités constantes, de la promesse constamment (re)créatrice du Très-Haut. La
"nature" est dynamique et elle se situe dans (en se laissant
percevoir à travers) la promesse créatrice selon l'Ultime de Dieu. Comme telle
elle peut et elle doit nous enseigner, à travers les sciences, sur les
fonctionnements de la sexualité de l'homme. Loin de m'opposer à l'utilisation
de la "nature" (et de la "loi naturelle") en éthique
chrétienne, biomédicale notamment, je plaiderais pour sa prise en charge par
les chrétiens dans une attitude à la fois critique
et prophétique ; lors d'un
discernement dans l'Esprit des eschata
(έσχατα) du "sens ultime", "personnel",
de la "nature" humaine psycho-biologiquement sexuée ; de cette "nature" ou humanité des humains quelle qu'elle soit, progressivement dévoilée
à nous par le biais des sciences. C'est à ce propos que les remarques de J-M
Pohier du point de vue de la référence à la "nature" —référence
traditionnelle dans la théologie catholique, mais aussi patristique
ajouterais-je de ma part— et des malentendus quant à une telle référence, me
semblent fort pertinentes.
«Cette référence à la nature, et le concept de loi
naturelle qui en résulte, auraient sans doute suscité moins d'équivoques si
l'on n'avait pas trop souvent oublié que cette nature, et par conséquent la
façon dont elle peut fonder une loi, ne pouvait être connue que par l'observation de ce que S.
Thomas appelait les "naturales
inclinationes". Elle n'est donc point le résultat d'une déduction à partir des principes métaphysiques ou autres,
mais au contraire celui d'une induction
à partir des faits qui manifestent l'existence et l'orientation de ces
tendances. [...] Contrairement aux apparences, la fidélité à ce traditionnel
recours de la morale catholique à la nature ne consiste point à récuser les
faits ainsi découverts au nom d'une lecture, si vénérable soit-elle, dont les inductions auraient été
transformées en principes, mais au contraire à prendre ces faits comme ce
qui seul peut nous apprendre ce
qu'est la "nature"»[10].
5. La sexualité humaine à la
lumière de la "personnéité" de l'homme. — Ayant ainsi plaidé en faveur de
la continité profonde de la vision de l'humanité de
l'homme en son but ultime (dans la
foi, l'espérance et la charité) avec cette même humanité telle qu'elle nous est
constamment et progressivement dévoilée et perçue d'après les données actuelles de la science, je dois
m'expliquer sur la spécificité de la
vision "personnelle", dans le sens orthodoxe du terme, de la nature
humaine.
La
Catholicité orthodoxe situe l'identité et le contenu, ultimes et donc originels,
de l'humanité de l'homme dans sa « personnéité », dans son
« être- personne ». Elle décèle dans la profondeur de chaque
être humain une "personne" (identité relationnelle) unique et non-réitérable, irréductible et
transcendante c.à.d. libre en elle-même et par rapport à elle-même ; une
identité unique faite "à l'image" —projet divin en vue de la
ressemblance— du Très-Haut tel qu'il est en Lui-même en s'offrant constamment à
nous dans son Christ.
Lorsque
je parle de la "personnéité" de l'homme créé "à l'image et vers
la ressemblance divine" je fais allusion à sa liberté d'autodétermination
—à sa capacité de transcender les limitations que sa nature créée lui impose
(en tant que créée, donnée)— et à sa capacité de relationalité libre. Et ce
dans le sens d'une double orientation dynamique de direction et d'ouverture à
l' "Ultime" et à l' "Autre" au sens vocationnel et
ontologique des termes ; à Dieu incréé dans son Royaume —au Créateur et Sauveur
qui constitue dans son Royaume le but absolu et transcendant de la plus-value
de l'existence, de l'humanisation dynamique de l'homme— à autrui et au monde
(dans le même Royaume).
Chaque
être humain en tant que "personne", dans le sens spécifique précédemment
évoqué du terme, constitue une unique "icône" du Dieu Unique, une
unique identité relationnelle autre et libre en tant qu'expression finie de son
infinité auto-exprimée[11]. C'est cette
"personnéité" que l'homme reçoit en fondement vocationnel comme
"projet unique" à devenir ce qu'il est : une identité non-réitérable
et irréductible à l'intérieur même de l'espèce (du sexe, de la race etc.) à
laquelle elle appartient.
C'est
sous l'angle d'une telle "personnéité" transcendante et libre que
nous pouvons constituer en Christianisme un sens "en vérité" et une
éthique "autre" pour la sexualité humaine. Et ce compte tenu des
découvertes scientifiques les plus récentes (en matière de psychologie, de
biologie, de génétique, de sociologie ...) éclairées quant à l'ultime du
"sens" par le récit biblique des origines ("mâle et femelle il
les créa", Gen. 1,27 dans sa relecture en Christ
ressuscité "il n'y a pas d'homme et de femme, car tous vous êtres un en
Christ Jésus", Gal. 3,28).
De
mon point de vue, je me sens obligé de recevoir la vision de la sexualité selon
l'actualité historique de l'homme à la lumière de son but ultime tel qu'il est
vécu et attendu en Christ. Ce faisant je considère l'identité de chaque être
humain, non seulement selon sa différentiation
sexuelle (au niveau de l'actualité historique) mais encore plus
profondément: selon son unicité vocationnelle
qui lui constitue à proprement parler l'unicité
autre, personnelle (au niveau de son but ultime). Le sens profond de la différentiation sexuelle de chaque homme ou
femme du monde que relève de l'actualité humaine se doit d'être compris sous l'angle de l'unicité vocationnelle
et ultime qui constitue l'identité proprement personnelle des humains. En tout
homme ou femme, le sens profond,
prophétique et ultime de sa différentiation sexuelle et de sa sexualité
dans ses expressions multiples ne pourrait être ni constitué ni perçu qu'à
partir de son unicité vocationnelle selon l'Ultime qui est proprement
personnelle. Ceci me semble fondamental pour une compréhension renouvelée de la
différence sexuelle et des rapports entre les sexes comme pour une éthique
"autre" des comportements sexuels.
Je
parlais tout-à-l'heure de la constitution
sexuelle (au niveau psycho-biologique et selon l'actuel) de l'être humain
en référence à l'anthropologie sexuelle
des Sciences en continuité avec (et distinguée de) sa constitution personnelle (au niveau vocationnel et
selon l'eschaton) en référence à anthropologie christique spécifiquement
"personnelle". Je persiste à plaider pour le déchiffrage de la première
dans l'horizon et la perspective de la deuxième en vue d'un discernement
chrétien du sens de toute sexualité humaine à
la lumière de l'Ultime. C'est lors d'un tel déchiffrage que «l'autre passe
avant l'autre sexe», pour le dire avec D. Singles que je cite.
«Ainsi considérée, la différence sexuelle n'est pas totalisante.
Elle est seconde par rapport à une altérité plus profonde de l'être humain, à
savoir la non-coïncidence avec sa propre origine. [...] La première différence
entre les êtres humains n'est pas le sexe, mais une originalité qui n'est
pourtant pas la création propre de chacun. La différence de chacun est,
d'abord, une relation avec l'autre avant d'être une relation avec l'autre
sexuel». [...] Ce qui est propre ou spécifique à un être humain ne relève pas
d'abord à l'anatomie [psycho-biologique], mais à la liberté. Tout le reste est
second par rapport à celle-ci, propos du désir et non du subir. La véritable
différence est un projet en devenir»[12].
6. Pour une éthique chrétienne de
la sexualité, du plaisir et de l'amour. — Le propre de cette vision des
humains en tant que "personnels" est de porter témoignage, me
semble-t-il, au "projet unique en devenir" du Très-Haut pour chaque
homme et chaque femme de tous les temps. Ce "projet" ontologique de
Dieu constitue pour nous une référence éthique : la vocation propre à chacun de découvrir et de vivre dans un sens
authentiquement personnel notre constitution sexuelle quelle qu'elle soit et
avec tout ce qu'elle implique. Cet appel personnel du Très-Haut à tout être humain concrètement sexué (dans
sa situation existentielle et son histoire absolument uniques) est prophétique selon l'eschaton "en faveur" de chacun de nous.
Chacun de nous, homme ou femme, c'est du Créateur qu'il reçoit sa sexualité
dans ses dimensions multiples (la rencontre, la procréation, le plaisir, la
créativité... ) en tant que bonne et
belle. Et ce malgré son ambiguïté actuelle, due à notre ambivalence
existentielle, tiraillés comme nous le sommes entre le salut et les chutes,
entre le Ressuscité et le néant. Nous la recevons à la fois comme don (à
l'origine) et comme vocation (pour la fin), comme un "don vocationnel",
commun à tous et personnellement diversifié.
Si,
comme je le pense du point de vue orthodoxe, la vocation constitutive pour les
humains d'être à l'image de Dieu et en vue de sa ressemblance à Lui en Christ
consiste dans l'affirmation de la
"transcendance" de la "personnéité" humaine ; si cet
"être à l'image de Dieu" a un sens
global et inclusif ne se limitant point à l'une des multiples dimensions de
l'homme concrètement existant (dimension corporelle, spirituelle, psychique,
affective etc.); alors cette vocation
doit également imprégner notre sexualité en ses expressions multiples. C'est là
où je situe l'appel de Dieu à tout homme
ou femme à assumer réellement, profondément, et à gérer de manière responsable
et libre, dans le respect de soi-même et de l'autre, sa propre sexualité ; en
vue de sa personnification dynamique et
constante, dans la joie et l'émerveillement que toute rencontre authentique
comporte, lors du partage du plaisir et de l'amour.
Mais
pour ce faire une purification de nos
désirs serait indispensable ; une purification qui ne concernerait pas les
objets comme tels de nos désirs ni les "lieux" de nos plaisirs, une
purification qui ne serait pas vécue comme refoulement mais bien plutôt comme transfiguration du désir et du plaisir
sexuels. Que veut signifier dans ce contexte le terme de transfiguration ? Il
signifie non pas la suppression des objets du désir (dans leur refoulement), ni
l'abstention du plaisir, mais l'inversion
de perspective lors de notre référence (non refoulée) à ces objets lors de
la rencontre interpersonnelle et du partage du plaisir sexuel. L'autre ainsi
que nous-mêmes nous sommes uniques et libres d'une liberté transcendante.
Il serait bien que nos désirs de possession
en sexualité puissent se changer en plaisirs de donation dans l'émerveillement face à l'autre, la reconnaissance de
nos unicités respectives, le partage du plaisir et la joie de la rencontre.
C'est
cette vocation personnellement diversifiée et unique en chacun de nous qui
devrait délimiter, à mon sentiment, la perspective chrétienne d'une éthique
"autre" de la sexualité et du plaisir, dans nos amours humains. Afin
que ceux-ci puissent entrer, finalement et à jamais —malgré leur finitude de créés et notre ambivalence
existentielle post peccatum— dans l'éternité de Dieu à la lumière de son
Royaume.
[12] D. Singles, "La différence, destin ou projet ?", dans Lumière et Vie n° 194 (novembre 1989), p. 68, 70.
[3] Cf. J. M. Pohier, "Le
plaisir pose un problème original au christianisme", dans Concilium 100 (déc. 1974), p. 121-130.
[4] Cf. J. M. Pohier, Au nom du Père. Recherches théologiques et
psychanalytiques, Paris 1972 ; M. Bellet, Le Dieu pervers, Paris 1987.
[6] T. Hopko, "Les problèmes que pose aux orthodoxes la «Réception» du
«B.E.M.» (Faith & Order, W.C.C.)", dans Contacts n° 132 (1985/4), p. 314 (souligné par nous).
[8] Cf. J. Zizioulas, "Le
Mystère de l'Église dans le tradition orthodoxe", dans Irénikon t. 60/3 (1987/3), p. 323. D'où
il s'ensuit que, lors de nos exposés et de nos débats, «la chose importante est
toujours les présupposés théologiques
et non pas les thèses concrètes». Présupposés qui, par ailleurs, «suggèrent
aussi une certaine problématique et une certaine méthode qui ne sont pas
toujours familières aux non Orthodoxes» (ibid.
p. 323).
[9] Le "selon l'image" ne connote pas quelque chose (appartenant en propre à Dieu) mais le mode d'être propre de Dieu.
[11] K. Ware,
"«A l'image et à la ressemblance». La caractéristique unique de la
personne humaine", S.O.P. -
Supplément n° 199 (juin 1995), p. 2.
[12] D. Singles, "La différence, destin ou projet ?", dans Lumière et Vie n° 194 (novembre 1989), p. 68, 70.