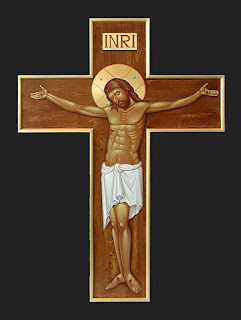Le ministère de l'épiskopè dans le mystère de l'Église

Session oecuménique à Viviers
(4 - 7 mai 2004)
Le ministère de l'épiskopè dans le mystère de l'Église
en vue de la plénitude du Royaume
Dr. Konstantinos Agoras
Parler du point de vue orthodoxe dans un contexte
œcuménique sur le ministère de l'épiskopè dans nos Eglises, sur son essence et
sa signification, est une tâche non aisée pour quelqu’un qui ne se considère
pas comme un spécialiste en matière d'ecclésiologie. Aussi je voudrais
n’exprimer ici que quelques modestes réflexions sur cette question, précédées
d’une introduction sur mes présupposés herméneutiques. Je dois donc
m’interroger au préalable sur le contenu de l’expression un point
de vue orthodoxe (1) avant d’aborder le mystère de l’Eglise dans
l’économie trinitaire (2), contexte immédiat de notre sujet, à savoir
du ministère de l’épiskopè dans le Mystère de l’Eglise (3).
Enfin je me permettrai de conclure avec quelques modestes propos sur les retombées
existentielles de l’approche exposée en rapport avec notre vocation œcuménique commune
(4).
1. approche orthodoxe et catholicité ecclésiale
Quel est le contenu de l’expression un point
de vue orthodoxe ? C’est me semble-t-il en rapport à la "catholicité
orthodoxe", terme qui fait référence à la Tradition de la grande
Eglise du premier millénaire, celle de
l’ « Eglise indivise », apostolique et conciliaire
notamment, matrice et mesure commune pour nous tous[i]. Ainsi que le terme l’indique,
la "catholicité orthodoxe" est distincte de
la "catholicité romaine" laquelle représente
une manière différente de vivre et de penser la catholicité,
le « mode d’être », de l’Eglise. Evidemment, je n’aborderai pas ici
la question, fondamentale à plus d’un titre, de la compatibilité éventuelle de
ces deux « modes » (tropoi) de « catholicité »
ecclésiale – de son degré et de ses présupposés.
L’approche orthodoxe, faisant référence à
l’« Eglise indivise », nous oblige à un dialogue complexe, non
seulement synchronique mais aussi diachronique :
dialogue ad intra (parmi les orthodoxes) et
simultanément ad extra avec chacune des confessions
chrétiennes d’aujourd’hui (catholique, protestantes, anglicane etc.). Et ce,
non pas directement (en face-à-face), mais par le biais de l’Eglise patristique
et conciliaire du premier millénaire, notre matrice et mesure commune. De ce
fait, en œcuménisme, lors d’un face-à-face avec les autres dénominations
chrétiennes, l’orthodoxie ne veut pas témoigner d’elle-même (de manière
confessionnelle) mais bien plutôt de la foi de l’Eglise « indivise »
—à travers certes sa manière spécifique (orthodoxe) de vivre et de penser la
« catholicité » ecclésiale— par rapport à laquelle
elle se mesure et doit se mesurer constamment, elle d’abord, avant les autres.
Pour illustrer cela je reprends ici les paroles de Jean Zizioulas, métropolite
de Pergame et œcuméniste orthodoxe de renommé internationale, dont je partage
entièrement la vision :
« Chaque
fois que sur un sujet je dois parler du "point de vue orthodoxe"
je me trouve en grande difficulté. Qu’est-ce que le "point de vue
orthodoxe" ? Comment le déterminer ? Sur quelles bases et à
partir de quelles sources ? Les orthodoxes n’ont pas de Vatican II où
puiser. Ils n’ont pas leur Confession d’Augsbourg et ils manquent de
l’équivalent d’un Luther ou d’un Calvin pour leur donner leur identité
confessionnelle. Les seules sources qu’ils possèdent en fait d’autorité leur
sont communes avec le reste des chrétiens : la Bible et les Pères. Comment
peut-on déterminer une position qui soit spécifiquement orthodoxe
sur la base de ce qui est commun avec les non orthodoxes ?
Il semble que le point de vue spécifiquement orthodoxe
—je continue la citation— n’est pas quelque chose que l’on puise à des sources
spéciales, mais tient à l’interprétation des sources qu’ils partagent avec le
reste des chrétiens. Les orthodoxes diffèrent des catholiques romains et des
protestants en ce qu’ils abordent des sujets comme celui de l’Eglise sous un
angle qui est typiquement caractéristique de leur mentalité. Ils ont leurs
propres présupposés théologiques qui suggèrent aussi une
certaine problématique et une certaine méthode qui ne sont pas toujours
familières aux non orthodoxes ». Et l’auteur, de conclure en ces termes :
« Quand, à l’intérieur du débat œcuménique, on en vient au dialogue entre
orthodoxes et non orthodoxes la chose importante est toujours les présupposés
théologiques et non les thèses concrètes »[ii].
Dans une perspective orthodoxe, traiter du ministère
de l’épiskopè dans l’Eglise nous oblige à aller au-delà de la simple
« ecclésiologie » au sens technique du terme (un des chapitres ou
sous divisions traditionnels de la dogmatique) et à orienter notre regard sur
le mystère même de l’Eglise dans sa profondeur. Du point de vue de la catholicité orthodoxe,
le ministère de l'épiskopè doit être abordé dans le mystère de
l'Eglise et à partir de ce mystère. Mais, à son tour, le mystère de l’Eglise ne
pourrait être déchiffré que dans la profondeur infinie de l’économie divine
—économie trinitaire pour être plus précis— et à partir de ce
grand mystère de notre salut dans son ensemble : de la
création des créatures créées à partir du néant … jusqu’à leur accomplissement
ultime dans la résurrection au Royaume de Dieu, le but ultime (eschaton)
de toute créature selon la visée (skopos) de leur Créateur incréé. Pour
la conscience orthodoxe donc, le ministère de l’épiskopè dans son essence se trouve
en rapport étroit et indissociable avec le mystère même du salut, l’économie de
Dieu pour nous dans son ensemble. Telle affirmation peut sembler
paradoxale à première vue.
Comme tout ministère ecclésial le ministère de
l’épiskopè ne s'origine et ne renvoie (ou plutôt ne pourrait que renvoyer)
nulle part ailleurs qu'à l'être même de l'Eglise, à son identité la plus
profonde, au mystère du salut au sens large du terme, à l’ensemble de
l’économie trinitaire. Dans ce mystère trinitaire de l’économie en Christ
« pneumatique » —et à partir de ce mystère— le "ministère"
ecclésial de l’épiskopè et le "mystère" eucharistique de l'Eglise
constituent, comme nous le verrons, des réalités indissociables. Cela fait que
l’essence même —et donc la justification théologique du ministère de
l’épiskopè— n’est que sotériologique. Car tout ministère et tout
charisme ecclésial dans l’histoire n’existe véritablement, dans son essence
profonde et sa raison d’être au sens fort du terme, qu’en fonction du mystère
même de l’Eglise : et ce —du point de vue orthodoxe— dans une
perspective eschatologique, « typologique » (typos,
eikon de l’eschaton, l’ultime).
Afin de discerner comment ce ministère de l’épiskopè
se réfère à la profondeur ultime du mystère du salut au sens le plus large du
terme, à la récapitulation de toute chose en Christ ressuscité lors de sa
Parousie, je me permettrai de rappeler ici quelques points essentiels sur le
sens de ce mystère qui constitue l’identité profonde et souvent occultée… de
l’Eglise.
2. économie trinitaire et mystère ecclésial
a. L'Église est une réalité
qui tire son origine de Dieu lui-même, ne l'oublions pas. Car elle découle de
la volonté la plus profonde, la plus intime du Père —laquelle
est commune aux deux autres personnes de la Sainte Trinité— et se réalise au
sein de l'économie de Dieu en Christ qui se fonde, elle aussi,
sur les trois personnes de la Sainte Trinité en tant justement
qu'économie trinitaire. Suivant cette approche
onto-sotériologique résolument christique de l'économie — qui reflète celle de
la théologie, approche chère aux Pères grecs notamment[iii]— nous ne pourrions
jamais traiter de l'être véritable de l'Église sans nous référer à Dieu dont
l'existence est trinitaire : à ce Dieu biblique —le Père du Christ (et
le nôtre en Christ) dans l'Esprit— dont l'identité propre, trinitaire,
subsistant éternellement selon sa nature, se révèle à nous dans l'histoire
selon sa grâce. De façon générale, dès lors qu'il est question d'économie
trinitaire, tout tire son origine du Père et tout s'en retourne pour finir au
Père. Au sein de Dieu trinitaire, celui qui donne origine à tout et qui en
exprime le désir, c'est le Père. Et le Père "a voulu" l'Église[iv].
C’est le Père qui "de toute
éternité" a voulu, ou plutôt veut constamment, unir le "créé"
avec l' "incréé", c'est-à-dire avec Lui-même, le Créateur
unique en personne de "tous les mondes
visibles et invisibles", créés uniques précisément dans son Fils unique et
selon sa grâce : unir donc en Lui-même sa Création,
créée en dehors de lui-même (dans le néant) et située face
à lui-même (comme autre que Lui) selon sa propre nature, la
nature créée. Par conséquent, l'initiative personnelle pour
que l'Église soit —et ce en tant que le lieu et le sacrement dans l'histoire de
cette union du créé à l'incréé— est bien l'initiative du Père, du Père trinitaire.
Cette perspective foncièrement "trinitaire" de l’ "être
Dieu", de la divinité si l’on veut de Dieu, implique que le Fils et
l'Esprit contribuent personnellement, chacun de façon
propre et in solidum (en communion avec) le Père, à
la réalisation du Dessein paternel. Comme en théologie (dans l’existence de
Dieu en Lui-même, en amont de ses œuvres), la perspective de
l'économie de Dieu (dans son Dessein prééternel et la réalisation de celui-ci
dans le temps) est foncièrement trinitaire ; mais en rappelant
cela il ne faut jamais perdre de vue cette subtile distinction quant à l'initiative et
à la fin du Dessein trinitaire de Dieu : initiative
(comme fondement) et fin (comme but ultime) qui relèvent, personnellement et in
solidum, du désir et de l'action de l'unique Père, du Père du
Christ "en personne".
Pour ce qui est du Fils, sa contribution
propre consiste en ceci : en premier lieu consentir librement à
la volonté propre de l'unique Père, à ce désir personnel d'incorporation du
créé et, secondement, devenir le foyer, le centre à partir duquel
pourra se réaliser cette union du créé au Père, cette incorporation "sans
séparation ni confusion" du créé avec l'incréé[v]. Ainsi l'être même, la stabilité
éternelle et le sens ultime de la Création ne dépendent en dernier ressort que
du recours au Père : mais cela dans le Fils, l'unique, en
Esprit.
L'Esprit Saint contribue lui aussi personnellement à
la réalisation du désir prééternel du Père : rendre possible cette
incorporation de la Création dans le Fils en offrant par sa présence la
possibilité au créé d'être ontologiquement ouvert, de s'ouvrir à
l’incréé de Dieu de telle sorte que son incorporation dans le Fils puisse
devenir effective. Car la Création, créée à partir du néant et en
dehors de Dieu, ne peut pas à elle seule (selon sa nature)
s'unir avec le Dieu incréé, s'incorporer à Lui ; et ce à cause de la
limitation naturelle propre à toute nature créée, comme
telle, et non pas, soit dit en passant, à cause de la seule chute (laquelle
s'oppose à Dieu en interdisant l'incorporation)[vi]. Bref, l'Esprit Saint, l'unique
Esprit (du Père) collabore ainsi avec le Fils unique (du Père) afin que l'union
de la Création au Père unique devienne possible, afin que le
créé s'incorpore en Esprit dans le Fils (et
non dans l'Esprit) au Père[vii]. Par conséquent, le Saint-Esprit
n'est pas celui "en qui" la Création s'unit, s'incorpore à Dieu (ni
par ailleurs le Père). Cela revient en particulier au Fils unique qui, bien
entendu, n'agit jamais sans la présence du Père et de l'Esprit Saint. Selon sa
particularité personnelle en son être incréé, l'agir du Fils n'est pas
indépendant mais en communion avec l’agir des autres personnes
trinitaires (ce qui par ailleurs est valable pour chacune des personnes de
Dieu incréé en sa particularité hypostatique, personnelle-trinitaire). Il nous
faut bien faire attention me semble-t-il à ne jamais perdre de vue ce
sens relationnel-trinitaire des personnes ; des
"personnes" proprement dites et incréées en Dieu.
L'Église —et le ministère de son épiskopè— s'inscrit à
l'intérieur de ce plan personnel-trinitaire de Dieu d'après lequel le Père est
celui qui veut, le Fils celui qui offre sa personne,
qui s'offre "en personne", pour incorporer la Création et la mettre
ainsi en relation avec Dieu le Père, et l'Esprit celui qui libère la
Création des frontières et des limitations naturelles du créé en tant
que tel. Cette ouverture infinie et cette incorporation "sans
séparation ni confusion" du créé à l'incréé deviennent possibles en
Christ, au sein de l'Église, en ayant pour centre le Fils unique du Père,
incarné dans l'Esprit[viii]. C'est pour cette raison que
l'Église —"Temple" de l'Esprit et "Maison" du Père— est
dite justement "Corps" du Christ (et non pas
du Père ou de l'Esprit).
b. Le bon vouloir du Père
consiste en ce que le monde entier, y compris le monde matériel, tous les
mondes deviennent Église dans le Fils en tant que Corps du Christ (« tous » :
pas seulement les êtres humains ni, encore moins, seulement une certaine
catégorie d'hommes, les "croyants"). Suite à l'échec de la vocation
humaine en Adam (chute adamique) cette incorporation du monde dans le Fils passe
impérativement par la Croix, tout en ne s'arrêtant pas à
la Croix. Elle passe par cette profonde expérience du mal qui ébranle tout
homme qui la fait sienne (dans l’ascèse), sans s'y arrêter. Cet être
christoconforme qu'est l'homme eucharistique, l’être ecclésial,
participe à la Croix christique et à sa traversée selon le bon vouloir du Père,
passe par la porte étroite, mais justement pour accéder au Royaume eschatique.
Il n'y passe réellement qu'en communion avec les autres, ses frères,
c'est-à-dire « en Église ». C'est ainsi que l'Eglise-Corps du Christ,
ne s'arrête pas devant la Croix ni devant la porte étroite de l’ascèse. En tant
que Temple de l'Esprit, l'Eglise poursuit son chemin jusqu'au Royaume,
la Maison du Père, où elle trouve sa totalité et sa réalisation plénière : le
Corps ressuscité du Christ dans son intégralité.
Grâce à son fondement trinitaire, incréé (selon
son origine) et eschatologique (selon son but), l'Église de
Dieu, en tant que communauté —sacrement paradoxal de la Résurrection christique
dans l’histoire et icône du Royaume à venir dans l'eucharistie— est constituée
par ce sacrement eucharistique dans la mesure de sa transparence à
l'ultime en Christ : transparence "pneumatique" au Dieu
incréé et au Royaume eschatologique de Dieu à la fois[ix]
c. Dans ce contexte du mystère de l'Eglise au sein
de l'économie trinitaire je me permets d'attirer l'attention sur un point qui
me semble essentiel pour la catholicité orthodoxe : sur le sens du terme
"pneumatique", sur le lien indissociable entre pneumatologie
et eschatologie en économie. Le Saint Esprit, la personne "en
qui" toute réalisation "pneumatique" a lieu dans l'histoire, ne
nous renvoie pas finalement au passé de l'histoire mais à l'eschaton de
l'histoire, à l'accomplissement christique dans le Royaume de Dieu (d'où Il
vient), au fondement véritable de l'économie. L'Esprit nous est donné par le
Christ comme Don du Père (d'où Il procède), don du Donateur, de Celui qui
est le Premier et le Dernier en théologie et en économie. Dans
la liberté "paternelle", le mouvement de l'Esprit Saint au sein de
l'histoire est un mouvement à rebours : un mouvement du futur
vers le présent, pour que tout le passé de l'histoire soit finalement éclairé
et restitué comme "typos", figure, icône du futur à venir. Si l'on
devait parler de la grâce de Dieu dans l'Esprit —de la grâce eschatique (c'est-à-dire
selon l'eschaton) de communion au sein de l'histoire— en termes de
"puissance", il faudrait immédiatement préciser que cette
"puissance" n'opère pas selon le contexte de "ce monde-ci"
(selon le principe de la causalité et de la nécessité de la nature, où l’effet
suit nécessairement sa cause historique), mais bien plutôt dans le contexte
paradoxal d'une causalité renversée, d’une cause (l’Esprit, le
Royaume) qui vient après l’effet (la grâce), d'une causalité
eschatique de liberté.
Il en est de même pour le sens
"pneumatique", épiclétique, de l'anamnèse, de la tradition et du
fondement de l'histoire dans l'Eglise : il s'agit d'une "anamnèse du
futur", donc paradoxale, d'une mémoire à partir de l'ultime
eschatologique, d’une mémoire dont la cause ne se situe pas dans le passé
(mémoire psychologique) mais dans le futur (mémoire "pneumatique"),
dans la récapitulation christique lors de la Parousie qui constitue le
fondement transcendant de l'économie selon le bon vouloir (evdokia) du
Père[x].
3. mystère ecclésial et ministère de l’épiskopè
Au sein de cette approche trinitaire de
l'économie de Dieu et de l'Église dans l'histoire —approche
"selon le Christ" et non pas selon "ce monde-ci", approche
à la fois christique (en Christ), pneumatique (dans l'Esprit) et eschatique
(vers le Père et à partir du Père)— le ministère spécifique de l'épiskopè nous
révèle son sens ecclésial le plus profond.
J'ai déjà fait allusion à la perspective eschatologique,
« typologique » de l'Eglise et partant de l'économie elle-même selon
la conscience orthodoxe. Comme l'Eglise dans son essence n'est finalement que typos et eikon de
l’ultime à venir (eschaton), à savoir de la récapitulation
eschatologique de toute chose en Christ ressuscité pour être offerte au Père
dans le Royaume de Dieu, de même celui qui assume le ministère de l’épiskopè, à
savoir l’épiskopos (évêque), n’est dans son essence que typos et eikon de
l’ultime à venir (eschaton), à savoir du Christ récapitulant en lui
toutes choses pour qu’elles soient offertes au Père dans le
Royaume. Cela fait que l'essence de ce ministère et de celui qui l’exerce,
réside en dernière instance dans la récapitulation et l'offrande au Père de sa
communauté rassemblée (ekklésia), solidaire de toute autre communauté
dans l'espace et le temps, lors de la célébration eucharistique.
Faudrait-il rappeler encore une fois que cette Divine Liturgie constitue pour
les orthodoxes la récapitulation de l'ensemble de l'économie
trinitaire dans une mémoire paradoxale : pas tellement du
passé (qui a eu lieu) mais surtout du futur attendu (qui n’a pas encore eu
lieu) : l'anamnèse épiclétique du Royaume à venir.
A ce sujet il faut attirer votre attention sur la
spécificité de la Divine Liturgie orthodoxe : il est bien connu que pour
la conscience orthodoxe l’acte constitutif de l’ecclésialité
de l’Eglise réside dans chaque célébration eucharistique de l’Eglise concrète,
locale, rassemblée en un seul lieu (epi tô autô) ;
plus exactement de l’ensemble de la communauté avec tous ses
ministères et charismes autour du président de l’Eucharistie, l’épiskopos (la
question complexe des paroisses sera mentionnée par la suite). Lors de chaque
célébration eucharistique c’est l’événement même de la Pentecôte qui a lieu,
ici et maintenant. Or il ne faudrait pas oublier que lors de la Divine Liturgie
(et l’anamnèse paradoxale, épiclétique, du futur à venir) l’Eglise se trouve
non pas simplement face au Royaume mais à la
fois dans le Royaume et face au Royaume. Celui qui préside et qui offre la
communauté au Père, l’évêque, ne se trouve pas simplement face au Christ
mais à la fois en Christ et face au Christ. Bref, dans l’Eglise (et
notamment lors de la Liturgie), nous les croyants nous ne nous trouvons pas
simplement face à Dieu mais simultanément en Dieu et
face à Dieu. Notre histoire n’est pas simplement située face à
l’eschaton mais dans l’eschaton même et face à l’eschaton.
L’histoire n’est ni pulvérisée (engloutie dans l’eschaton), ni non plus laissée
à elle seule (face à l’eschaton). Elle est transfigurée de l’intérieur,
elle est pneumatiquement ouverte de l’intérieur, de manière dynamique, non
statique, pour reprendre à nouveaux frais sa marche vers le Royaume.
C’est cela qui nous permet de bien comprendre
l’iconicité de l’Eglise (icône du Royaume), de l’évêque (icône du Christ). Et
de la catholicité de la communauté locale : l’évêque, entouré
des presbytres et des fidèles dans l’Eglise (communauté
locale), constitue pneumatiquement —dans l’action personnelle de
l’Esprit des Derniers Jours, c’est ici le point crucial— l’icône
véritable du Christ, entouré des Apôtres et de
la multitude dans le Royaume de Dieu (de
l’Apocalypse). L’icône et le typos véritable (par
relation pneumatique) de ce qui doit venir : ni
donc le symbole (par imitation morale), ni encore moins l’idole (par
substitution blasphématrice) en référence au passé …
La catholicité de l’Eglise et de son ministère
d’épiskopè se réalise, réellement bien que paradoxalement (sacramentellement),
dans l'offrande « pneumatique » par l'évêque au Père, in
persona Christi, de toute l’Eglise (locale) en communion avec toute
Eglise autre dans l'espace et dans le temps, et l'ensemble du Créé pour qu'ils
vivent éternellement[xi] D’où la catholicité eucharistique,
typologique et iconique, du ministère de l’évêque, du ministère de son épiskopè
ecclésiale. Episkopè qui dans son essence profonde et sa spécificité
sotériologique dépasse infiniment toute gérance ou surintendance sociologique
et historique, épiskopè « pneumatique » d’une offrande
eucharistique, eschatologique dans l’histoire … pour la vie du
monde.
Pour la conscience orthodoxe il ne s'agit pas ici
d'une approche idéaliste des choses sub speciae aeternitatis —qui
ferait abstraction des réalités concrètes et autres dans l'histoire et le
changement— mais bien plutôt d'une approche typologique, iconique sub
speciae venturi saeculi, sub speciae Regni Dei: d'une approche
concrète, effectuée non pas du point de vue actuel et
descriptif (dans la vision) mais du point de vue de ce qui sera à la
fin, de l'attendu (dans la foi) : de l'eschatique en Christ, tel qu'il
se révèle dans la Divine Liturgie et qu'il se donne à nous dans l'Eucharistie[xii].
Cela étant j’aimerais mentionner ici quelques éléments
particuliers du ministère de l’épiskopè que les spécialistes en ecclésiologie
pourraient éventuellement développer :
La catholicité du ministère de
l’épiskopè implique que celui qui l’exerce ne peut le faire que dans la communion avec
les autres : avec les autres ministères et charismes dans sa
communauté, avec les autres communautés dans le temps et l’espace et avec le
monde entier ; et ce à partir de la catholicité christique de
la récapitulation de toute chose dans le Royaume de Dieu, afin de nous révéler
et de nous rendre participants de ce grand mystère[xiii].
Dans la perspective de communion aux autres et avec
les autres qui est celle de la vie même de Dieu, un et multiple à la
fois (à partir du Père et dans sa communion avec le Fils et l’Esprit),
le ministère spécifique de l’évêque (typos et icône du
Christ, président de l’Eucharistie) manifeste et réalise la
récapitulation eschatologique du tout au Ressuscité, également un et multiple
(le Christ-Tête avec son Corps-Eglise). Expérimenté dans l’acte-Liturgie eucharistique,
ce ministère de l'épiskopè révèle l’être « corporatif » du Christ, du
Christ (ressuscité) absolument indissociable (dans l’Esprit-Saint, sans
séparation, ni confusion) de son Corps (en attente de la résurrection) qui est
l’Eglise (Corps du Christ).
En effet, lors de la Divine Liturgie (acte eschatologique dans
l’histoire mais non pas acte historique comme tel), l'évêque, un et
multiple à la fois, c‘est-à-dire solidaire des autres et en communion
avec les autres, devient ce qu’il est selon sa vocation, l’icône du Christ (alter
Christus dans l’Esprit-Saint, sans séparation, ni confusion) en
offrant la communauté, toute communauté et la Création entière du Christ
corporatif au Père. Gérant pour ainsi dire et présidant de
manière eucharistique (non selon l’esprit de « ce
monde » mais selon celui du « monde à venir », le Saint-Esprit)
l’Eglise dont il a la charge, l’évêque révèle dans la Liturgie (et doit le
faire avant et après la Liturgie dans la vie quotidienne, pour rester fidèle à
soi-même) que sa communauté, toute communauté et le monde entier n’appartient
qu’au Christ… qui en fait les offre au Père.
De ce point de vue, comme le pain, le vin, l’eau et
les autres éléments de la Création constituent dans l’offrande (anafora)
des réalités sacramentelles, eucharistiques (réalités de grâce), le ministère
de l’épiskopè constitue pour les orthodoxes une réalité pareillement
sacramentelle. Comme l'Eglise dans son essence profonde —dans son essence vocationelle et
sa finalité eschatologique— constitue la présence paradoxale,
sacramentelle et iconique (une présence-dans-l’absence) du Royaume à chaque ici
et maintenant, de même l'évêque constitue la présence paradoxale parmi nous du
Christ dans son Royaume : révélation et réalisation paradoxale (déjà-et-pas
encore) de la récapitulation de toute chose et de l’offrande au
Père, à travers la croix christique, dans l’Eucharistie, vers la résurrection
du Corps du Seigneur glorieux dans tous ses membres.
Le ministère de l'épiskopè est inconcevable sans celui
des presbytres, sans les diacres et les charismes des laïcs. Dans ces
ministères et charismes, interdépendants et solidaires les uns des autres,
l’ensemble de la communauté autour de l’évêque constitue une harmonie
parfaite : harmonie « pneumatique » de l’évêque avec les autres
et simultanément des autres avec l’évêque dans le corps ecclésial du
Christ : corps ecclésial du Christ fondé à partir du, et
finalement identique au corps eucharistique du Seigneur de la
gloire.
Il ne serait pas inutile de mentionner ici le
paradoxe ontologique qui caractérise le rapport de communion
entre le ministère de l’épiskopè et les autres ministères et charismes des
baptisés et qui rappelle celui de la communion asymétrique (pneumatique)
entre le Christ et l’Eglise dans l’histoire : comme le Christ précède ontologiquement
son Corps, l’Eglise, tout en étant conditionné par
l’existence de celle-ci (le Christ, réalité corporative, ne serait plus
lui-même sans son Eglise), l'évêque précède les autres
ministères (puisque c’est lui qui baptise et ordonne) tout en étant
lui-même conditionné par l’existence des ces autres ministères
au niveau ontologique (au niveau de son être en tant
qu’évêque, et pas simplement au niveau éthique, au niveau de son bien
être en tant que bon évêque).
Quant à la jonction indissociable, fondatrice,
entre présidence de l’eucharistie (et par extension du
baptême, des ordinations et des autres sacrements) et ministère de
l’épiskopè un problème émerge : pendant les tout premiers
siècles de l’histoire de l’Eglise les presbytres ne présidaient pas
l’eucharistie (ni par extension les autres sacrements) mais avec les diacres et
le peuple ils entouraient l’évêque (presbyterium) dans la
célébration ; la spécificité ministérielle des presbytres consistait alors
dans l’enseignement. Or par la suite —avec l’apparition des paroisses vers
la fin du IIIe siècle et le début du IVe— les choses
changent : dans la paroisse ce sont les presbytres qui président
l'eucharistie —cependant toujours comme extension du ministère épiscopal de
présidence eucharistique (ce qu’exprime le fermentum en
Occident et l’antimènsion en Orient)— tandis que les évêques
gardent pour eux l’enseignement et les ordinations parmi les sacrements (avant
de devenir des administrateurs des affaires ecclésiastiques pour l’essentiel)[xiv]. Quelles sont les
retombées ecclésiologiques de ce déplacement au regard, au moins 1) de
la catholicité de l’Eglise concrète (locale ou désormais
paroissiale ?) et simultanément de l’essence du ministère de
l’épiskopè (eucharistique et catholique ou autre ?) Ce sont des questions
qui continuent à faire couler beaucoup d’encre (et de larmes), chez les
orthodoxes du moins[xv].
Par ailleurs, le ministère de l’épiskopè assure
la continuité de témoignage des générations post-apostoliques
(qui n’ont pas vu le Seigneur) avec les communautés
apostoliques dans ce que ces dernières ont d'unique et
d'"irremplaçable" (ayant vu le Seigneur) :
une continuité de fidélité selon la foi des
témoins qui ont cru sans avoir vu avec ceux
qui ayant vu ont cru[xvi].
Le ministère (et donc l’autorité qui en découle) de
l'épiskopè ecclésiale de l’évêque (épiskopos) est relationnel, nous
l’avons déjà mentionné : il manifeste en lui-même la coïncidence
« pneumatique » de l’un et du multiple, de l’unité et de la
multiplicité (à l’image du Christ, à l’image de Dieu le Père) à l'intérieur de
l’Eglise dont il a la charge (en communion avec les autres ministères et
charismes) ; mais également à l’extérieur de son Eglise, in
solidum (c’est-à-dire en communion) avec les autres Eglises dans
l’espace et le temps. Ainsi autour de son évêque chaque Eglise coïncide sans
se confondre —dans l’Esprit Saint (sans séparation, ni
confusion) — avec toute autre Eglise (et tout autre évêque). C’est dans ce
contexte pneumatique de communion d’Eglises (et d’évêques) que la question du
rapport entre "primauté" (unité) et "synodalité"
(multiplicité) se pose pour les orthodoxes[xvii].
4. retombées existentielles et vocation œcuménique
Selon la conscience orthodoxe, une vision christique du
mystère de l'Église (le Corps du Christ) et de la vie en Christ (vie pneumatique dite
"spirituelle") est celle qui dans la lutte contre le mal,
l'injustice, le désespoir et la mort même, pousse les hommes à s'approprier
l'avant-goût du Royaume de Dieu ; et ce grâce à l'Eucharistie, à l'expérience
de l'anticipation réelle, bien que paradoxale, de la Résurrection dans le
Royaume. Expérience sacramentelle par laquelle des
communautés humaines deviennent "Eglises", c'est-à-dire icônes du
monde à venir (eschaton), de la Création entière transfigurée
dans l'humanité christique, celle du Christ ressuscité, lorsqu'elle aura définitivement surmonté
la corruption.
Si du point de vue de l'histoire le
mystère du Christ —sa mort, sa résurrection et sa glorification "à la
droite du Père"— est inscrit au sein même de la temporalité du monde et au
cœur même de notre histoire, du point de vue de l'eschaton (in
patria) c'est le contraire qui apparaît comme vérité ultime du monde : la
temporalité de la Création et l'histoire humaine sont inscrites au cœur même
(et à partir) du Mystère du Christ. Une telle vision, typiquement orthodoxe, a
des conséquences pour notre perception du temps en tant que mystère :
le temps n'est plus vécu comme mesure naturelle, ni comme temporalité
existentielle —contexte d'une odyssée de l'espèce humaine et de la
nature cosmique vers la mort— mais comme mystère christique et contexte de
l'histoire de chacune des personnes humaines vers la
résurrection du Créé entier. Une telle approche eschatologique conditionne par
ailleurs notre façon d'aborder les sacrements du Royaume et la vie en Christ de
chacun en Église, l'organisation ministérielle et la communion des Églises, en
chacune et entre-elles : d'où l'intérêt pour notre question du ministère
de l'épiskopè, nous l’avons vu, mais aussi pour notre vocation œcuménique
commune.
L'œcuménisme constitue une véritable vocation eschatique des
Églises dans l'histoire. Il nous faut bien témoigner de la communion déjà
existante en Christ, réelle bien que paradoxale, de ces Églises du Christ qui
ne sont pas encore en communion entre elles. Cependant, dès maintenant, elles
pourraient se dire "Église d'Églises" (J.-M. Tillard) ; et
ce à partir du Royaume de la Résurrection qui les transcende et
les conditionne (dans leur eucharistie), dans leur transparence
commune —c'est-à-dire leur fidélité— à ce
Royaume.
Face à nos tentations séparatistes multiples, souvent
historico-culturelles, il nous est impératif de réaffirmer in solidum,
par nos choix, nos actions (et nos politiques) d'Eglises dans l'histoire (in
via), la transcendance eschatique du Royaume de Dieu,
"caché" en Christ au cœur du monde. Caché dans sa présence
paradoxale mais réelle (une présence-dans-l'absence) parmi nous, ici
et maintenant, et dans l'attente épiclétique de la
présence-sans-absence du même Royaume eschatique de Dieu à la
fin des temps : lors de la transfiguration plénière de
nos histoires d’Eglises et de toute l'Histoire récapitulée en Christ, lors de
la christification achevée de la Création entière, de tous les
mondes "visibles et invisibles" (in patria).
Publié dans CAHIERS UNITE DES CHRETIENS no 1
[i] De
ce fait, les orthodoxes d’aujourd’hui, pas moins certes que les autres
confessions historiques, doivent se mesurer constamment à la grande Tradition
de l’Eglise indivise.
[ii] Cf. J. Zizioulas, "Le Mystère de
l'Église dans le tradition orthodoxe", dans Irénikon t.
60/3 (1987/3), p. 323.
[iii] En
qualifiant cette approche d' "onto-sotériologique" je fais référence
à une approche résolument sotériologique, christique, qui comporte
des retombées ontologiques (et pas simplement éthiques, mystiques ou autres).
Le rapport entre sotériologie (le salut au sens large du terme) et ontologie
(l'existence, l'être) des étants créés est non convertible. Pour l'approche
trinitaire de l'économie de Dieu dans son ensemble cf. notamment F. Heinzer, “L’explication trinitaire de
l’économie chez Maxime le Confesseur”, dans F. Heinzer et Ch.
Schönborn (éd.) Maximus Confessor — Actes du Symposium sur
Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980, Freiburg 1982, p.
159-172.
[iv] Cf. J. Zizioulas, "Le Mystère de
l'Église dans le tradition orthodoxe", dans Irénikon t.
60/3 (1987/3), p. 325. Pour cette partie de mon travail je suis largement
redevable à un petit texte peu connu de J. Zizioulas ("Le fondement
trinitaire de l'ecclésiologie") paru en grec et traduit en français
dans Synaxe : Bulletin de liaison des orthodoxes francophones de la
région Midi-Méditeranée (Métropole grec-orthodoxe de France), 1998/3,
p. 3-6.
[v] La
formule relève du IVe Concile œcuménique confirmant la réalité de l'union personnelle avec
le Dieu incréé (en Christ) de toute créature —créée en dehors de Dieu
lui-même (dans le néant) et située face à Dieu lui-même (comme
autre que lui). Loin d'être supprimés, le néant et l'altérité de la créature
sont promus et élevés dans une dignité inouïe, lors de cet événement christique
et l'accueil de ce don incréé. Dans une perspective asymétrique,
néochalcédonienne, qui ne maximalise la réalité créée qu'en la minimalisant, l'élévation
ontologique du créé dans la résurrection et la vie (selon la
grâce de Dieu faite au créé) est à la mesure de son abaissement
ontologique dans la mort et le néant (selon la nature même du
créé).
[vi] Cf. J. Zizioulas, Il creato come
eucaristia, coll. Spiritualità orientale, Ed. Qiqajon, Magnano (VC)
1994.
[vii] On
n’insistera jamais trop sur l’unicité communionnelle, sur l’altérité et la
solidarité, absolues au sens ontologique du terme, de chacune
des personnes trinitaires —des seules « personnes » véritables à
proprement parler— qui au lieu de s’effectuer dans la distance et la séparation
des unes par rapport aux autres se réalise dans l’identité et la solidarité
absolue (mais non indistincte !) de chacune avec les autres, dans leur
communion infinie.
[viii] Cf. F.-X. Durwell, Jésus Fils
de Dieu dans l'Esprit Saint, Coll. Jésus et Jésus-Christ n° 71,
Desclée, Paris 1997.
[x] Cf. J. Zizioulas, Eucaristia e Regno
di Dio, coll. Spiritualità
orientale, Ed. Qiqajon, Magnano (VC) 1996, p. 18-21.
[xi] Cf. J. Zizioulas, "Le Mystère de
l'Église dans le tradition orthodoxe", dans Irénikon t.
60/3 (1987/3), p. 323-335.
[xii] Cf. J. Zizioulas, Eucaristia e Regno
di Dio, coll. Spiritualità
orientale, Ed. Qiqajon, Magnano (VC) 1996.
[xiii] Pour
la question de la catholicité cf. “La Communauté eucharistique et la
catholicité de l’Église”, dans Istina, t. 14 (1969),
p. 67-88 [cf. L’Être ecclésial, p. 111-135].
[xiv] Pour
l’ensemble de cette question on peut se référer entre autres à J. Zizioulas, “The Bishop in the
Theological Doctrine of the Orthodox Church”, dans Kanon VII. Der Bischof und seine
Eparchie [L’évêque
et son éparchie] Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen, Verlag
des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Vienne 1985,
p. 23-35.
[xv] Cf.
en particulier l’ouvrage de J. Zizioulas, L’unité de l’Église dans la
sainte eucharistie et l’évêque au cours de trois premiers siècles, Athènes
1965 [tr. fr. Métropolite Jean de
Pergame, L’Eucharistie, l’Evêque et l’Eglise durant les trois
premiers siècles, coll. Théophanie, Desclée de Brouwer, Paris 1994].
[xvi] Pour
une analyse détaillée de la question cf. entre autres J. Zizioulas, “La continuité avec les
origines apostoliques dans la conscience théologique des Églises orthodoxes”,
dans Istina, t. 19 (1974), p. 65-94 [cf. son L’Être
ecclésial, p. 136-170].
[xvii] Cf. J. Zizioulas, “La primauté dans
l’Eglise : une approche orthodoxe”, dans SOP, n° 249
(juin 2000), Supplément (Doc. 249.A).