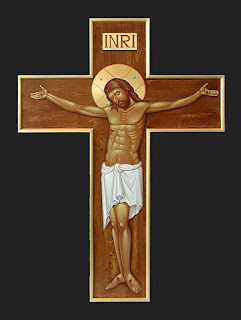Le Christ et ses résonnances dans la foi chrétienne orthodoxe
Le Christ et ses résonnances dans la foi chrétienne
orthodoxe
Méditation spirituelle
Athènes, 12 novembre 2015
Dr Konstantinos Agoras
Afin d’introduire mon propos de ce soir en regard de la spécificité d’une
approche orthodoxe sur le mystère du Christ je vous inviterais à contempler
deux fois par la suite, avec un regard occidental et oriental, les
Crucifix représentés en Occident et en Orient.
Une première fois nous voyons Jésus pendu sur la croix avec ses plaies
saignantes, sa tête incliné et ses yeux fermés, plus ou moins serein ; et
au-dessus un écriteau : « JNRJ » (« Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs »
Jn 19,19). Cette représentation est celle
qui correspond à la lettre du récit
évangélique. Il s’agit d’un Crucifix occidental, post médiéval surtout.
Contemplons maintenant le crucifix selon la tradition orientale :
c’est sûrement la même réalité que nous voyons, Jésus de Nazareth ; et la
différence entre un bois sculpté et un bois peint –une icône taillé selon la
forme du corps pendu– n’est pas l’essentiel, me semble-t-il. L’essentiel c’est
l’identité du personnage, le Christ Jésus ici et là, et j’insiste sur ce point.
Cependant il y a une différence. L’écriteau byzantin au-dessus de la tête
du Crucifié ne porte pas les signes du récit
historique de la passion mais celles d’un récit historico-théologique, pas simplement historique; et
au lieu de porter en haut comme écriteau « JNRJ » nous avons
une autre écriture, une lecture au second degré : « ΟΒΤΔ » (ο βασιλεύς της δόξης, « le Roi de la Gloire »).
Mis à part la représentation plus ou moins dramatique du corps –j’ai vu des
Crucifix romans en bois sculptée très sereins et majestueux, il n’en est pas
question–, mis à part aussi la différence entre sculpture et icône peinte –mais
Byzance n’ignorait pas les sculptures, c’est sûr– l’essentiel de la différence entre Orient et Occident – mais non
pas du différend, comme certains fanatiques voudraient le présenter
!!! – tient à la didascalie comme on dit, à l’explication de celui qui
est représenté : une didascalie
de la passion purement « historique » en Occident, une autre « historico-théologique »
en Orient.
Chez nous c’est comme si l’on voudrait reprendre le geste des romains en clouant
sur la croix l’écriteau expliquant l’identité du Crucifix mais reprise,
relue après coup dans la foi croyante et confessante de l’Eglise. Comme pour
dire que l’histoire pour ceux qui contemplent Jésus pendu ne sera à jamais
dissociable de la foi eschatologique, de la foi à l’ultime (eschaton) ; à l’ultime
non seulement au sens historique et existentiel du définitif mais aussi
ontologique: ce qui contera à jamais. La royauté du Crucifié précisément sur sa croix est fortement
marqué en Orient, dans l’orthodoxie, comme par ailleurs en Occident roman
d’avant les croisades.
Partant de cette introduction sur la différence de tonalité et de couleur de
l’écriteau des Crucifix en Occident et en Orient chrétiens, j’aimerais par la suite faire quelques
remarques sur la sensibilité
christologique de l’Eglise et de la théologie de tradition orientale et
orthodoxe concernant la christologie. Il va de soi qu’Orient et Occident
chrétiens, dans leurs traditions théologiques et spirituelles respectives (et
complémentaires), acceptent pareillement la foi de l’Eglise indivise sur l’identité
du Christ Jésus, exprimée par les six premiers conciles œcuméniques, de Nicée I
à Constantinople III du IVe au VIIe siècles. Les simples remarques qui suivent
ne portent donc que sur des accentuations différentes qui caractérisent les
sensibilités et les spiritualités.
1. Une première remarque s’impose : L’Orient n’accepte point de considérer l’histoire en elle-même, l’histoire de Jésus
en particulier et l’histoire du salut en général : il la considère comme interprétée
théologiquement. Interprétée non pas à partir d’elle-même (dans une sorte
d’auto-compréhension historicisante de l’histoire), mais comme comprise dans la
foi à partir de l’au-delà de
l’histoire, à partir de l’ultime
(eschaton) du don de Dieu à nous. « Histoire et foi », « histoire
et eschatologie » -et l’eschatologie signifie ici l’ultime de l’histoire
et de l’être même, son cœur pour ainsi dire-, « histoire et
eschatologie » comme je disais tout-à-l’heure, iront à jamais ensemble.
Cela c’est un premier point de la sensibilité orientale et orthodoxe qu’il faut
retenir, me semble-t-il : son
approche particulière à l’histoire.
Nous devinons facilement le corrélatif en christologie de cette
articulation, spirituelle, entre histoire et eschatologie: l’Orient ne pourrait
jamais considérer l’histoire
de Jésus en particulier (et cella du salut en général) en dehors de la foi confessante, en dehors de l’eschatologie. Car pour nous, la
« foi » signifie d’abord « la garantie de ce qu’on espère, la
preuve des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1). Dans la sensibilité
orthodoxe l’histoire de Jésus, son
humanité, ne pourrait être considérée en elle-même en dehors de l’eschatologie, à savoir de sa
résurrection, de son ascension et de sa Parousie dans la gloire. Son humanité
n’est point considérée en elle-même seule
(comme un quid) en dehors de sa personne théanthropique.
Pourtant aux yeux de la sensibilité occidentale cette approche orthodoxe de
l’histoire et de l’humanité du Seigneur pourrait faire quelquefois problème. Nous
semblons aux yeux de nos frères minimiser l’intégrité de l’histoire et de
l’humanité du Christ. Cependant selon la confession de foi de Chalcédoine,
Jésus-Christ est en même temps divin et humain, ou, pour utiliser l’expression
correspondante en langue grecque, il est le théanthropos,
le Dieu-homme. Ainsi dans la perspective orthodoxe, l’un des défauts majeurs de
la vision critique moderne sur Jésus-Christ est que son humanité soit affirmée en elle-même détachée de sa personne
théanthropique.
S’il ressort clairement de l’Ecriture que Jésus-Christ est vrai Dieu et
vrai homme, il reste à répondre à une question fondamentale : comment les
deux natures sont-elles unies dans l’unique personne de Jésus-Christ ? Le
Concile de Chalcédoine en utilisant les quatre adverbes (ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως) y répond apophatiquement pour affirmer le mystère (non
pour le supprimer) et dire que dans cette admirable unité de Dieu et de l’homme
en Christ Jésus il n’y a pas de confusion, ni de transformation, ni de division
ni de séparation. Par conséquent nous ne pouvons pas faire de ces adverbes
négatifs des présupposés en ce qui concerne le « mode » de
coéxistence du divin et de l’humain dans une seule personne (υπόστασις). Cette fameuse pénétration mutuelle de la divinité et
de l’humanité en Christ qui est appelée en grec περιχώρησις est exprimée en
latin par la communicatio idiomatum.
Or si Jésus est la clef des Ecritures il l’est en tant que « Jésus-le-Christ[1] »,
dans cette articulation apostolique où histoire et eschatologie sont
indissociables. Le principe de l’Ecriture chrétienne n’est pas et ne sera
jamais un « Jésus trivial » (ψιλός άνθρωπος), pardonnez-moi l’expression. C’est le Christ théanthropique (divino-humain), le
Christ qui est le θεάνθρωπος, le « Dieu-homme » (un seul terme, une seule
désignation qui n’est valable que pour Lui). L’élément « anthropique »
pour ainsi dire, ne peut être contemplé en lui-même seul mais à partir du « théanthropique » du Fils éternel
(personne concrète et unique), non pas à partir de l’ « anthropique » en
général d’un homme quelconque de l’expérience quotidienne. Dans le cas
contraire cela équivaudrait à répéter en théologie chrétienne la faute d’Adam :
à penser les choses séparées de Dieu,
en dehors de la communion avec Dieu.
Le Christ est vraiment et pleinement homme et l’Eglise commence par
condamner depuis déjà le IIe siècle l’hérésie dangereuse du docétisme où
l’humanité du Seigneur n’est vraiment qu’une apparence. En devenant homme, le
Fils éternel de Dieu est devenu un humain particulier et distinct, Jésus de Nazareth.
Et pourtant, le Christ n’est pas une personne
humaine au sens habituel du terme mais la personne théanthropique, incarnée
du Fils. Son humanité n’a pas une
hypostase, une subsistance à elle (subsistentia) parmi les innombrables
subsistances de l’humanité, vous et moi. L’hypostase, la subsistence, la
personne du Christ, divine par nature (la personne du Fils éternel)
« enhypostasie » la nature humaine, donne subsistance et réalité à
son humanité en la créant pour lui-même(non
pour elle-même) comme dit Léonce de Byzance au Vie siècle, aux temps du Ve
Concile œcuménique : la « personnalité » si l’on veut du Christ
Jésus n’est autre que la personnalité du Fils éternel préexistant qui assume
l’humanité qu’Il créé pour lui-même
(qu’il se créé).
En Christ Jésus l’humanité n’est pensable à partir d’elle-même –ce qui
signifierait l’envisager dans un état de chute– mais à partir de sa personne
théanthropique c’est-à-dire en tant que l’humanité personnelle du Fils incarné, unie à sa divinité de manière
indissociable et sans confusion. Je parle bien de l’humanité personnelle qu’il
–le Fils– s’est créé pour lui (par l’Esprit saint dans le sein de la Vierge
Marie). Or ce qui vaut pour le Christ Jésus (en regard de son humanité) est
valable en théologie orthodoxe pour chacun de nous, en regard de notre
humanité ; Elle non plus n’est pas considérée en elle-même, dans une
autosuffisance ontologique mais en perspective de christification
(déification), dans son ouverture à Lui. Cela
nous fait comprendre mieux pourquoi dans le mystère du Christ nous n’avons pas
à faire avec « Dieu » et l’ « homme » tout simplement en
symétrie mais nous avons à contempler le même Seigneur deux fois, sous deux
angles différents : « ab aeterno » le Fils éternel en sa divinité incréée et « dans
l’histoire » le même Fils éternel en son humanité théanthropique, non pas simplement anthropique. C’est
la raison pour laquelle la christologie orthodoxe est dite « asymétrique » ; ce qui crée pas mal de mécompréhension
en occident chrétiens.
Notre première observation du point de vue orthodoxe porte donc sur l’articulation entre histoire et
eschatologie dans la foi où l’histoire, ouverte à son au-delà est porteuse
d’une certaine manière de l’eschatologie elle-même. En perspective orthodoxe le
couple « histoire-eschatologie » ne se superpose pas au couple
« déjà-pas encore » comme si l’histoire était le « déjà »
et l’eschatologie le « pas encore », comme si l’eschatologie était purement extérieure à l’histoire. En
Orient chrétien c’est l’histoire elle-même qui est sentie comme « déjà-et-pas
encore » eschatologique. Ainsi l’eschatologie (la résurrection, le
royaume) cerne l’histoire non seulement
« de l’extérieur » –il la cerne certes dans l’attente– mais aussi
et d’abord « de l’intérieur » :
l’histoire comme telle est paradoxalement porteuse de l’eschatologie.
2. Permettez-moi ici une autre observation, cette fois-ci sur
le rapport entre christologie et
anthropologie en théologie. L’humanité du Christ n’est pas pensable à
partir de la nôtre mais la nôtre est pensable –ou plutôt reçue– à partir de son
humanité théanthropique. Car, comme disait O. Clément l’homme n’est vraiment homme qu’en Dieu. C’est la raison pour
laquelle les Pères en Orient surtout ont toujours envisagé l’humanité de
l’homme dans la perspective de sa christification, de sa divinisation. Ici
même, en Christ (εν Χριστώ), la christification, la divinisation comme perspective
eschatologique n’est pas purement extérieure mais cerne l’homme de l’intérieur
et de l’extérieur. Dans l’histoire, dans notre existence quotidienne, malgré
nos chutes, nous sommes en Christ Jésus déjà et pas encore divinisés,
christifiés.
Il faut insister sur ce point anthropologique car, nous le savons bien,
ainsi que Pannenberg l’a fort bien illustré, le fondement de l’anthropologie (théologique)
c’est la christologie. Non pas
vice-versa j’ajouterais volontiers de ma part. Il faut bien faire attention de
ne pas inverser l’ordre, et faire de l’anthropologie
le fondement spéculatif de la christologie[2]. Car
dans ce cas on n’éviterait pas la projection de notre expérience anthropologique
des déchus sur l’humanité du Christ –l’humanité pneumatique du File éternel– et
donc l’hétéro-interprétation de la christologie. On n’éviterait pas « la
chute » –littéralement– de la christologie dans une représentation théologique déchue: son
articulation spéculative à partir de notre expérience déchue de l’humain post peccatum.
Le mystère de notre foi réside dans le fait que nul acte du Seigneur n’a
été exclusivement divin ou exclusivement humain. Tout acte, tout
pouvoir, toute énergie de Jésus-Christ est en même temps acte, pouvoir, énergie
divino-humains. L’hérésie des Nestoriens au Ve siècle a voulu nier cette vérité
essentielle du dogme chrétien en avançant la thèse que l’humanité seule du Christ a été crucifiée. Cyrille d’Alexandrie,
en réfutant la thèse des Nestoriens, affirme que ‘la Parole du Dieu incarné a
été crucifiée’.
Faisant retour à la théanthropie du Fils éternel dans son incarnation
pneumatique j’aimerais affirmer que cette foi dans le Christ théanthropique est pour nous la véritable lumière pour toute
lecture orthodoxe de la sainte Ecriture dans l’Esprit saint. Car le même Esprit
est l’acteur aussi bien de la théanthropie, de la divino-humanité si vous
préférez de Jésus que de la rédaction et lecture pneumatique, théanthropique de
l’Ecriture.
3. Je ne veux en aucune manière nier cette association
stricte de l’histoire et de la foi confessante en Occident chrétien tout autant
qu’en Orient quant à Jésus crucifié et ressuscité. Je garde affectueusement
chez moi la copie d’un crucifix médiéval en bronze où le Seigneur porte la
couronne royale sur sa tête tout en étant vêtu de sa tunique, signe de son
supplice selon les habitudes de l’époque. Il est inutile d’opposer Orient et
Occident chrétiens, comme il est serait vain d’opposer un Occident de la
Croix et un Orient de la Résurrection. Essayons donc de parler avec une
grande humilité –comme disait un spirituel orthodoxe G.Khodr– dans une
attitude d’adoration, quand l’intellect, renonçant à comprendre comment l’Inaccessible
peut être aussi le Crucifié, devient tout entier gratitude et louange.
Cependant je ne pense pas qu’il serait théologiquement et spirituellement
profitable d’envisager la réalité du Seigneur à partir des idées générales, des
abstractions, telles qu’« humanité » et « divinité » (comme
telles) bien que cela a été fait par le passé et en des moments glorieux de la
tradition ecclésiale. Il me semble modestement qu’il faudrait le faire à partir
du concret. Et à ce niveau-là nous avons trois réalités à contempler – et
non pas deux (Dieu et homme): la divinité de
Dieu, la divino-humanité du Seigneur
et l’humanité de l’homme quotidien.
Car d’où, en tant que chrétiens, nous vient-elle théologiquement l’idée de « divinité » et
d’« humanité » sinon de la réalité concrète du Christ en personne,
dans sa divino-humanité unique,
unique sans séparation et sans confusion ? Et une autre précompréhension
de la « divinité » de Dieu – comme par ailleurs de l’ « humanité »
de l’homme– en dehors de Lui (remoto Christo) serait-elle digne de la théologie
chrétienne en tant que telle ?
Ne serait-elle pas finalement et fatalement une projection de l’esprit du
« siècle », de ses images ou de sa sagesse sur la réalité du don par
excellence de Dieu qui est le Christ ?
Si j’insiste sur ces points c’est parce que les définitions dogmatiques des
Conciles communs en Orient et en Occident concernant le Christ et son mystère
semblent souvent porter sur cette voie d’une lecture « selon le
siècle », d’une lecture philosophique de la vérité du Seigneur. Cela
dépend certes des yeux avec lesquels on les lit. Cependant bien que les Pères
et les Conciles ont utilisé le langage technique, philosophique de l’époque
pour exprimer la foi leur visée était le mystère indicible de l’unité du
Christ. Mystère indicible car pneumatique et non pas exploit métaphysique de
l’unité de Dieu et de l’homme en Christ sans séparation, ni confusion. Que
veut-elle dire existentiellement, spirituellement une telle unité ? Il
nous sera plus simple de comprendre son sens, me semble-t-il, faisant retour à
un texte de l’Ancien Testament, du Livre de Job.
4. Dans son effort pour comprendre le conflit entre le
Seigneur et lui-même, Job s’exclame dans la tension du désespoir qui
l’engloutit : « L’Eternel n’est pas un homme comme moi pour que je
lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n’y a pas entre nous
d’arbitre qui pose sa main sur nous deux » (Jb 9,32-33). « Il n’y a
pas entre nous d’arbitre », personne qui pourrait rapprocher les deux partenaires
du conflit : l’Eternel dans sa toute-puissance et l’homme dans la
fragilité de son existence, mais pourtant de sa recherche en tant que
« juste » devant Dieu.
Sous l’Ancienne Alliance personne ne pouvait être arbitre, personne ne
pouvait intervenir dans le conflit entre l’homme et Dieu, personne ne pouvait
prendre l’un et l’autre par l’épaule, non pas pour séparer deux ennemis, mais
plutôt pour unir deux êtres qui souffrent d’un état de séparation que tous deux
regrettent. Et c’est justement en ceci que réside tout le mystère de
l’Incarnation.
En Jésus de Nazareth ce conflit entre Dieu et l’homme est une confrontation
dans le for intérieur d’une seule et même personne, qui est simultanément
Dieu et Homme, qui est une unité personnelle, une harmonie entre le divin et
l’humain, l’hypostase théanthropique du Christ. En Jésus-Christ, l’humain est librement dans une situation de face à
face avec le divin, une situation cependant non pas de conflit ou de séparation
mais d’acquiescement, de victoire, d’harmonie et d’amour. Sur la scène
intérieure d’une âme unique, celle du Fils éternel fait homme, se résout tout
le drame cosmique entre le péché et Dieu. L’incarnation est simultanément
intercession : Jésus-Christ Dieu-homme est notre Intercesseur auprès du
Père en ce sens qu’en Lui l’humanité est entrée dans le cœur même du conflit entre Dieu et l’Homme, dont parlait
Job sous l’Ancienne Alliance. Le Christ assume en lui-même toute situation de
conflit et c’est en lui que tout conflit trouve sa solution : solution
pour le monde, pour l’homme et pour le cosmos tout entier.
En Jésus-Christ le monde est préservé de la désintégration. Il est le
« lieu » sacré à l’intérieur duquel la création toute entière passe
de la mort à la vie, « le grand mystère caché, la fin bienheureuse et le
but pour lequel tout fut créé, le but où les créatures accomplissent leur
retour à Dieu. Ce retour pacifié du cosmos en Dieu n’est possible que si le
Christ est homme véritable, et Dieu véritable, « vrai Dieu de vrai Dieu …
qui, pour nous les hommes et pour notre salut … s’est fait homme ».
Permettez-moi ici de proposer à notre méditation un grand texte de Maxime
le Confesseur faisant écho à s. Paul qui résume pourrait-on dire la vision
orthodoxe –mais aussi catholique et évangélique de l’Eglise indivise, je pense–
sur le Christ.
5. Le moine Thalassius, scrutant les Ecritures, avait posé
la question suivante à Maxime : « Comme
d’un Agneau sa reproche et sans tache, le Christ, d’une part préconnu avant la
fondation du monde, d’autre part manifesté dans les derniers temps à cause de
vous » (1P 1,20). Par qui a-t-il été préconnu ? (Thal 60 :
PG 90/620). Comme il a été observé l’exégèse de Maxime interprète le texte de
la 1a Petri en connexion étroite avec
le texte de l’Epitre aux Colossiens
(1,26) et donc en connexion implicite avec ses
parallèles (Rom 16,25-26, 1a Cor 2,7, Ep 3,3-12, Col 2,2-3 etc). De cette
manière il peut mettre en équivalence, le « Christ » dont
parle la 1a Petri et le « mystère
du Christ » des textes pauliniens en voyant dans ces deux expressions
la même réalité : le mystère de l’union hypostatique des deux natures et
leur périchorèse en Christ. Je cite Maxime :
« Le mystère du Christ, ce texte de l’Ecriture l’a appelé Christ. Et
le grand Apôtre en témoigne clairement, en parlant ainsi : ‘Le mystère
caché depuis les générations, maintenant a été manifesté’ (Col. 1,26). Il dit
de toute évidence que ‘le mystère selon le Christ’ est la même chose que ‘le
Christ’ ». A ce extrait fait suite toute une longue explication sur
l’union hypostatique, sur ce que l’on pourrait appeler l’ontologie du
mystère christique. Mais comme je disais au départ à propos du risque de
projection sur la christologie, il ne faut pas entendre ici le mot « ontologie »
comme une science de l’être en général
qui serait appliqué au cas particulier
de la « personne du Christ ». C’est au contraire le mystère lui-même
qui instaure son ontologie propre[3].
A cette ontologie du mystère succède naturellement dans le commentaire de
Maxime l’exposé de sa dispensation,
c’est-à-dire de son économie : préconçue dans le Conseil Trinitaire,
l’union hypostatique est l’axe même
de la création, la visée (σκοπός) et le but
selon lequel fut créé l’univers. Je cite de nouveau dans la traduction de Alain
Riou ce texte splendide mais très dense de Maxime en demandant votre attention.
« Voilà le grand mystère caché. Voilà la fin bienheureuse pour
laquelle toutes les choses ont consistance. Voilà la visée divine préconçue
avant le commencement des êtres et que nous définissons comme ‘la fin préconçue
à cause de laquelle sont toutes
choses et qui n’est elle-même à cause de rien’. Fixant les yeux sur
cette fin, Dieu a produit les essences des êtres. Voilà proprement le terme de
la Providence et des choses prévues, terme selon lequel en Dieu est la
récapitulation de toutes choses créées par lui. Voilà ce qui circonscrit tous
les âges, le mystère manifestant le grand Conseil de Dieu, superinfini et
préexistant de façon infinie aux âges (Ep 1,10-11). Conseil dont le Verbe
lui-même de Dieu selon l’essence, devenu homme, est devenu l’Ange (Is
9,6) ; lui-même ayant rendu visible –s’il est permis de le dire– le
fondement (πυθμένα) le
plus intérieur de la bonté du Père et ayant montré en lui la fin pour laquelle
les créatures ont pris clairement le commencement en vue de l’être. En effet,
par le Christ, c’est-à-dire le mystère selon le Christ, tous les
âges et tout ce qui est dans ces âges ont pris en Christ le commencement, l’être et la fin »[4].
Chers amis, permettez-moi de répéter l’expression inouï de Cyrille
d’Alexandrie : « le Verbe de Dieu a été crucifié ». Il s’ensuit
donc que Dieu était en Christ réconciliant l’humanité à lui-même. Dieu s’est
fait chair, Dieu est mort, Dieu est ressuscité, Dieu dans sa kénose libre et
infinie s’est privé en Jésus de Nazareth de sa propre gloire. La kénose divine
–lisez l’incarnation– est telle que Dieu en Christ est dénué de sa toute
puissance, il est limité par son humanité. Tout ce que le Verbe accomplit chez
nous il l’accomplit à travers son
humanité, non pas en amont de celle-ci. C’est cet évidemment de Dieu que
les Pères ont désigné comme étant « un dénuement de Dieu par économie », par condescendance divine, par kénose libre d’amour pour nous. Dans
l’événement de Bethléem que nous allons prochainement fêter ensemble, Dieu nous
est donné dans toute la vulnérabilité et la fragilité d’un nouveau-né qui nous
est offert, mis à notre disposition pour ainsi dire. C’est en cela que réside
le mystère de l’amour du Dieu trinitaire qui exige de nous une réponse.
L’enfant de Bethléem est l’offrande, le sacrifice de l’amour divin offert sur
l’autel du monde créé. Le livre de l’Apocalypse nous parle de l’agneau immolé
dès la fondation du monde (Ap 13,8) : le Christ théanthropique est dans la Trinité dès la fondation du
monde, mais ce mystère nous est révélé dans toute sa plénitude en un temps
historique opportun : « lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a
envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4,4).
Ainsi le Christ, deuxième personne de la Trinité, est le prototype,
l’archétype de l’homme que « Dieu créa à son image, selon sa
ressemblance » (Gn 1,26). Et ce qui est admirable c’est que Dieu, dans son
incarnation kénotique assume en lui-même
sa propre image ; Dieu se fait à l’image de l’homme non seulement pour le
sauver (rédemption), mais de plus pour le parfaire, parfaire sa création
(christification, déification). C’est le regard fixé sur ce but, sur cet
archétype de l’homme, le Christ glorieux qui s’est fait à l’image de sa
créature, affirme Maxime, que « Dieu a appelé à l’existence toute chose ».
[1] Notons en passant que les tirets entre les mots, distinguent et unissent en
même temps les termes par ailleurs indissociables.
[2] Lorsqu’on affirme le mystère
de la pleine humanité du Christ il faut considérer cette humanité
(anthropologie) qui est mystère, ne l’oublions pas à partir de la
divino-humanité, de la théanthropie du Seigneur (christologie). Il ne faut pas
faire le contraire et contempler les choses en envers : le mystère de la
divino-humanité du Seigneur (christologie) à partir de l’humanité seul, en
général, in abstracto (anthropologie), car il s’agit toujours de l’humanité personnelle, propre, que le Fils éternel s’est créé pour lui-même.
[3] Dans l’expression « ontologie du mystère », il ne
faut pas entendre le génitif ni comme objectif ni comme substantif, mais si
l’on peut dire, comme génitif d’identité.
[4] A. Riou, Le Monde et
l’Eglise selon Maxime le Confesseur, Beauchesne (coll. Théologie historique
n° 22), Paris 1973, p.95-96.