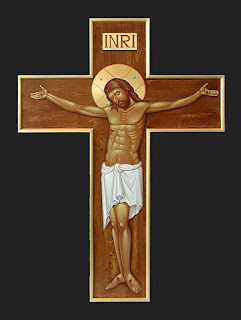La création de l'univers et de l'homme
La création de l'univers et de
l'homme :
enjeux et problématiques contemporaines
enjeux et problématiques contemporaines
Vos Éminences, révérends Pères,
Mesdames et Messieurs, chers Amis
C'est un honneur pour moi de me trouver ce soir parmi vous,
invité par la Faculté de théologie orthodoxe Saint Jean Damascène de
l'Université de Balamand. C'est une joie aussi de me trouver à Beyrouth, au
Liban, dans un pays que je ne connaissais pas personnellement mais que je
sentais et chérissais depuis de nombreuses années à travers le regard aimant
des amis très chers.
La causerie de ce soir portera sur le sens chrétien de la
création de l'univers et de l'homme et ses retombées, mises en rapport avec des
problématiques contemporaines majeures. Je commencerai (1) en précisant mon
point de vue et ma situation herméneutique concrète. Par la suite (2)
j'essayerai de tracer l'historique de la question dans ses retombées pour la
pensée et la culture. Successivement (3) je m'efforcerai d'analyser le contenu
des termes mêmes qui figurent au titre de notre causerie. Que veut dire
"création", que veut dire "homme" et "monde" dans
la perspective qui est la mienne et comment leurs relations sont-elles
envisagées sous l'angle de la liberté ? Finalement (4), il sera opportun de
conclure avec des brèves considérations sur les retombées d'une telle approche
à des questions majeures, brûlantes et actuelles, concernant l'existence du
monde et de l'homme : à des questions de l'écologie et de la bioéthique. Car il
est constaté l'existence, à un niveau mondial, d'un intérêt croissant pour le
monde de la nature. Et ce en raison du développement spectaculaire des sciences
physiques d'une part, et de l'inquiétude inspirée par la destruction de
l'environnement naturel d'autre part.
Toute approche d'une réalité donnée ne saurait être que
particulière. Et la particularité d'un point de vue conditionne forcément le
contenu de cette approche et de nos affirmations. Nous, les êtres humains,
situés à chaque fois dans l'espace et dans le temps qui sont les nôtres, situés
là chacun à sa façon de manière personnelle, nous ne pourrions jamais porter un
regard universel sur la réalité. Cela ne doit faire mystère pour personne. Mais
si nos considérations et nos regards sont existentiellement partiels, pour
éviter l'écueil d'un particularisme clos et narcissique, ils se doivent d'être
ouverts à d'autres approches existentielles semblables dans l'espace et dans le
temps ; d'où l'enjeu du dialogue dans la tradition. Tel est mon souhait pour ce
soir : inviter à la réflexion et au dialogue dans l'ouverture à l'autre.
1. Le présupposé existentiel de
compréhension de la création sera la conscience ecclésiale d'être en présence
du projet grandiose de Dieu pour le monde et pour l'homme tel qu'il se
donne, se révèle, à nous en Christ. Ce projet créateur —le fruit de l'Amour
éternel de Dieu trinitaire, le fruit vivifiant et facteur de communion porté
par Sa visée de l'ultime, par son souhait pour ainsi dire éternel— constitue le
cadre, ou plutôt le prisme, à travers lequel j'envisagerai "celui qui est à sa ressemblance",
l'homme créé "à l'image de Dieu", ainsi que l'environnement de
l'homme, le monde "de Dieu". Mais comment pourrais-je, en tant que
chrétien, envisager la création du monde et de l'homme et leur destinée dans le
souhait de leur Créateur —le but des créatures— si ce n'est que dans
leur re-création eschatologique et fondatrice —sacramentelle dans l'histoire—
en Christ ressuscité ?
De quel point de vue considérerai-je ici la création
de l'univers et de l'homme, l'univers et de l'homme en tant que réalités créées
? Comment entendrais-je cet être-créature que l'homme et le monde constituent
ensemble ?
Je vous le dis d'emblée : ça sera d'un point de vue de la foi
biblique —où la notion d'être-créature (de l'homme et du monde)
renvoi à celle d'être-créateur (de Dieu)— et notamment dans sa relecture
chrétienne. D'où l'importance primordiale de l'expérience de la
résurrection d'une vie corruptible en elle-même dans le Ressuscité d'entre les
morts, et celle de la nouvelle création qu'est l'Église ; l'Église dans sa
profondeur ultime, sacramentelle, bien entendu, et non pas dans sa surface
sociologique et contradictoire ...
Et parce que je vis dans une société post-médiévale,
c'est-à-dire moderne, dans une société dite sécularisée, post-théiste,
mon approche biblico-chrétienne ne sera ni "religieuse" (théiste) ni
"anti-religieuse", c'est-à-dire en opposition dialectique contre la
religion (anti-théiste).
Je suis persuadé qu'une vision biblique
spécifiquement chrétienne du sens de l'homme et du monde comme réalités
créées, une approche à la fois saine —c'est-à-dire orthodoxe dans le
sens étymologique du terme— mais aussi contemporaine à nous, ne pourrait
qu'être christique et non métaphysique (située par rapport au
théisme). Une telle vision s'efforcerait de dire les choses dans l'ouverture
infinie de la résurrection eschatologique (instaurée dans le Ressuscité) et
ne serait par conséquent ni sous l'emprise du sacré et de sa violence, ni
non plus sous l'emprise du profane et de son
"in-différence" (la non-différence où tout vaut également). Une
approche christique telle que je l'entends ici ne pourrait être ni positivement
théiste (sur la base du sacré), ni négativement théiste, anti-théiste (sur la
base du profane), ni non plus située entre les deux. Elle se devrait d'être
frayée à partir de l'ultime (eschaton)
résurectionnel qui nous advient du futur, de la Parousie qui constitue
l'au-delà de Dieu pour nous. Parce qu'une approche christique de l'être
du créé comme celle ici ébauchée se fonde à partir de l'extériorité de
Celui qui tout en s'incarnant au plus profond de notre histoire ne cesse de la
dépasser en avant, la vision en question du monde et de l'homme connote
une structure communionnelle de l'être créé —dans les personnes
uniques-et-libres en Christ — et se situe en dehors aussi bien du sacré
totalisant (qui fait référence à une structure théiste et totalisante de
l'être créé) que du profane "in-différent" (en référence à une
structure anti-théiste et nihiliste de l'être créé), comme en dehors de leur
opposition dialectique. Permettez-moi à ce point de m'expliquer ultérieurement
sur cette approche christique de l'être.
2. Dans une vision théiste des
réalités, le monde, l'homme et Dieu Lui-même —réalités relationnelles—
apparaissent, dans le jeu de leurs relations (la "Liturgie
cosmique"), comme des réalités dont l'existence est nécessaire en
elle-même. Ils constituent ainsi des existences physiques (monde, homme) ou
méta-physiques (Dieu), naturelles ou super-naturelles, relatives ou absolues.
Mais leur être relationnel —absolu ou relatif, peu importe ici— est en tout
cas nécessaire et non pas libre et corrélativement la liberté n'est pas
constitutive de leur être. Même dans la meilleure des hypothèses, la liberté ne
constitue pour leur être qu'un surplus. Au sein de cette nécessité ontologique,
de cette structure ontologique de la nécessité, il y a certes une
différentiation : l'existence relationnelle de Dieu est une existence
nécessaire et absolue, tandis que celle, également relationnelle, du
monde et l'homme est nécessaire et relative (car elle dépend de celle de
Dieu). Mais —j'attire ici votre attention— cette différentiation entre l'être
absolu (Dieu) et les êtres relatifs (créatures), s'inscrivant en tout cas au
sein d'une nécessité onto-existentielle commune pour tous, pour les uns comme
pour les autres, elle ne peut qu'instaurer entre eux une structure ontologique
close et totalisante, un cercle de nécessité métaphysique. Ici l'existence et
l'être de tout ce qui existe, s'identifie à lui-même. Nous avons ici ce que
l'on appelle une vision "close" de l'être des étants (ontologie
close) : une vision où l'altérité des étants (de l'autre homme, du monde, de
Dieu et après tout la mienne) est toujours relative et jamais absolue
(altérité relevant du paraître et non de l'être comme tel), où la liberté
des étants est toujours limitée et non fondatrice de vie (liberté
relevant du bien-être et non de l'être comme tel). Mais alors comment une nécessité
d'être —absolue ou relative peu importe— pourrait-elle ne pas relativiser l'altérité
et la liberté d'être (pour Dieu, l'homme et le monde) en leur supprimant
la racine, à savoir le substrat (hypostasis)
? Dans une telle optique des choses, toute unicité et toute liberté —celles de
Dieu, de l'homme et du monde—, privés de leur assise ultime (hypostasis), ne peuvent qu'être
finalement récupérées et normalisées au profit du "même" et de la
"totalité" dans une structure narcissique et violente du
"sacrée" : le sacré ou l'absolu —c'est ici la même chose— de la
réligion et du monde, le sacré ou l'absolu de la société (valeurs) et des
sciences (exploits). La question n'est pas négligeable lorsque l'on la
considère dans ses retombées pratiques, spirituelles et culturelles.
Comment, notamment, dans le cadre d'une vision "close"
de l'être des étants (ontologie close), sous l'angle d'une structure théiste de
l'existant, la "Seigneurie" de Dieu —la Seigneurie du Créateur
qui sauve, selon la foi biblique— pourrait-elle ne pas être perçue comme
intrinsèquement frustrante et pratiquement inhibitrice de la "liberté"
de l'homme ? Comment, dans une telle vision close (et hiérarchique) des choses,
Dieu pourrait-il ne pas représenter l'enfer de l'homme ? D'où le renversement
du théisme (traditionnel) en anti-théisme (moderne), renversement prophétique
pour la théologie car il peut ouvrir sur un a-théisme authentique selon
l'Esprit du Christ. Et révéler ainsi que si Dieu est "Seigneur" ce
n'est qu'en se donnant, en s'abandonnant réellement en Christ dans l'Esprit.
Car ce n'est que dans sa liberté de communion que Dieu "règne"
sur nous. Et ce afin de nous offrir, toujours à nouveau, l'assise ontologique
véritable et ultime de notre liberté dont on a tellement peur (tout en étant
fascinés) : de notre terrible liberté face à Lui comme face nous-mêmes et aux
autres. C'est cela l'essentiel, me semble-t-il, d'une approche christique (ni
théiste, ni anti-théiste) de la "Seigneurie" du Créateur et de la
"liberté" de la créature, telles qu'elles se révèlent dans le
Ressuscité et telles qu'elles sont constamment attendues jusqu'à la Parousie.
Permettez-moi de le répéter : dans une optique théiste (positivement ou négativement) des choses,
les êtres, en eux-mêmes ainsi que dans leurs relations, ne pourraient ne pas
être : ils n'auraient qu'à être —tout simplement— puisque leur existence
(leur être) n'est qu'égal à soi-même (être=être). C'est ainsi que le monde,
l'homme et partant Dieu Lui-même ne pourraient ne pas être, n'étant pas libres
dans leur être même, n'étant pas libres à être. Dieu, l'homme et
l'univers ne devraient qu'exister forcément, surs de leur existence mais aussi
prisonniers de leur existence, de leur être, prisoniers aussi de leur ennui
ontologique. Et peu importe ici la différence, pour ainsi dire quantitative
au niveau de l'existence, entre un être absolu de Dieu et un être relatif de
monde et de l'homme (dépendant de Dieu).
Il est certes facile d'inverser cette vision sacrée,
théiste et religieuse des choses en son contraire : dans une vision de la
profanation (du sacrée) des choses, anti-théiste et anti-religieuse, où
l'homme et le monde pour être libres dans leur être, dans leur existence, se
doivent de supprimer ce Dieu sacré ; ce Dieu religieux et théiste, le Dieu
parfaitement stable en son être (mais pour cela prisonnier de sa stabilité), le
Dieu de l'être narcissique dont la "Seigneurie" sur toute créature
constitue, croit-on, le danger primordial pour l'homme. Et la
"Seigneurie" contre la "liberté" se renverse en une
"liberté" contre la "Seigneurie". Car, si dénoncer une existence
prétendue nécessaire de Dieu constitue paradoxalement un témoignage prophétique
de la foi biblique —et de la liberté de l'être— dans notre histoire
spirituelle, il ne fait mystère pour personne que ce renversement anti-théiste
de l'être du monde et de l'homme —par suppression de celui de Dieu— est
finalement suicidaire pour l'homme et pour le monde. Et précisément pour leur liberté
d'être. Car si, dans l'espace d'un jeu de réalités supposées nécessaires
(Dieu, homme, monde) je supprime la première réalité, je ne pourrais aboutir
qu'à la seule émancipation de deux autres (de l'homme et du monde) et
non pas à l'affirmation et à la sauvegarde de leur liberté. Je peux être
émancipé de toi en te supprimant mais pour être libre en moi il
me faut autre chose : il me faut une assise ultime (hypostasis) de liberté. Mais d'où la recevrais-je ?
Telle est brièvement notre situation spirituelle dans les
sociétés post-médiévales, les ex "sociétés chrétiennes"
(post-théistes), en Occident comme en Orient. Et puisque nous avons déjà assuré
pour nous-mêmes l'émancipation d'un Dieu ontologiquement frustrant —d'un
"Dieu pervers" (M. Bellet)— la requête majeure pour nous est
l'assurance et la recherche d'un fondement ultime (hypostasis) pour notre liberté ontologique, la liberté d'existence.
Car si, ne plus être gênés —grâce à Dieu— par ce Dieu fantoche et ses
manifestations multiples est pour nous une réalité historique, cela ne veut pas
dire pour autant que nous soyons libres, tout court, dans notre existence même.
Et la recherche d'un tel fondement pour la liberté d'existence de l'homme et du
monde nous amène à reconsidérer —de manière christique, je le crois fortement—
ce que l'on appelle la vision biblique de la "création" de
l'homme et du monde (c.à.d. des créatures), ayant en vue une problématique conjointe
: la "Seigneurie" (du Créateur) et —simultanément— la "liberté"
(de la créature). Nous sommes à le requête d'une approche du sens de Dieu, de
l'homme et de l'univers —associée à une vision de leurs relations— tels qu'ils
se donnent en Christ ressuscité. C'est cela que j'appellerais volontiers
l'orthodoxie christique de la foi apostolique et patristique ;
orthodoxie dont l'Orient chrétien a la vocation d'être, me semble-t-il, le
témoin principal (mais pas exclusif, espérons-le).
En parlant d'orthodoxie christique de la foi (apostolique,
conciliaire et patristique) je me permets d'attirer votre attention sur un
point de première importance. Il est tout à fait possible d'envisager
"Dieu", le "monde" et l'"homme", en eux-mêmes et
dans leurs relations, mais abstraction faisant de l'expérience croyante et de
son témoignage biblique. Il est aussi possible —dans le langage de la foi, au
sein de nos théologies chrétiennes— d'envisager le Créateur et ses créatures à
partir de l'histoire de la Bible —avec ou sans l'aide de la philosophie—
dans une approche progressive et linéaire du témoignage biblique (de A à Z) de
la Genèse à l'Apocalypse. Là le Christ —ou plutôt l'événement Christ— ne
constituerait qu'une parmi d'autres manifestations bibliques de Dieu —certes la
dernière et la plus parfaite, la manifestation par excellence— mais non pas le prisme
structurant comme tel de notre lecture de l'histoire biblique et de notre
approche des réalités "Dieu", "homme", "monde".
Or une lecture, spécifiquement chrétienne, de ces réalités
ne pourrait se faire qu'à partir du Christ, du Christ ressuscité dans le
Royaume de Dieu, comme grille de lecture de l'histoire du salut relatée dans la
Bible et l'histoire de l'Eglise. Une lecture christique des réalités bibliques
et ecclésiales —avec ou sans l'aide des catégories philosophiques, ce n'est pas
ici l'enjeu de la question— ne pourrait qu'être typologique —c.à.d.
prophétique en Christ et non pas historiciste— à la manière de saint Paul et de
l'expérience de la communauté primitive des croyants. Cela veut dire une
lecture de l'histoire certes biblique mais précisément en tant
qu'histoire du salut ; et d'un salut eschatologique présent dans
l'histoire, ici et maintenant par "anticipation proléptique". Une
lecture de l'histoire du salut donc, non pas de A à Z (des origines à la fin,
de la Genèse à l'Apocalypse) mais inversement : une lecture à partir de la
fin, à partir de la plénitude du salut —qui est la réalisation du
Royaume de Dieu dans notre histoire, attendu et offert, offert et attendu,
anticipé dans le Christ ressuscité— et vers les origines de la création
et de l'histoire de l'homme et du monde.
3. Que veut-il dire "création"
dans une telle perspective de salut en Christ ? Que signifie-t-il en théologie
chrétienne le terme "créer" aussi bien pour le "Créateur"
que pour Ses "créatures" ? Le sens de ces termes ne va pas de
soi et il a des retombés importantes pour le sens de l'existence, pour l'être
non seulement de l'homme et du monde (c.à.d. des "créatures") mais
aussi pour celui de Dieu (le "Créateur"). Car, même dans notre
langage trivial, créer connote une activité affectant l'être : aussi bien de la
réalité nouvellement créée (v. l'œuvre d'art) que de celui qui en étant l'agent
s'exprime dans sa création (v. l'artiste).
Il est certes connu que selon l'expérience ecclésiale du
salut (dans la foi au Ressuscité et simultanément dans l'attente
de Son Royaume) le sens du monde et de l'homme comme créatures de Dieu
s'exprime à travers le dogme de la création "à partir du néant".
Et comme il a été justement observé, cette formulation demande aujourd'hui une
plus grande attention puisqu'il interprète, de la meilleur façon possible, la
menace du néant contenu en germe dans la crise écologique.
Les créatures, à savoir l'homme et le monde, puisqu'elles
sont des créatures créées, des créatures d'un Autre (de leur Créateur)
et non pas cet Autre lui-même (leur Créateur), portent le sceau
indélébile —dans la racine de leur être même— de leur altérité dans
l'être. Et du fait qu'elles "sont créées" par la libre volonté de cet
Autre qu'elles (et ne y "sont" pas tout simplement), elles portent
aussi la marque de leur contingence dans l'être. Pour être, les
créatures doivent s'ouvrir à leur Autre et entrer en communion
avec Lui. Leur existence dépend de leur communion en ouverture à Celui qui,
face à elles et en dehors d'elles, les crée et les aime. Le saut en dehors
d'elles, et vers l'Autre qui les crée (le Créateur), constitue la seule
et unique manière d'être pour les créatures. Bien entendu, leur ouverture et
leur saut est toujours précédé par l'ouverture et le saut —primordiaux—
d'amour et d'abandon de Dieu-Autre en dehors de Lui-même, le saut fondateur de
l'existence des créatures. Le saut de Dieu en dehors de Lui et vers l'autre que
Lui par delà l'abîme d'un "absolument rien", du "rien du tout"
dans le sens le plus profond des termes "rien" et "tout"
(dans leur neutralisation réciproque).
Or puisque les créatures sont créées par la pure grâce de Dieu
(c.à.d. à partir de "rien du tout", seulement par grâce), elles
portent à jamais dans leur être la marque de ce "rien du tout" (néant
absolu) d'où elles sont constamment et librement tirées par l'amour gratuit et
libre de leur Créateur. Dans l'optique de cet événement de création des
réalités autres, toute confusion au niveau de l'être entre le Créateur
et ses créatures, comme toute réserve au même niveau face à la pure
grâce du Créateur qui les crée sont impossibles. Car entre Dieu et ses
créatures il n'y a pas qu'une différence quantitative ou qualitative d'être
mais bien plutôt la discontinuité absolue et radicale dans l'être. Création,
ainsi, signifie donation d'être et non pas possession d'être :
donation dans l'abandon (de la part du Créateur) et acceptation dans la
dépossession (de la part de toute créature). Dans la folie d'amour que l'acte
de créer représente pour Dieu —tel que nous le contemplons en Christ—, un néant
absolu et impensable, le pure "rien du tout" s'interpose entre Son
être et celui de Ses créatures. Dans la foi en la résurrection d'entre
les morts, dans la foi en la création nouvelle et éternelle, l'être
comme tel se révèle radicalement discontinu, et ce de manière absolue.
Entre la mort du Christ selon la chair et Sa résurrection par le
Père dans l'Esprit une rupture ontologique s'interpose : la rupture qu'il ne
faut jamais minimiser sous peine de relativiser aussi bien l'absurdité
de la mort que la puissance de la résurrection. C'est la raison pour
laquelle —disaient les Pères— si l'on affirme que Dieu "existe", si
l'on attribue l'être proprement à Dieu, il faut simultanément dire que les
créatures ne sont pas ; et vice-versa. Il n'y a pas de continuité, de
simultanéité ontologique entre le Créateur et les créatures mais l'abîme du
néant et la gratuité de l'amour.
Si le créé a le néant d'être comme nature, ce
n'est que parce qu'il reçoit constamment la grâce d'être comme don.
Si les créatures existent ce n'est que par un saut libre et gratuit du
Créateur, un saut d'amour —d'amour ontologique et non pas d'amour affectif— en
dehors de Lui-même, dans le néant de ses créatures. Ce saut, le saut d'amour
créateur du Père en Christ dans l'Esprit, constitue un don de la vie de Dieu
pour la vie du monde, le don de Sa vie propre pour des autres que Lui vivent,
un don gratuit dont l'acceptation libre —dans la dépossession
constante et permanente— constitue la vocation ontologique de la créature et
notamment de l'homme pour la vie de tout être créé. Cette attitude ontologico-existentielle de dépossession
dans l'acceptation de la grâce d'être ne doit jamais être oubliée. Pour toute
créature l'être relève du don de Celui qui l'offre dans la dépossession de la
créature qui le reçoit.
C'est ainsi que, en Christ ressuscité, l'existence du créé
ne constitue pas une fin en soi puisqu'elle trouve son fondement, son
accomplissement et son sens dans sa relation ouverte avec Dieu : dans la
communion libre des créatures avec leur Créateur —par l'intermédiaire de
l'homme et dans l'amour de l'autre—, dans cette communion qui se réalise par
notre participation à l'humanité du Christ. Le créé, en tant que créé à
partir du néant, ne trouve ni contenu, ni assise, ni être, ni vie que dans
l'amour de Dieu lors de la résurrection du Christ, dans l'abandon éminemment
actif —en Christ— de l'être sur la croix. Ainsi toute la création peut exister,
trouver cohésion dans l' "être" et participer au "toujours
bien être" que Dieu lui destine : la vie incorruptible du Ressuscité dans
le Royaume.
C'est cela la vocation de l'homme pour le salut du monde et
celui de son humanité, telle que nous la contemplons dans l'humanité parfaite,
celle du Christ : tout recevoir et tout offrir, récapitulé, à Dieu. L'homme
créé libre —selon l'image de Dieu— est l'intendant de la création, de
l'environnement naturel et de soi-même d'abord, il est le prêtre de la création
entière. Et sa prêtrise consiste à accepter et à offrir le défiguré (par la
chute) —soi-même et l'univers— pour le recevoir à nouveau d'entre les mains de
Dieu comme transfiguré, comme réalité provenant de la nouveauté eschatologique.
Toujours à nouveau, jusqu'à la venue du Seigneur et jusqu'à l'accomplissement
définitif du Royaume. C'est la mission de chacun de nous —en Christ— la mission
ecclésiale, mission ascétique de dépossession de soi et de reception de
l'autre, mission sacerdotale de donation du don et de création de la nouveauté
à l'image de celle du Royaume qui vient.
Permettez-moi d'insister ici sur le sens eschatologique
de la "nouveauté". Je ne parle pas ici d'une création des choses
"à nouveau" (ce qui connoterait une vision cyclique du temps et de
l'histoire) mais d'une réation de réalités "nouvelles", inédites.
C'est cela qui correspond, me semble-t-il, à une vision biblique du temps et de
l'histoire : une création en Christ —avec du courage, dans l'ascèse et en
assumant le défi du risque— de choses nouvelles, de gestes nouveaux, des termes
nouveaux ... C'est le sens "selon le Christ" et orthodoxe —non pas
"selon le monde" et hétérodoxe— du terme "innover" (kainotomein). Car les hérétiques de tous
temps sont tels, non pas à cause de leur geste innovateur dans leur refus de
répéter le passé mais, bien plutôt, à cause de l'échec de leurs innovations,
incapables de viser et de montrer le seul qui compte : l'anticipation du
Royaume dans le Christ ressuscité et l'attente de la plénitude ce Royaume dans
l'Eglise, l'attente active —et non passive— dans l'Esprit. Et cette remarque
nous introduit à notre dernier point.
4. C'est dans cette perspective de la
nouveauté eschatologique que l'Église ne pourrait que se réjouir de tout succès
humain, et notamment des succès scientifiques de l'humanité. Elle observe une
attitude particulière de révérence, d'attention et de vigilance devant les
moyens de recherche et les applications de la mécanique génétique actuelle, de
la biomédecine ainsi que de la biotéchnologie et désire la fondation d'un
dialogue substantiel. Elle considère que la responsabilité pour soulager
l'homme accablé lui est commune avec les sciences. Cependant, l'Église ne
pourrait s'empêcher de rappeler que "tout ce qui abolit le respect dû à la
création en tant que miracle de l'amour et de la liberté de Dieu, aliène le
critère biblique et patristique des vérités éthiques, trouble les relations
humaines, limite le libre-arbitre et dévalorise l'unicité de la personne".
Les succès scientifiques qui soulagent la peine de l'homme
et qui favorisent la santé de son corps, allongent sa vie et améliorent la
qualité de l'existence humaine, sont réellement des dons de Dieu en faveur de
l'homme. Mais ces succès ne pourraient pas justifier des excès qui
restreindraient l'horizon et la perspective du salut de l'homme et du monde, la
"christification", l'achèvement de la transfiguration, de l'homme et
du monde, en "Christ".
La "vie éternelle" est la vie non pas immatérielle
mais, bien plutôt, la vie eschatologique, la vie du royaume de Dieu, la vie qui
ne meurt plus, la vie indestructible, celle du Ressuscité. Après la
résurrection du Christ, et dans l'effusion de l'Esprit, le don de cette vie
commence dans l'histoire et ne trouvera son accomplissement que "dans
l'eschaton", lors de la résurrection finale. Par la participation
sacramentelle à l'humanité du Christ —l'humanité complètement transfigurée—
dans l'eucharistie notamment, le temps de l'histoire devient le lieu de la
rencontre avec le Royaume à venir. Le "maintenant" salvifique du
royaume de Dieu nous est paradoxalement offert "en Église", c.à.d.
dans ce Corps mystérique —et non simplement sociologique— dont le Christ est la
tête. Si ce "maintenant" nous est constamment offert dans
l'eucharistie —dans la foi, l'espérance et la charité— le "toujours" de l'Église existe dans le royaume de
Dieu, dans "les siècles des siècles" de Dieu. La vie présente n'est
pas seulement une préparation en vue de la vie attendue, l'incorruptible ; elle
est d'abord participation à celle-ci dans la foi et dans la charité
— la participation sacramentelle à l'humanité du Christ—, dans l'espérance
et dans l'attente constante et vigilante de Son Royaume. Plus l'homme
observe le commandement double de l'amour —envers Dieu et envers l' "autre
homme"— plus il fait disparaître son égocentrisme et ses peurs. C'est
ainsi qu'il pourra trouver son véritable visage, sa propre personne, dans
l'ouverture et la rencontre de l'autre, dans la pleine acceptation de son
altérité (face à la sienne) et dans la communion (avec lui). Il n'est pas
superflu de signaler que, contrairement à toute "union" de type
communautariste, le terme "communion" (koinonia) connote ici l'ouverture, la confiance et l'abandon ; non
pas l'autosatisfaction, la peur et le repli sur soi-même.
L'accomplissement de l'homme en tant que personne —réalité
relationnelle unique et libre à l'image du Christ— se réalise dans l'expérience
même de la communion du genre humain en Christ, selon ce mode d'unité dans la
communion qui est propre aux trois hypostases personnelles, de Dieu trinitaire.
L'exemple véritable et authentique d'une telle expérience vécue de
l'incorruptibilité de la vie est l'existence des saints. C'est par eux que nous
apprenons que la recherche de l'incorruptibilité éternelle, la recherche d'une
vie unique et libre qui ne meurt plus, conduit l'homme à ne plus craindre la
mort comme fatalité mais à l'accepter librement —pour qu'elle soit dépassée
dans le Ressuscité— et à se réconcilier ainsi avec la création toute entière.
Par ailleurs, non seulement l'homme, mais la création entière, aura part au
royaume trinitaire de Dieu en tant que
création nouvelle en Christ.
Se fondant sur les présupposés théologiques ci-dessus
énoncés, la théologie ecclésiale est en mesure de dialoguer sans préjugés avec
les sciences appliquées et, en collaboration avec elles, d'apporter des
réponses à des questionnements qui ont déterminé les contestations sociales, celles
par exemple, qui concernent le processus de la reproduction humaine.
On pourrait difficilement contester que le
"mystère" de la vie, depuis le stade cellulaire jusqu'à la formation
d'un organisme composé, tourne autour de la notion
d' "existence". Par conséquent, la gestation est le stade du
développement d'un organisme autonome dès le commencement, d'une existence
humaine, laquelle, d'une manière ou d'une autre, trouvera son accomplissement
dans un stade temporel ultérieur. Par conséquent, l'avortement est certainement
un acte grave à éviter (pour de multiples raisons). Or s'il ne faut pas le
banaliser, il ne faut pas non plus ni le diaboliser. Car la vie humaine ne se
refère pas à elle-même mais elle est la vie d'une personne. La vie humaine n'est
ni profane, ni sacrée comme telle. C'est la vie de quelqu'un, la vie d'un sujet
unique, libre et responsable : face à Dieu et aux autres.
Avec les mêmes présupposés théologiques, des réponses
peuvent être données à d'autres problèmes majeurs de la bioéthique tels que
l'eugénisme, les greffes, le clonage et l'euthanasie. C'est pour cette raison
que la théologie orthodoxe ne pourrait considérer la bioéthique indépendamment
de son enseignement dogmatique. Comme il a été pertinemment observé, il ne peut
y avoir de "bio-éthique" sans "bio-théologie" et notamment
sans une anthropologie sotériologique "selon le Christ" (ni théiste,
ni anti-théiste).
Vos Éminences, révérends Pères,
Mesdames et Messieurs, chers Amis
A l'heure où le nouveau millénaire commence après la clôture
du plus terrible et du plus énigmatique des siècles où à l'annonce de la mort
de Dieu a succédé la mort de l'homme, où les idéologies du bonheur ont provoqué
génocides et massacres sans nombre, où le progrès a engendré une corruption
sans précédent du monde naturel, il revient aux chrétiens, plus que jamais,
d'annoncer et de défendre le sens christique de la Création et le sens eucharistique,
liturgique, des sciences. La déification de l'homme —à savoir sa pleine et
définitive christification— ne pourrait être réelle sans la transfiguration de
l'univers. Les deux vont de pair et ne se réalisent qu'en Christ. Le salut
accordé à ce microcosme qu'est l'homme se répand sur le macrocosme, sur le
monde. Dans le mystère pascal, l'exaltation glorieuse de l'humanité en Christ
devient glorification du cosmos en l'homme.
Aucun de progrès scientifiques de nos
jours ne relève en soi de Dieu ou du Diable. Le discernement éthique ne
pourrait se faire qu'à partir de l'utilisation qui en est faite. Toute entreprise
humaine est sujette à discernement dont la règle s'avère
"pneumatique" et se mesure à la mesure du Christ. L'Orthodoxie ne
pourrait, me semble-t-il, ni être ni embarrassée d'une conception scolaire
(c.à.d. non-christique) de l'humanité de l'homme (dont la vérité ultime
relèverait de l'ordre de la nature) ; ni non plus d'une lecture historiciste
(c.à.d. non-typologique) de la tradition ecclésiale, biblique ou
patristique (dont la vérité ultime relèverait de l'ordre de l'histoire). La vérité
de l'homme —et du monde dans l'homme— se mesure à partir de celle
—personnelle par excellence— du Christ ; et la vérité de la tradition
ecclésiale —eschatologique dans l'histoire— se mesure à partir de celle du
Royaume. L'Orthodoxie a donc le devoir d'appliquer son propre jugement
—inhérent à son expérience de la résurrection— sur ces réalités. Et en domaine
d'éthique notamment, elle a une sorte d'obligation de signifier le primat
absolu de la liberté personnelle et de la grâce eschatologique.
Mais s'il s'agit bien de rendre compte de la foi qui est en
nous, nous ne pouvons pas le faire sans nous confronter au désespoir et aux
attentes de humains. Pour ce faire, nous devons pleinement accepter avec
confiance leur altérité —et partant celle de Dieu— avec ce que l'altérité
personnelle implique : la reconnaissance de la liberté —en nous-mêmes comme aux
autres— dans le respect gratuit et l'ouverture communionnelle : l'ouverture à
l'autre qui appelle à la communion. Et ce en attendant "des cieux nouveaux
et une terre nouvelle dans lesquels la justice habite" (2 P 3,13).
Je vous remercie de votre accueil et de votre attention.
PUIBLIE DANS St. John of Damascus Institute of Theology, University of Balamand - Annals
4-5 (Academic Years 2001, 2002, 2003), p. 249-261