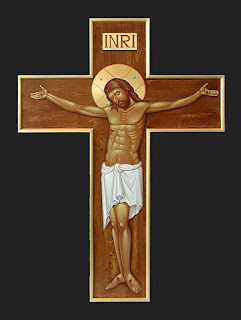Foi et Sciences (Unesco)
UNESCO – Paris
Colloque
« Sciences et théologie orthodoxe »
Foi et
Sciences
les conséquences du dogme biblique de la Création
Dr. Konstantinos Agoras
Le propos d'aujourd'hui
porte sur une question épineuse et urgente pour l'Eglise et le Monde dans
l’histoire et en particulier dans la modernité : les rapports entre Foi
chrétienne et Connaissance scientifique.
Le sujet est évidemment
vaste et complexe. Pour l'illustrer mon sujet je me propose de l'aborder en
considérant le rapport entre Foi et Science, ou plus précisément entre
« foi croyante » et « monde scientifique » à l'aide de deux
paradigmes : le paradigme de la tradition occidentale, moderne et
médiévale et celui de la tradition patristique, grecque en particulier au sujet
de la compréhension de la Création.
Dans l'Occident moderne,
le rapport entre Foi et Science s'est souvent posé —en regard du dogme biblique
de la Création notamment— à l'aide d'une alternative : "Création ou
Évolution ?" Et par ce type d'interrogation, on ne pourrait que constater
une divergence foncière dans la conception de la Foi et de la Science.
C’est ce que l’on appelle une vision éclatée lorsque nous nous référons à la
Modernité.
Pour la Tradition
patristique et orthodoxe par contre, telle qu'on peut la considérer à travers
les écrits des Pères cappadociens notamment, une telle divergence foncière
n’aurait pas de sens. Telle que l’on constate à travers leurs écrits, les Pères
avaient une vision convergente de la Foi et de la Science. Et compte tenu de
leur attitude face aux connaissances scientifiques de leur époque, telle que
l’on constate dans leurs écrits, notre question paradigmatique portant sur le
dogme de la Création et la théorie de l’Évolution recevrait par eux une réponse
dialectique : "Création et évolution". Pourquoi ?
Parce que les Pères, me
diriez-vous, vivaient justement dans une autre époque, pré-moderne, quand la
Foi et la Science convergeaient entre elles. Cela est indéniablement vrai, mais
la question porte justement sur le "pourquoi" et sur le
"comment" de cette convergence.
La réponse à cette
double question comporte un volet historique et culturel et un volet
théologique et spirituel. Et, je le dis dès maintenant : le fait que
l'opposition majeure entre Foi et Science s'est manifestée, en pleine
Modernité, à propos précisément du dogme de la création, cela ne me semble pas
être un effet du hasard.
1. La science
moderne émerge avec la sortie du Moyen-Age occidental. D’une époque où
l’équilibre, parfois instable, entre Foi et Connaissance (philosophique et
scientifique) était assurée par les grands scolastiques. Mais cet équilibre
était assuré au prix de la reconnaissance, au sein de l'Occident médiéval,
d'une double vérité : la vérité de la révélation (comme
vérité supérieure) et la vérité philosophique et scientifique
(comme vérité inférieure). Il s'agissait donc d'une synthèse
hiérarchisée de manière théocratique, une synthèse effectuée par une soumission
de la Culture profane à l'Eglise, par une soumission —et non pas par une transfiguration—
de la Connaissance philosophique et scientifique, à la Théologie.
Avec l'avènement de la
Modernité, cette situation théocratiquement hiérarchisée se retourne contre
elle-même et la synthèse entre Foi ecclésiale et Connaissance humaine se brise.
La Connaissance philosophique et scientifique se constitue contre la Révélation
et la Théologie. Le dogme de la foi et la connaissance scientifique s'opposent
désormais entre eux. Et la question à propos de la Bible et de la Science, à
propos du dogme de la Création et de la théorie de l'Évolution ne pourrait que
se poser comme alternative : "ou bien Création, ou bien Évolution".
Autrement dit : La
hiérarchisation théocratique de la double vérité du Moyen-Age —constitué
comme vérité supérieure (dogme) et vérité inférieure (connaissance)— se
renverse : suite à quoi le rapport des deux vérités se brise. La vérité
philosophique et scientifique, auparavant inférieure par rapport à la vérité
dogmatique, se constitue désormais contre les dogmes, prétendant parfois à une
vérité supérieure. Phénomène moderne auquel nous assistons tous. Et il ne faut
pas oublier que la dislocation initiale entre philosophie et science, d’une
part, et théologie d’autre part, risque de se poursuivre ultérieurement dans
une dislocation secondaire par rapport à l’originaire, celle entre science et
philosophie.
Double vérité au Moyen-Age donc, « naturelle » et
« sur-naturelle », structurée par une unique connaissance
ascendante, du « nature » au « sur-naturel » et
hiérarchisée comme valeur dans la direction opposée : du
« sur-naturel » au « naturel », du haut vers le bas pour
ainsi dire. L’orientation de cette hiérarchie des vérités s’inversant aux Temps
modernes, la connaissance se retourne sur elle-même (chez Descartes). Double
vérité donc, constituée et structurée, par une unique méthodologie, de
manière hiérarchique. C’est cela le plus significatif, et non pas le sens de
l’orientation de la hiérarchie des vérités.
2. On aurait tort à
projeter une situation semblable chez les Pères, grecs en particulier. Pour eux
ce qui était « double » ce n'était pas la vérité elle-même
mais la méthodologie d’accès à la vérité. Double méthodologie de la
connaissance calquée sur ce que le dogme de la Création ex nihilo
affirme : que le Monde, existant par la grâce de Dieu, n’est que comme
créé à partir du néant absolu, de l’inexistence totale et absolue. Créé par
grâce, d’une part, et créé à partir de « rien ». Le deux
propositions vont ensemble dans ce dogme. L’une n’annule jamais l’autre. Car
pour la foi biblique, et contrairement au paganisme, entre l’être du Monde et
l’être Dieu il ne pourrait avoir aucune parenté, le néant absolu (ex
nihilo) interdisant toute « analogie d’être ». La relation donc entre
l’« être créé » des Créatures et l’ « être incréé » du
Créateur n’est ni analogique, ni hiérarchique mais absolument dialectique.
La relation elle-même n’est que pure grâce ; et c’est elle, la relation
d’ouverture réciproque entre Créateur et créature qui constitue l’être pour la
création. Il s’agit bien de la grâce de l’incréé c’est-à-dire de Dieu qui ne
peut qu’être librement reçue par la création créée dans une ouverture,
libre et constante, à Celui qui se trouve de l’autre côté du néant qui la
sépare, du néant absolu d’où elle est constamment tirée, par son ouverture au
Dieu incréé.
Et du coup toute
tentation de chosification de la grâce incréée de Dieu est interdite. Le Monde
dans son ensemble est considéré comme « créature » créée par
Dieu lui-même qui est son Créateur, Lui-même incréé. L’être créé de la
créature et l’être incréé du Créateur ne peuvent que former une dialectique
absolue : ou bien créé/ou bien incréé. Et la relation entre l’être créé de
la créature et l’être incréé du Créateur ne peut qu’être une relation
dialectique au sens absolu : une relation entre la créature et son
Créateur « sans séparation, ni confusion », pour reprendre les
termes du dogme du Concile de Calcédoine traitant précisément de cette relation
entre création et Créateur, parfaitement réalisée en Christ dans la liberté,
l’ouverture, du Saint-Esprit.
Dans cette optique d’une
dialectique absolue, la question de la vérité ne pouvait qu’être approchée
selon une double théorie de connaissance qui structurait la Foi
et la Pensée de manière absolument dialectique dans leur vérité
respective : non pas de manière hiérarchique ou oppositionnelle
mais de manière dialectique et asymétrique ; comme quoi
entre Pensée (philosophique et/ou scientifique) et Foi il ne peut jamais avoir
de concurrence ni d’opposition, ni de synthèse non plus mais d’articulation
dans l’Esprit du Christ. Dialectique symétrique donc car la connaissance est
précédée par la foi, la foi n’étant ni supérieure ni inférieure par rapport à
la connaissance (et vice-versa) mais la foi précède la connaissance.
Elle la précède "selon l'Esprit du Christ", étant incomparablement
autre par rapport à la connaissance "par l'observation du Monde".
Double théorie de la connaissance donc, double méthodologie de
"vérité" qui relie de manière asymétrique et dialectique
la Foi "selon le Christ" et la Science "à partir du
monde".
Après la révolution
copernicienne et son importance historique et symbolique qui signe la sortie
définitive du Moyen-Age, les découvertes suivies du procès de Galilée au 17e siècle marquent l’émancipation de la Science
par rapport à une toute-puissance cléricale et la réponse de celle-ci à
l’outrage d’une désobéissance et le début de la Modernité
« spirituelle », de la Modernité proprement dite. Et si Galilée
réhabilite la valeur et la consistance du Monde, du « naturel »,
considéré auparavant comme inférieur par rapport à un « sur-naturel »
attribué à tort ou à raison à Dieu, la date la plus importante et significative
pour les rapports problématiques (de deux côtés) entre Foi et Science, la date
où le conflit entre « naturel » et « sur-naturel » devient
encore plus intense, est celle par la Théorie darwinienne au 19e siècle. Darwin poursuit à sa manière la
« revanche galiléenne » : la réhabilitation d’un Monde considéré
inférieur par rapport à son Créateur, la justification de la
« nature » du Monde considérée impure et inférieure dans une vision
« surnaturaliste » de la grâce du Créateur.
C'est cette double
théorie de la connaissance articulant dialectiquement la Foi et la Pensée qui
permettrait aujourd'hui aux Pères de dire de manière dialectique et asymétrique,
c’est-à-dire « sans séparation ni confusion »: "et Création et
Évolution" . Et cela permettrait peut-être aussi à la Science de se
constituer comme Science "du monde" (et avec la Foi) et non pas comme
Science "selon le monde" (et contre la Foi). Et à la Sagesse humaine
tout court de garder et de poursuivre sa vérité à elle (vérité créée) dans
l'Esprit du Christ.