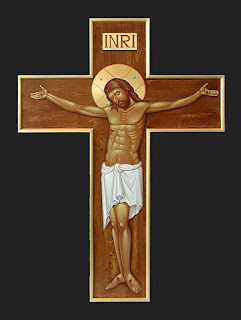Introduction critique aux religions contemporaines : l’Orthodoxie
Facultés
universitaires Saint-Louis
Ecole des sciences philosophiques et religieuses
Ecole des sciences philosophiques et religieuses
Année académique
2005-2006
« Introduction
critique aux religions contemporaines : l’Orthodoxie »
Dr. Konstantinos
Agoras
Plan général des
cours
1. Histoire et péripéties
1.1 « Orthodoxia »
(orthè « doxa » opinion, glorification): référence simultanée à
la foi droite (apostolique) et à la glorification juste
(célébration) : caractère doxologique et liturgique de la
foi (et de la théologie) « orthodoxe ».
« Orthodoxie » : communion d’Églises
« orthodoxes chalcédoniennes » partageant in solidum
la foi apostolique exprimée aux sept « Grands Conciles de la concorde
ecclésiale » entre l’Orient et l’Occident chrétiens au 1er
millénaire (orthodoxie chalcédonienne, « catholique ») ;
à distinguer des Eglises « orthodoxes préchalcédoniennes »
(Nestorienne, Copte…) des 3 premiers Grands Conciles (orthodoxie préchalcédonienne,
« orientale »).
« Eglise
orthodoxe » : une « Eglise d’Eglises » (unicité
et multiplicité ecclésiale dans l’unité communionelle). L’Eglise
orthodoxe (=Catholicité orthodoxe) -comme par ailleurs l’Eglise
catholique (=Catholicité romaine)- s’identifie dans la fidélité à
l’Eglise de la Pentecôte (à l’Église apostolique aux origines chrétiennes) et
se considère comme la manifestation dans l’histoire de l’« Una
Sancta », de l’Eglise « une, sainte, catholique et
apostolique » (selon le « Symbole » de foi, d’espérance et de
charité partagées). Bref pour les uns comme pour les autres il s’agit de deux
manifestations de la « catholicité » dans l’
« orthodoxie » (et vice versa) de l’Una Sancta dans
l’histoire. Manifestations convergentes au départ et par la suite divergentes.
1.2 Au 1er
millénaire : La « Catholicité orthodoxe » (en Orient) et la
« Catholicité romaine » (en Occident), en communion visible bien
que diversifiée (selon la sensibilité sprituelle et théologique des uns
et des autres), souvent fragile et fragilisée à cause des
facteurs culturels (mais aussi politiques…). A noter ici l’écart dès le
4e siècle entre l’Orient et l’Occident chrétiens : écart des
voies spirituelles, des approches et des rationalités théologiques dont les
implications se manifestent vers la fin du millénaire (cf. infra 2.2).
1.2.1 Vers la fin du 1er
– débuts du 2e millénaire : l’écart se manifeste quant au
sens de l’unicité-unité de Dieu (« pneumatologie » :
interprétation non-orthodoxe de la foi trinitaire par les théologiens
Francs, imposée à Rome) et quant au sens de l’unicité-unité de l’Eglise
(« ecclésiologie » : addition unilatérale du Filioque au
Symbole commun de la foi) : en 1054 (date symbolique de la désunion), en
1204 (sac de Constantinople par les Croisés).
1.3 Au 2e
millénaire : péripéties ecclésiales en Occident et en Orient dans
la désunion :
1.3.1 Durcissement
des positions des uns face à celles des autres mais aussi tentatives de
réconciliation et « Conciles d’union » sans succès :
« Lyon » (1274), « Ferrare-Florence » (1438-39). Après la
chute définitive de l’empire byzantin (1453) et l’avènement de la modernité :
1.3.2. En Occident
chrétien : « académisme » théologique (magistériel
et/ou scripturaire) ; « confessionnalisme » et « papisme »
ecclésiologiques.
1.3.3. En Orient
chrétien : « pseudomorphose » théologique
(discordance entre contenu sotériologique de la foi et méthode académique
en théologie ; répétition stérile des formulations patristiques) ;
« culturalisme » et « éthnophylétisme »
ecclésiologiques.
1.4 Au 20e
siècle: situation nouvelle, importance du « mouvement
œcuménique » (ecclésiologie), du Concile Vatican II, de la levée des
« anathèmes », des « dialogues théologiques ». De la part
orthodoxe notamment, une remise en question de la méthodologie
« académique » en théologie et effort d’une fidélité créatrice à
l’« esprit catholique» des « Pères dans la foi »
(apostolique, liturgique, et conciliaire). Travail donc de longue haleine,
d’une théologie véritablement « catholique », loin du
« confessionnalisme » mais aussi loin du « culturalisme »
(et c’est ici le point délicat de l’Orthodoxie…), à poursuivre dans le dialogue
avec les autres Églises chrétiennes d’Occident (et d’Orient préchalcédonien)
comme avec le monde contemporain.
1.4.1. Aux débuts du 3e
millénaire: en route vers un Christianisme postconfessionel
(ecclésial) mais aussi postculturel (eucharistique)?
2. Salut et
célébration
2.1 Sens existentiel du
« salut» en Christ : sauvés de quoi … ? De
l’ignorance et de l’erreur (cf. connaissance et
révélation) ? De la faute et du péché et (cf. rédemption et
pardon) ? Ou de la corruptibilité et de la mort (cf.
résurrection et Parousie) ?
2.1.1. Le salut en Christ :
corps et monde « créés » et création « nouvelle » :
corruptibilté naturelle du créé (rendue insurmontable dans la
chute) et sens ontologico-eschatologique (pas simplement
éthico-historique) du salut : à savoir de la résurrection du Christ
dans son Corps (dans l’histoire, dans l’ « Église ») et de la résurrection
des corps dans le Christ (à la fin de l’histoire, dans le
« Royaume »).
2.1.2.
Implications sotériologiques de la christologie orthodoxe post
chalcédonienne (cf. la christologie asymétrique des 5e – 7e
Conciles œcuméniques aux 6e-8e siècles): d’une part la passibilité
(christique) de Dieu (dans la kénose paradoxale jusqu’à la mort du
Christ incarné), et d’autre part la désindividualisation (pneumatique)
du « Christ » (en sa résurrection et sa glorification dans
l’Esprit du Père) : en tant que corporellement ressuscité de
manière « pneumatique » (eschatologique), le
« Christ » est désormais impensable sans son Corps
(« dernier Adam », réalité eschatologique dans l’histoire,
« personnalité corporative » ontologiquement solidaire de
notre humanité et du reste de la création).
2.2 Sens doxologique du culte
chrétien comme « Liturgie » (perspectives historique,
apocalyptique et eucharistique).
2.2.1. La « divine Eucharistie-Communion »
comme participation à (et avant-goût de) la vie incorruptible du
Ressuscité (dans le Royaume de Dieu); mais aussi comme site de rationalité transfigurée
en théologie (en Christ, à partir du Royaume et vers le monde).
2.3. Sens orthodoxe de la sacramentalité
de l’Eglise (« être-Eglise ») en Christ ressuscité,
dans l’histoire eucharistique, à partir du Royaume eschatologique) :
« orthodoxie » (doxologique) et « catholicité »
(eschatologique) de l’Eglise dans son « apostolicité »
(eucharistique) et son « unicité » (apocalyptique).
3. Foi et
rationalités
3.1 Contextes et rationalités
en théologie - cas de figure : prière et contemplation (foi et
mystique), université (foi et sciences), Liturgie-Eucharistie (être=vie
en communion // être=nature).
3.2 Différences dès
le 4e siècle en Orient et en Occident (voies
spirituelles, approches théologiques et rationalités) :
3.2.1. Quant à l’identification
théologale du Christ incarné à la Vérité
et à la Vie de Dieu données dans l’histoire comme
vérité et vie du monde (= le présupposé fondamental, sotériologique de
la théologie chrétienne, cf. Jn 14,6) : rapport entre « mystère du
Christ » et « pensée philosophique » en théologie).
Cas de figure : l’« hellénisme transfiguré » au sein
eucharistique de la théologie, à la suite des Cappadociens (d’Irénée
de Lyon, d’Athanase d’Alexandrie…), et le « christianisme hellénisant »
entre philosophie et théologie, à la suite de saint Augustin
(de l’école catéchétique d’Alexandrie, Clément, Origène …).
3.2.1.1. A ne pas confondre
ici un christianisme « hellénisant » (ambigu au point de vue
de la christologie, de l’eschatologie et finalement de la sotériologie
orthodoxe de l’Église indivise) avec un christianisme carrément « hellénisé »
de type gnostique (hétérodoxe). Le fond de la question est ici la pertinence de
l’histoire (du monde) et du Royaume (de Dieu) dans l’événement du
salut (le Christ incarné, mort, ressuscité, glorifié et attendu) comme
incarnation eschatologique de la « philanthropie » de
Dieu (=l’amour et la compassion infinis du Père pour l’homme et le monde) au
sein de l’histoire.
3.2.2. Quant au mystère de
l’être incréé du Créateur (Dieu) par rapport à l’être créé des
créatures (homme et monde) et vice-versa (=mystère de l’altérité dans la
relation créé//incréé), ainsi que quant à celui de la vie incorruptible
du Royaume de Dieu par rapport à l’être corruptible de l’histoire
du monde et vice-versa (=mystère de l’altérité dans la relation temps//éternité):
approche doxologique et eucharistique du mystère en Orient, approche historique
et missionnaire en Occident.
3.2.3. Quant au mystère (unicité,
multiplicité, unité) de l’être de Dieu (en tant que « Dieu unique»)
mais aussi de l’être de l’Eglise (en tant qu’« Eglise unique
»): de la multiplicité vers l’unité -à travers l’unicité- en Orient (à
la suite des Pères cappadociens); de l’unité vers la multiplicité en Occident
(à la suite de saint Augustin).
3.3 Dieu et le
cosmos (comme « création ex nihilo ») : une
relation absolument dialectique:
3.3.1. Une ontologie
« close » (philosophique) : monisme grec païen
(penser=être, être=être dans un contexte unitaire, « cosmique »),
décalage aristotélicien entre « être » et « vie », la vie
comme avoir l’être (ontologie repliée sur le « même »,
« cosmo-logique », lors d’une approche « logo-logique »).
3.3.2. Une ontologie
« éclatée » (théologale) : transformation du sens
du « cosmos » (=création ex nihilo), du sens du
« logos » (=Parole ou Logos du Père, devenu homme tout en restant
incréé, sans séparation ni confusion), transformation aussi du
sens de l’« être » (=vie en communion) et de sa
« vérité » (être=vie=vérité=communion en liberté) ; cela veut
dire :
* quant à l’être créé (la
création créée, les créatures multiples): « être (vie)=être en
communion avec Dieu (par participation à sa vie
incorruptible) » ;
* quant à l’être incréé (le
Créateur incréé, le Dieu trinitaire): « être (vie
incorruptible) =être en communion (sans participation);
3.3.2.1 la vérité
de l’être est un événement de communion dans la liberté, la vérité est
communionelle (non substantielle), est identique à un événement libre de
communion (non à une substance nécessaire, donnée).
3.3.2.2. Le
« cosmos » comme « création ex nihilo » :
« être créé//être incréé »: la création (créée) et le Créateur
(incréé), considérés en eux-mêmes (selon leurs natures respectives, créée et
incréée), forment une dialectique absolue (ou bien/ou bien) : p.ex.
si l’on affirme que Dieu « est », il faut simultanément affirmer que
la création « n’est pas » (et vice-versa).
3.3.2.3. Cela est dû à
cause du statut ontologiquement paradoxal du Cosmos entendu non pas
comme éternel en soi-même et autoexplicatif (par participation à son
« logos cosmique»), mais comme Création « créée à partir du
néant ontologiquement absolu » (=d’un néant radical, sans aucun
rapport avec l’être). Il s’agit ici d’un abîme de non-être (et d’un
concept-limite, protologique) dans lequel le créé, dans son ensemble et
dans ses parties (monde, homme) plonge, et d’où il est constamment tiré par la
grâce eschatologique (non protologique !!!) de Dieu.
3.3.2.4. De ce fait
l’« être » est éclaté, il ne peut plus se référer à l’ensemble
du réel (Dieu et création) que par le biais des particularités
hypostatiques et extatiques à la fois (= « personnelles »)
lors d’un « événement de communion » diversifiée, libre
et ouverte de deux côtés ; non pas par le biais d’une « nature »
dynamique et/ou substantialisée en elle-même.
3.4. Foi
et science en théologie - la scolastique de l’Occident
médiéval (et son renversement dans la modernité) par rapport à la perspective
théologale de l’orthodoxie patristique.
3.4.1. Sens «ecclésial»
(=eucharistique-communionel) et contenu « eschatologique »
(=apocalyptique) de la « foi » (cf. He
11,1) : non pas sens « doctrinaire » (ni contenu
« ontothéologique ») de la foi.
3.4.2.
L’ « être » attribué par analogie (naturel-surnaturel) et
la hiérarchisation de la double vérité
(« surnaturelle/naturelle ») dans la scolastique (ontologie
« ana-logique »).
3.4.3. Foi et science
d’après l’orthodoxie patristique.
3.5 Conclusion en
ouverture: interdépendance spirituelle entre Orient et Occident
chrétiens (comme Marthe et Marie autour du Christ… cf. Lc 11, 38-42) et urgence
d’une articulation ecclésiale (eucharistique) du « doxologique »
(ad intra – par rapport au Royaume) et du « kérygmatique »
(ad extra – par rapport au monde) « pour la gloire
de Dieu et pour la vie du monde ».
* Olivier Clément, L’Eglise orthodoxe,
coll. « Que sais-je ? » n° 949, P.U.F., Paris, 20027.
Olivier Clément,
La vérité vous rendra libres : Entretiens avec le patriarche
oecuménique Bartholoméos Ier, Desclée de Brouwer – Lattès,
Paris, 1996.
* Jean Meyendorff, L’Eglise orthodoxe :
Hier et aujourd’hui, Seuil, Paris, 1995.
* Alexander Schmemann, Pour la Vie du
monde : Sacrements et Orthodoxie, Desclée, Paris, 1969.
Alexander Schmemann, L'Eucharistie: Sacrement
du Royaume, éd. François-Xavier de Guibert, coll. « L'Echelle de
Jacob », Paris, 2005.
François Thual, Géopolitique de l’Orthodoxie,
Dunod, coll. « Relations internationales et stratégiques », Paris, 1994.
Kallistos Ware, L’Orthodoxie: L’Eglise des sept
Conciles, Cerf - Le Sel de la Terre, Paris, 20023.
Kallistos Ware, Approches de Dieu dans la voie
orthodoxe Précédé de Autobiographie, Cerf, coll « Classique »,
Paris, 2004.
Kallistos Ware, Tout ce qui vit est saint,
Cerf, coll. « Spiritualités », Paris, 2003.
Kallistos Ware, Le royaume intérieur, Cerf,
coll. « Spiritualités », Paris, 2004.
* Jean Zizioulas, “La vision eucharistique du
monde et l’homme contemporain”, dans Contacts, t. 19 (1967), p. 83-92.
Jean Zizioulas, “Communion et altérité”, dans
Service Orthodoxe de Presse n° 184 (janvier 1994), p. 23-33 et en
anglais cf. sur internet le beau site de Douglas Knight, Resources for Christian Theology: http://www.resourcesforchristiantheology.org/mambo/content/blogcategory/16/42/
Jean Zizioulas, “Le mystère de l’Église dans
la tradition orthodoxe”, dans Irénikon, t. 60 (1987),
p. 323-335 et sur internet : http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/theologie/mystere.htm
* Jean Zizioulas, L’Être ecclésial,
Labor et Fides, coll. « Perspective orthodoxe », n° 3, Genève,
1981, p. 23-55 ; 57-110.
* Jean Zizioulas, “Preserving God’s Creation:
Three Lectures on Theology and Ecology”, dans King’s Theological Review,
n° 1 (1989), p. 1-5; n° 2 (1989), p. 41-45; n° 1 (1990), p. 1-5.
(cf. sur internet dans le site de Douglas Knight, Resources for Christian
Theology).
* Jean Zizioulas, “Christologie et existence:
La dialectique créé-incréé et le dogme de Chalcédoine”, dans Contacts,
t. 36 (1984), p. 154-172.
* Jean Zizioulas, “Christologie et existence:
Le problème de la relation entre « hellénisme » et
« christianisme» et le problème de la mort”, dans Contacts, t. 37
(1985), p. 56-72.
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), Towards
an Eschatological Ontology: A Paper given by Professor John D. Zizioulas at
King's College, London, 1999 (sur internet au site de Douglas Knight, Resources for Christian Theology).
Bruxelles, octobre-décembre 2005
………….
Facultés
universitaires Saint-Louis
Ecole des sciences
philosophiques et religieuses
Année académique
2005-2006
« Introduction
critique aux religions contemporaines : l’Orthodoxie »
Dr. Konstantinos
Agoras
«Orthodoxie: Une
vision eucharistique et eschatologique du monde et de l’histoire»
0. Introduction
générale à l’Οrthodoxie
Collectif, Regards
sur l’orthodoxie, L’Age d’Homme, Lausanne, 1998.
*Olivier Clément, La vérité vous rendra
libres : Entretiens avec le patriarche oecuménique Bartholoméos Ier,
Desclée de Brouwer – Lattès, Paris, 1996.
Olivier Clément, L’église orthodoxe,
Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? »,
Paris, 2002.
Olivier Clément, Rome autrement : Un
orthodoxe face à la Papauté, Desclée de Brouwer, « Hors
Collection » n° 2, Paris, 1992.
Paul, Evdokimov, L’orthodoxie, Desclée
de Brouwer, coll. « Théophanie », Paris, 1992.
Jean-Yves Lacoste (dir), Dictionnaire critique de
théologie, P.U.F., coll. « Grands Dictionnaires », Paris, 1988 (coll.
« Quadrige », Paris, 2002).
Jean Meyendorff, L’Eglise orthodoxe :
Hier et aujourd’hui, Seuil, Paris, 1995.
François Thual, Géopolitique de l’Orthodoxie,
Dunod, coll. « Relations internationales et stratégiques », Paris,
1994.
Dominique Le
Tourneau, Les mots du christianisme : catholicisme, protestantisme,
orthodoxie, Fayard, coll. « Bibliothèque de culture religieuse »,
Paris, 2005.
*Kallistos Ware (évêque de Diokleia), L’Orthodoxie :
L’Eglise des sept Conciles, Cerf- Le Sel de la Terre, Paris, 20023.
Kallistos Ware (évêque de Diokleia), Approches
de Dieu dans la voie orthodoxe Précédé de Autobiographie, Cerf, coll
« Classique », Paris, 2004.
Kallistos Ware (évêque de Diokleia), Tout ce
qui vit est saint, Cerf, coll « Spiritualités », Paris, 2003.
Kallistos Ware (évêque de Diokleia), Le royaume
intérieur, Cerf, coll « Spiritualités », Paris, 2004.
1. Site
liturgico-eschatologique de la vision ecclésiale orthodoxe.
Constantin Andronikof, Le sens de la
Liturgie, La relation entre Dieu et l'homme, Cerf, Paris, 1988.
*Louis Bouyer, Mystèrion : Du mystère à la
mystique, O.E.I.L., Paris, 1986.
Odon Casel,
Le mystère du culte dans le Christianisme: Richesse du mystère du Christ,
Cerf, coll. « Lex Orandi » n° 38, Paris 1964.
John Chryssavgis, “The World as Sacrament:
Insights into an Orthodox Worldview”, dans Pacifica 10 (1997), p. 1-24.
James Steve Counelis, “Relevance and the Orthodox
Christian Theological Enterprise: A Symbolic Paradigm of Weltanschauung”, dans Greek
Orthodox Theological Review 18 (1973), p. 35-46.
Jean Daniélou (Cardinal), Bible et Liturgie:
La théologie biblique des Sacrements et des fêtes d’après les Pères de
l’Eglise, Cerf, coll. « Lex
orandi » n° 11, Paris, 1951.
*Stavros S. Fotiou, “Toward a Person-Centered
Society: The Great Challenge of the 21th Century” et “Liturgical Sanctification:
The Creation as God’s Gift”, dans son The Church in the Modern World,
InterOrthodox Press, Berkeley California, (2005), p. 3-25 et 55-80
respectivement.
Henri de Lubac, Corpus mysticum -
l’Eucharistie et l’Eglise au Moyen Age : Etude historique, Aubier-Montaigne,
coll. « Théologie » n° 3, Paris, 1944.
*David K. Naugle, Worldview: The History of a
Concept, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K. 2002 (les chap.
1, 2 & 9 et notamment les pp. 44-52).
*Alexander Schmemann, For the Life of the World:
Sacraments and Orthodoxy, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, N.Y.,
1973 (tr. fr. Pour la Vie du monde, Desclée, Paris, 1969).
Alexander Schmemann, The Eucharist: Sacrament
of the Kingdom, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, N.Y., 1988 (tr. fr.
L'Eucharistie: Sacrement du Royaume, éd. François-Xavier
de Guibert, coll. « L'Echelle de Jacob », Paris, 2005).
Alexander Schmemann, Of Water and the Spirit: A
Liturgical Study of Baptism, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood,
N.Y., 1987 (tr. fr. D’Eau et d’Esprit: Etude liturgique du Baptême, Desclée de
Brouwer, coll. « Théophanie »,
Paris, 1991).
Alexander Schmemann, Liturgy and Tradition,
St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, N.Y., 1997.
Alexander Schmemann, Church, World, Mission,
St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, N.Y.,1979.
G. Wainwright, Eucharist and Eschatology, Oxford University
Press, Oxford 1981.
G. Wainwright, Doxology - the Praise of God in Worship, Doctrine
and Life: A Systematic Theology, Oxford University Press, Oxford 1984.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “Le
mystère de l’Église dans la tradition orthodoxe”, dans Irénikon,
t. 60 (1987), p. 323-335 et sur internet http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/theologie/mystere.htm
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “La
continuité avec les origines apostoliques dans la conscience théologique des
Églises orthodoxes”, dans son L’Être ecclésial, Labor et Fides, coll.
« Perspective orthodoxe », n° 3, Genève, 1981, p. 136-170].
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Implications ecclésiologiques de deux types de pneumatologie”, dans Mélanges
offerts à J.-J. von Allmen: “Communio Sanctorum”, Labor et Fides, Genève
1982, p. 141-154.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Communion et altérité”, dans Service Orthodoxe de Presse n° 184
(janvier 1994), p. 23-33 et en anglais cf. sur internet le beau site de Douglas
Knight, Resources for Christian
Theology: http://www.resourcesforchristiantheology.org/mambo/content/blogcategory/16/42/
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “The
Eucharist and the Kingdom of God”, dans Sourozh n° 58 (nov. 1994), p. 1
ss. ; n° 59 (Feb 1995), p. 22 ss. et n° 60 (May 1995), p. 32 ss. (tr. ital.: Eucaristia
e Regno di Dio, Qiqajon, Magnano-Bose, 1996).
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Symbolism and Realism in Orthodox Worship”, dans Sourozh n° 79 (Feb
2000), p. 3-17.
2. Approche orthodoxe
de l’histoire et de l’eschatologie.
Savvas Agouridis, “Temps et éternité
(eschatologie et mystique) dans la doctrine théologique de Saint Jean”, dans
son Saint Jean l’évangéliste: Introduction, études exégétiques et
théologiques au quatrième Evangile, Athènes, 1984, p. 27-108 (en grec).
Savvas Agouridis, Etudes bibliques, t. II,
Thessalonique, 1971, p. 83-106 (en grec).
A. H. Armostrong & R. A. Markus, Christian Faith and Greek
Philosophy, London 1964.
Marios Begzos, “Le temps de la Religion:
typologie du Sacré”, dans sa Phénoménologie de la Religion, Ellinika
Grammata, coll. « Sciences des Religions » vol.6, Athènes,
1995, p. 81-105 (en grec).
Hendrikus Berkhof, Christ the Meaning of
History, Baker, Grand Rapids, 1979.
*Oscar Cullmann, Christ et le temps,
Delachaux, Neuchâtel, 1947.
Oscar Cullmann, Le retour du Christ,
espérance de l’Eglise, selon le Nouveau Testament, Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel & Paris, 1948.
Brian E. Daley, The Hope of the Early Church:
A Handbook of Patristic Eschatology, Hendrickson Pub., Massachusetts, 2003.
David Fergusson & Marcel Sarot (eds), The Future as God’s
Gift: Explorations in Christian Eschatology, T & T Clark, Edinburgh,
2000.
*Georges Florovsky, “Eschatology in the Patristic
Age: An introduction”, dans Studia Patristica, vol. II, coll. T.U. 64
(Congrès d’Oxford 1955), Akademie-Verlag, Berlin, 1957, p. 235-250.
Jean Guitton, Le Temps et l’Eternité: Chez
Plotin et Saint Augustin, Vrin, coll. « Bibliothèque
d'histoire philosophique », Paris, 2004.
Anthony A. Hoekema, “The Meaning of History”, dans
son The Bible and the Future, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.
1979, p. 23-40.
George Eldon Ladd, The Presence of the Future:
The Eschatology of Biblical Realism, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan,
1974.
J-L. Leuba (dir.), Temps et eschatologie:
Données bibliques et problématiques contemporaines, Cerf, Paris, 1994.
Karl Löwith, Histoire et salut: Les
Présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de Philosophie », Paris, 2002.
Henri-Irénée Marrou, L’ambivalence du temps de
l’histoire chez saint Augustin (Institut d’Etudes médiévales, Montréal),
Vrin, coll. « Conférence Albert-le-Grand », Paris, 1950 (et sur
internet
Kostas Papaioannou, La consécration de
l’histoire, Ivrea, Paris, 1996.
Rudolf Schnakenburg, Règne et royaume de
Dieu: Essai de théologie biblique, Ed. de l'Orante, Paris, 1965.
E. Stauffer, “Part Two: The Christocentric
Theology of History”, dans son New Testament Theology, The McMillan
Company, New York 19613, p. 49-231.
3. Approche orthodoxe
du monde et de l’homme.
*Georges Florovsky, “Creation and Creaturehood”,
dans son Creation and Redemption, coll. «Collected Works G.
Florovsky », vol. 3, Nordland, Bellmont Mass. 1976, p. 43-78.
Colin Gunton, The Triune Creator: A
Historical & Systematic Study, coll. « Edinburgh Studies for
Constructive Theology», Edinburgh University Press & Grand Rapids, Eerdmans
1998.
Colin Gunton, Christ and Creation (The 1990
Didsbury Lectures), Paternoster Press & Grand Rapids, Eerdmans 1993.
Colin Gunton, The One, the Three and the
Many: God, Creation and the Culture of Modernity (The 1992 Bampton Lectures),
Cambridge 1994.
D.J. Hall, Etre image de Dieu: Le stewardship de l'humain
dans la création, Cerf-Bellarmin, Paris-Montréal, 1998.
*F. Heinzer, “L’explication trinitaire de l’Économie
chez Maxime le Confesseur”, dans F. Heinzer
et Ch. Schönborn (éd.) Maximus
Confessor: Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre
1980, Freiburg 1982, p. 159-172.
*Eric Osborn, Irenaeus of Lyons,
Cambridge University Press, Cambridge U.K., 2001.
*Dimitrios Tsamis, “Le cadre temporel de la
Création « logique »”, dans son Introduction à la pensée
patristique, Pournaras, Thessalonique, 1985, p. 15-168 (en grec).
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Vérité et communion: Fondements patristiques et implications existentielles de
l’ecclésiologie eucharistique”, dans son L’Être ecclésial, Labor et
Fides, coll. « Perspective orthodoxe », n° 3,
Genève, 1981, p. 57-110.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Preserving God’s Creation: Three Lectures on Theology and Ecology”, dans King’s
Theological Review, n° 1 (1989), p. 1-5; n° 2 (1989), p. 41-45;
n° 1 (1990), p. 1-5. (cf. sur internet le site de Douglas Knight, Resources for Christian
Theology et tr. ital.: Il
creato come eucaristia, Qiqajon, Magnano-Bose, 1994).
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Christologie et existence: La dialectique créé-incréé et le dogme de
Chalcédoine”, dans Contacts, t. 36 (1984), p. 154-172.
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Christologie et existence: Le problème de la relation entre
« hellénisme » et « christianisme» et le problème de la mort”,
dans Contacts, t. 37 (1985), p. 56-72.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame),
“Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood”,
dans Scottish Journal of Theology, t. 28 (1975), p. 401-447.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “Du
personnage à la personne: La contribution de la théologie patristique à la
notion de personne”, dans son L’Être ecclésial, Labor et Fides, coll.
« Perspective orthodoxe », n° 3, Genève, 1981, p. 23-55.
Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “On
Being a Person: Towards an Ontology of Personhood”, dans Ouvr. Coll. sous la dir.
de C. Schwöbel & C. Gunton, Persons, Divine and Human:
King’s College Essays in Theological Anthropology, T. & T. Clark,
Edinburgh 1991, p. 33-46.
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), Towards
an Eschatological Ontology: A Paper given by Professor John D. Zizioulas at
King's College, London, 1999 (cf. sur internet le site de Douglas Knight, Resources for Christian
Theology).
4. Approche orthodoxe
du temps et de l’éternité
*Olivier Clément, Transfigurer le temps: Notes
sur le temps à la lumière de la tradition orthodoxe, Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel & Paris, 1959.
*Jean Daniélou (Cardinal), Essai sur le
mystère de l’histoire, Cerf, coll. « Traditions chrétiennes »,
Paris, 1982.
Jean-Yves Lacoste, Note sur le temps: Essai sur
les raisons de la mémoire et de l’espérance, Presses Universitaires de
France, coll. « Théologiques », Paris, 1990.
*Nikos Ntontos, “La reconnaissance de la valeur
de l’Histoire et l’intégration eschatologique du Temps”, dans Pantelis Kalaïtzidis (dir.), Eglise et
eschatologie, Kastaniotis, Athènes 2003, p. 125-137 (en grec).
*Jean Zizioulas (métropolite de Pergame), “La
vision eucharistique du monde et l’homme contemporain”, dans Contacts,
t. 19 (1967), p. 83-92.
……..
FUSL / Ecole des
Sciences philosophiques et religieuses
Orthodoxie / 2005-2006
Dr Konstantinos
Agoras
Introduction critique
aux religions contemporaines – Orthodoxie
Syllabus
1. « Église », histoire et péripéties
1.1.1.0 « Orthodoxia » -
Le terme, composé des mots grecs « orthè » (ορθή, correcte) et
« doxa » (δόξα, opinion,
glorification), fait simultanément référence aussi bien à la rectitude du
contenu de la foi (dans la suite des apôtres et des pères)
qu’à la justesse de l’acte de glorification (dans la célébration
eucharistique) de Dieu en Christ; d’où le caractère foncièrement doxologique
et liturgique de la « foi » -et par conséquent de la
« théologie »- chrétienne en perspective orthodoxe.
1.1.1.1 L’expression « je
crois ... » fait ici référence à une situation expérientielle
dans l’espérance et la charité (pas simplement à un contenu théorique, ni
doctrinaire), à une expérience existentielle qui vise les réalités à venir:
c’est la « subsistance des [réalités] espérées, l’examen des choses non
vues » (cf. He 11,1). La « foi » au salut de Dieu
-comme sa célébration- est un acte eschatologique et communautaire
dans l’histoire ; pas simplement un acte historique, ni simplement
individuel.
1.1.2
« Orthodoxie » - Le terme
désigne une communion d’Églises, principalement celle des Églises
« orthodoxes chalcédoniennes », partageant in
solidum (c’est-à-dire dans la communion indivisible) la foi apostolique
exprimée aux sept « Grands Conciles de la concorde ecclésiale » entre
l’Orient et l’Occident chrétiens au 1er millénaire (orthodoxie chalcédonienne,
« catholique »). Les Églises orthodoxes chalcédoniennes
sont ici à distinguer des Églises « orthodoxes préchalcédoniennes »
(Nestorienne, Copte…) qui souscrivent à l’expression de la foi selon les seuls
trois premiers « Grands Conciles » (orthodoxie préchalcédonienne,
« orientale »).
1.1.3.0 « Église
orthodoxe » - Le terme d’Orthodoxie chalcédonienne
(ou d’« Église orthodoxe ») désigne une « Église d’Églises »(=communion
d’Églises), à savoir une multiplicité ecclésiale dans
la communion au sein de l’histoire: une existence communionelle des
communautés « eucharistiques » (=Églises), à l’image
(virtuellement) de l’existence communionnelle du Dieu trinitaire :
du Père, du Fils et de l’Esprit, d’un Dieu trois fois unique-et-autre
dans la communion, selon la foi des chrétiens[1].
1.1.3.1 Selon la conscience
orthodoxe, l’« Église » (unique-et-multiple dans l’histoire)
ne pourrait exister (précisément comme « Église ») qu’en
reflétant, en « iconisant » (=en se rendrant l’icône, le reflet de)
la réalité « Dieu » (unique-et-trine dans l’éternité) comme
événement de communion des réalités uniques-et-multiples. Car c’est cela le
sens de l’existence de l’« Église »: refléter le mode d’existence
(trinitaire) de Dieu (unique) dans l’histoire ! Tout comme le « Dieu»
unique-et-multiple (dans l’éternité), l’« Église» unique-et-multiple (dans
le temps) ne pourrait constituer point une réalité monolithique (dont
l’être s’exprimerait à l’aide des catégories substantialistes) mais une réalité
solidaire (relationnelle) dans l’ouverture et la communion aux
« autres » et avec les « autres ». Il s’agit d’un événement
de concorde d’Églises (dans la rectitude de la foi et de la
célébration) qui ne va pas au détriment de leurs particularités uniques-et-autres[2].
1.1.4.0 Parler de
« christianisme» signifie parler d’« Église» (terme de
connotation strictement biblico-théologique), non pas simplement de
« religion», ni de « confession» (termes socio-historiques). Parler
d’Église signifie parler de communauté eschatologique et
« mystérique » (=sacramentelle ou mieux « eucharistique »)
dans l’histoire, pas simplement de communauté historique ou cultuelle. Dans la
conscience des premiers chrétiens (=Église apostolique), normative pour
l’ensemble du christianisme, « Église » désigne une réalité
foncièrement paradoxale : le corps du Ressuscité dans l’histoire
(cf. les expression bibliques « corps du Christ », « temple de
l’Esprit », « maison du Père »), c’est-à-dire la réalité de la fin
de l’histoire (cf. la résurrection) anticipée d’une certaine manière et
présente, comme à travers un miroir (à travers la célébration eucharistique,
l’anticipation du futur), au sein même de l’histoire. L’Église, tout en
étant dans ce monde, n’est pas de ce monde, mais du monde à
venir : du Royaume eschatologique de Dieu, du Royaume de la
résurrection, de la création entièrement renouvelée (de manière ontologique, cf.
infra 2e partie) dans la vie incorruptible du Ressuscité.
1.1.4.1 Cela étant l’Église
orthodoxe (= catholicité orthodoxe) –comme par ailleurs l’Église
catholique-romaine (=catholicité romaine)– s’identifie (dans la
fidélité) à l’Église de la Pentecôte (à l’Église apostolique aux origines
chrétiennes) et se considère comme la manifestation dans l’histoire de l’« Una
Sancta », de l’Église « une, sainte, catholique et
apostolique » (selon le « Symbole » de foi, d’espérance et de
charité partagées par les communautés chrétiennes). Du point de vue théologique
nous nous trouvons actuellement face au paradoxe de deux manifestations
de la « catholicité » dans l’« orthodoxie » (et vice versa)
de l’Église apostolique, de l’Una Sancta, dans l’histoire:
manifestations convergentes de fidélité dans la communion, au premier
millénaire, et successivement manifestations divergentes, dans l’état de
séparation (d’où le paradoxe de deux manifestations parallèles de
l’« Una Sancta » dans une fidélité aux sources non
entièrement partagée). Ci-dessous quelques éléments de l’aventure
ecclésiale telle qu’elle apparaît à la surface de l’histoire (mais d’une
histoire dont nous ignorons les profondeurs, celles du Royaume eschatologique
de Dieu qui pour nous, chrétiens, sont celles du Ressuscité …).
1.2.1 Au 1er
millénaire : La « catholicité orthodoxe » de l’Orient et la
« catholicité romaine » de l’Occident se trouvaient en communion
visible bien que diversifiée selon la sensibilité sprituelle et
théologique des uns et des autres, en communion certes fragile (comme
tout événement libre …) et souvent fragilisée à cause des multiples
facteurs (théologiques et spirituels mais aussi culturels et politiques…). A
noter ici l’écart dès le 4e siècle des voies spirituelles,
des approches et des rationalités théologiques entre l’Orient et l’Occident
chrétiens, dont les implications se manifestent progressivement (cf. infra
3.2). A rappeler aussi l’écart susmentionné, dès le 5e siècle, entre
Églises chalcédoniennes et préchalcédoniennes.
1.2.2 Vers la fin du 1er
– débuts du 2e millénaire la communion visible entre Orient et
Occident catholiques (=chalcédoniens) disparaît. Les dates symboliques de cette
aventure malheureuse sont l’année 1054 (rupture formelle de la communion entre
les Églises de Rome et de Constantinople) et l’année 1204 (sac de
Constantinople par les Croisés). A la fin du moyen âge, nous avons d’une
part le durcissement des positions des uns face à celles des autres mais
aussi, il ne faut pas l’oublier, de tentatives de réconciliation et de
« Conciles d’union », pourtant sans lendemain : ceux de
« Lyon » (1274) et de « Ferrare-Florence » (1438-39).
1.2.3 Avec l’avènement de
l’ère moderne et jusqu’à l’ « époque œcuménique »
(20e siècle) la situation théologique et ecclésiologique chez les
uns et les autres se cristallise en gros comme suit :
1.2.3.1 En Occident
chrétien[3] :
un « académisme » théologique (remontant pour
l’essentiel à l’époque « scolastique » des universités, celle qui a
succédé à l’époque « patristique » et à celle des « écoles
cathédrales »), de fondement magistériel chez les catholiques
romains et scripturaire chez les protestants (cf. infra 3e
partie), qui soutient et justifie un « confessionnalisme » ecclésiologique
(les Églises s’identifiant à partir de leurs confessions de foi).
1.2.3.2 En Orient chrétien[4] :
une « pseudomorphose » théologique –c’est-à-dire une
discordance foncière entre le contenu (sotériologique) de la foi
patristique (celle des Apôtres et des Conciles patristique oecuméniques) et une
méthode (académique, donc inadéquate au contenu) en théologie–, importée
de l’Occident chrétien, réplique véritable de l’académisme confessionnel
susmentionné. Tel académisme se traduit chez les orthodoxes dans une répétition
stérile des formulations conciliaires et patristiques. Autrement dit,
l’Orthodoxie tombe elle aussi dans le piège du « confessionnalisme » ecclésiologique
de l’Occident qu’elle s’approprie (en utilisant ad extra les arguments
catholiques contre les protestants et les arguments protestants contre les
catholiques …) et le développe en « culturalisme » ecclésiologique
(les Églises orthodoxes s’identifiant ad intra, les unes par rapport aux
autres, à partir de leurs racines culturelles).
Aux yeux de
l’orthodoxe (du moins), la pseudomorphose théologique
(sous forme de scolasticisme et d’académisme) et l’aliénation ecclésiologique
(sous forme de confessionnalisme et de culturalisme), en Occident comme en
Orient chrétiens, vont de pair (cf. infra 3e partie). Le
renouveau de l’Église et celui de sa théologie s’impliquent mutuellement….
1.2.4.0 Au 20e
siècle: due à la création du Conseil Œcuménique des Églises et à
l’émergence du « mouvement œcuménique », au Concile Vatican II
et à la levée des « anathèmes » (=actes de rupture de communion)
entre Rome et Constantinople, aux « dialogues théologiques »
bilatéraux et multilatéraux, une nouvelle situation théologique –et
peut-être aussi ecclésiologique ( ?)– émerge parmi les Églises
chrétiennes.
1.2.4.1 Du côté orthodoxe
notamment telle situation se concrétise dans la remise progressive en question
d’une méthodologie « académique » et « confessionnelle »
inspirée de la scolastique tardive, au profit d’une méthodologie
« eucharistique », véritablement « ecclésiale » en théologie,
dans l’effort de fidélité créatrice à l’« esprit catholique» des
Pères dans la foi (apostolique, liturgique, et conciliaire) ;
corrélativement, dans un effort constant de dépassement du confessionnalisme et
du culturalisme en ecclésiologie, lors d’une ouverture de l’Orthodoxie ad
extra (aux autres Églises chrétiennes et aux « signes des temps »
en provenance du monde contemporain), et partant ad intra (dans une
recherche de nouveaux moyens de manifestation de l’unité communionnelle
« pan-orthodoxe »).
1.2.5 Dépassant de
loin le but de la simple « coexistence pacifique des confessions
chrétiennes » (« interconfessionalisme ») dans le monde, sur la
simple base de la reconnaissance des différences culturelles, religieuses
ou autres, la recomposition de l’unité visible des « Églises »
–dans la communion eucharistique autour de la présence pneumatique du
Ressuscité parmi nous– implique un travail de renouveau spirituel et
théologique véritablement « ecclésial » et « catholique », chez
les uns comme chez les autres, loin du « confessionnalisme »
(tentation occidentale pour ainsi dire) mais également loin du
« culturalisme » (tentation orientale) ; travail à poursuivre
dans le dialogue patient et courageux –une confrontation synchronique mais
aussi diachronique, du point de vue orthodoxe– avec les autres Églises
chrétiennes (de l’Occident chalcédonien et de l’Orient préchalcédonien) comme
avec le monde contemporain, son histoire et ses attentes. Aux débuts du 3e
millénaire ne sommes-nous pas peut-être en route vers la redécouverte
d’un Christianisme postconfessionel (ecclésial) mais également postculturel
(eschatologique) dans l’histoire[5]
?
* Olivier Clément, « Histoire de
l’Orthodoxie », dans Encyclopédie Universalis, article
« Orthodoxe (Église) ».
* Nicolas Lossky, articles
« Orthodoxie » et « Orthodoxie moderne et contemporaine »,
dans Jean-Yves Lacoste (dir.), Dictionnaire
critique de théologie, P.U.F., Paris, 1998, p. 830-835.
Jean Meyendorff, L’Église orthodoxe :
Hier et aujourd’hui, Seuil, Paris, 1995.
François Thual, Géopolitique de l’orthodoxie,
Dunod, coll. « Relations internationales et stratégiques », Paris, 1994.
Kallistos Ware, L’Orthodoxie: L’Église des sept
Conciles, Cerf - Le Sel de la Terre, Paris, 20023.
2. Salut, célébration et « eucharistie-communion »
L’Orthodoxie, tout
comme les autres Églises et confessions chrétiennes du 2e millénaire
(catholicisme, protestantisme, anglicanisme etc.) se place -comme confession- à
la fois sous le jugement de l’Église indivise (celle des apôtres, des
martyrs et des pères dans la foi), comme par ailleurs en attente du jugement
définitif du Christ lors de la Parousie. Bref, elle se place entre les
Apôtres, les martyrs et les Pères d’une part, et la Parousie du Christ d’autre
part. Or une question, importante pour notre propos d’introduction à
l’Orthodoxie, émerge ici :
Quel est le contenu
de l’expression « un point de vue orthodoxe » ? C’est me
semble-t-il en rapport à la « catholicité orthodoxe » (la
Tradition de la grande Église du premier millénaire, de l’ « Église indivise »,
apostolique et conciliaire notamment, qui est la matrice et la mesure
commune pour tous)[6]. Ainsi que le terme
l’indique, la « catholicité orthodoxe » est distincte
de la « catholicité romaine » laquelle représente une manière
différente de vivre et de penser la « catholicité »
(hypostatico-extatique), à savoir le « mode d’être » de l’Église
- Corps du Christ en Esprit, du Royaume eschatologique de Dieu en
Christ, et partant de Dieu - communion trinitaire en Lui-même (à partir
du/et vers le Père)[7].
L’approche orthodoxe,
faisant référence à l’« Église indivise », nous oblige à un
dialogue-confrontation complexe, non seulement synchronique mais aussi diachronique
: dialogue ad intra (parmi les orthodoxes) et simultanément ad extra
avec chacune des confessions chrétiennes d’aujourd’hui (catholique, protestantes,
anglicane etc.). Et ce, non pas directement (en face-à-face), mais par le biais
de l’Église apostolique, conciliaire et patristique du premier millénaire,
notre matrice et mesure commune. De ce fait, en œcuménisme, lors d’un
face-à-face avec les autres dénominations chrétiennes, l’orthodoxie ne veut pas
témoigner d’elle-même (de manière confessionnelle) mais bien plutôt de la foi
de l’Église « indivise » —à travers certes sa manière spécifique
(orthodoxe) de vivre et de penser la « catholicité » ecclésiale et
trinitaire— par rapport à laquelle elle se mesure et face à
laquelle elle doit se mesurer constamment, elle d’abord, avant les autres. Pour
illustrer cela je reprends ici les paroles de Jean Zizioulas, métropolite de
Pergame et œcuméniste orthodoxe de renommé internationale, dont je partage
entièrement la vision :
« Chaque fois
que sur un sujet je dois parler du "point de vue orthodoxe" je
me trouve en grande difficulté. Qu’est-ce que le "point de vue
orthodoxe" ? Comment le déterminer ? Sur quelles bases et à
partir de quelles sources ? Les orthodoxes n’ont pas de Vatican II où
puiser. Ils n’ont pas leur Confession d’Augsbourg et ils manquent de
l’équivalent d’un Luther ou d’un Calvin pour leur donner leur identité
confessionnelle. Les seules sources qu’ils possèdent en fait d’autorité leur
sont communes avec le reste des chrétiens : la Bible et les Pères. Comment
peut-on déterminer une position qui soit spécifiquement orthodoxe sur la
base de ce qui est commun avec les non orthodoxes ?
Il semble que le
point de vue spécifiquement orthodoxe —je continue la citation— n’est pas
quelque chose que l’on puise à des sources spéciales, mais tient à
l’interprétation des sources qu’ils partagent avec le reste des chrétiens. Les
orthodoxes diffèrent des catholiques romains et des protestants en ce qu’ils
abordent des sujets, comme celui de l’Église (du Royaume et de Dieu, je
rajoute) sous un angle qui est typiquement caractéristique de leur mentalité.
Ils ont leurs propres présupposés théologiques qui suggèrent aussi une
certaine problématique et une certaine méthode qui ne sont pas toujours
familières aux non orthodoxes ». Et l’auteur, de conclure en ces termes :
« Quand, à l’intérieur du débat œcuménique, on en vient au dialogue entre
orthodoxes et non orthodoxes la chose importante est toujours les présupposés
théologiques et non les thèses concrètes »[8].
Ces présupposés
théologiques dont l’auteur parle à raison, les présupposés d’une
vision du monde dans la perspective orthodoxe -vision eucharistique
comme nous le verrons- ont leur racine ultime, nous le verrons bien, dans un contexte
liturgique et eschatologique. Et pour bien comprendre cette
affirmation nous devons commencer par la question suivante :
2.1.0 Quel est le sens du
« salut» de Dieu, offert et réalisé pour nous en Christ ?
De quoi au juste sommes-nous sauvés ? De l’ignorance et de l’erreur
face à la « vérité » par la connaissance
(de la révélation de celle-ci)? De la faute et du péché face à la
« loi » par la rédemption
(effacement d’une injustice commise) ? Ou bien de la corruptibilité
et de la mort de notre « particularité »
concrète de « personnes » uniques-et-autres par la résurrection
dans la « chair » et l’anticipation de la Parousie du
Christ (attendue à la fin de l’histoire) dans la communion
eucharistique?
Ces perspectives
« sotériologiques » (« sôteria » = salut, en grec)–la
perspective « ascético-gnoséologique » (ayant comme paradigme l’ « école
catéchétique d’Alexandrie », de Clément et d’Origène au 3e
siècle), l’« éthico-juridique » (avec celle d’Augustin au 4e
siècle) et l’« onto-existentielle » (à la suite d’Ignace
d’Antioche et d’Irénée de Lyon au 2e siècle) respectivement– se retrouvent
tout au long de l’histoire de l’autocompréhension des communautés chrétiennes
(=histoire des théologies et de spiritualités chrétiennes).
Tout en n’ignorant
pas la multiplicité d’expression théologique, la perspective sotériologique de
la catholicité orthodoxe est résolument onto-existentielle, à savoir
eucharistique-communionnelle : celle de l’« esprit catholique»
des « Pères dans la foi » (apostolique et conciliaire) expérimentée
dans la Divine Liturgie, dans la célébration des mystères du Royaume eschatologique
de Dieu en Christ ressuscité[9]. C’est parce que le
Christ est ressuscité que le Royaume eschatologique est réellement venu dans
l’histoire, ne l’oublions pas (et même s’il n’est pas encore pleinement
manifesté …)[10].
2.1.1. Paradoxalement
anticipé et expérimenté dans la célébration eucharistique de la communion de
l’humanité et du monde avec Dieu –définitivement restaurée et parfaitement
accomplie en Christ dans l’Esprit– le salut concerne ainsi les corps et
l’ensemble du monde « créés » dans une création
« nouvelle ». Centré à partir de la résurrection du Christ
dans son Corps (dans l’histoire, dans l’« Église ») et dans l’attente
de la résurrection des corps dans le Christ (à la fin de l’histoire,
dans l’accomplissement du « Royaume »), le salut (en perspective
onto-existentielle rappelons-le) a un contenu onto-eschatologique
(= un contenu ontologique qui se rattache à l’eschaton) et pas simplement un
contenu éthico-historique. Il s’applique à la corruptibilté naturelle
du créé, une corruptibilité rendue de surcroît insurmontable et définitive
dans l’état onto-existentiel de « chute » (absence de communion avec
la source de Vie incorruptible, avec « Dieu »)[11].
2.1.2. Il faut
relever entre parenthèse que telle sotériologie orthodoxe des Pères
Grecs va de pair avec la christologie dite post-chalcédonienne,
la christologie asymétrique des 5e – 7e Conciles
œcuméniques aux 6e-8e siècles, celle qui affirme d’une
part la passibilité (christique) de Dieu (dans la kénose
paradoxale jusqu’à la mort du Christ incarné), et d’autre part la désindividualisation
(pneumatique) du « Christ » (en sa résurrection et sa
glorification dans l’Esprit du Père). En tant que corporellement
ressuscité de manière « pneumatique » (eschatologique), le
« Christ » est à jamais impensable sans son Corps
(« dernier Adam », réalité eschatologique dans l’histoire,
« personnalité corporative », ontologiquement solidaire de
notre humanité et du reste de la création).
Or le plus
significatif pour notre propos d’introduction à l’Orthodoxie est que le contexte
d’approche du « salut » (« sotériologie ») et du
« Christ » (« christologie ») comme par ailleurs celui de
« Dieu » en lui-même (« théologie » trinitaire)– est,
selon la patristique grecque, résolument liturgico-eucharistique, à
savoir doxologique et eschatologique[12] (cf. infra 3e
partie).
Comme il a été
pertinemment observé, du point de vue de la phénoménologie historique des
religions, seule l’eucharistie, prise dans sa signification correcte,
constitue la différence spécifique du Christianisme[13]. Qu’est-ce que cela
signifie ?
2.2.0 C’est
l’« eucharistie », selon la conscience orthodoxe, qui rend
« Église » de Dieu trinitaire -à savoir Corps du Christ
ressuscité, temple de l’Esprit du Royaume et maison du Père
éternel- toute communauté concrètement située dans l’espace et le temps,
bref qui nous rattache ontologiquement au Royaume eschatologique de la
résurrection. Et le terme « eucharistie » désigne ici un double
( ?) événement eschatologique et communautaire d’action de grâces
(pour le salut, reçu en Christ) et de communion avec Dieu-le
Père, tout comme avec l’humanité et la création entière (en Christ, en vue du
salut) dans l’histoire et le temps, les deux aspects du mystère étant ontologiquement
indissociables. De ce fait l’eucharistie-communion est identique avec l’action
eucharistique (la Divine Liturgie) dont le contenu est ontologique et
littéralement théo-cosmique : pour la gloire de Dieu et le salut
(=la subsistance éternelle, l’incorruptibilité en Christ) du monde
(corruptible en lui-même tout comme « en dehors » du Christ[14])
selon la belle expression de la Liturgie eucharistique actuellement en usage
dans l’Église romaine.
2.2.1
Contrairement à nos habitudes (occidentales) d’une vision linéaire et
progressive de l’histoire à travers les événements historiques,
selon la compréhension orthodoxe, la « Liturgie eucharistique»
(la « Divine Liturgie ») n’est pas simplement un
« événement historique », telle une performance cultuelle de
l’humanité « devant » Dieu (« culte »), mais foncièrement
un « événement eschatologique » dans l’histoire ; cela
rend la vision des choses (de l’histoire et de l’eschatologie, du temps et de
l’éternité, de l’homme, du monde et de Dieu) beaucoup plus complexe.
Comme action de
grâces et communion à l’Autre par excellence (Dieu le Père) tout comme aux
autres (nos semblables et le monde entier) en Christ dans l’Esprit, la
« Liturgie eucharistique» n’est pas un événement qui a lieu
simplement « face à » Dieu (comme notre propre action historique
de croyants face à Lui), mais simultanément « en »
Dieu (comme Son action eschatologique en Christ dans l’histoire) et
« face à » Dieu (comme la nôtre en communion d’action avec le
Christ dans l’histoire) de manière dialectique[15]. Il s’agit bien
d’une communion asymétrique d’action eschatologique de Dieu qui
vient à notre rencontre et de l’humanité en Christ (Divine Liturgie),
d’une communion asymétrique d’action du Royaume qui advient dans le Saint
Esprit et de l’histoire en Christ que nous appelons
« synergie christique» (christoconforme)[16]. Coopération de
Dieu et de l’humanité dans le Christ, du Royaume et de l’histoire dans
l’Esprit, de l’éternité et du temps dans la Liturgie eucharistique (en dehors
du monde et dans le monde), sans séparation, ni confusion. Précisément
parce qu’elle signifie « action de grâces » et
« communion » à l’Autre, l’« eucharistie-communion » a simultanément
lieu « dans » le Royaume (dans le métahistorique de
l’ « eschaton », après le parcours de l’histoire entière, après
son achèvement) et « face au » Royaume (dans l’histoire, durant le
parcours de l’histoire et avant son achèvement).
Cette vision
« liturgique » des choses, fort complexe certes, crucifiante même
pour l’existence quotidienne de l’homme pris dans les soucis de l’histoire,
rend le Royaume (et le sens ultime de l’histoire) réellement « présent et
attendu » à la fois. Il s’agit d’une eschatologie et d’un sens ultime de
l’histoire ni simplement « réalisés » (révélés), ni simplement « attendus »
(cachés) mais « inaugurés » (dans la résurrection du Christ et
la célébration eucharistique autour du Ressuscité, à chaque ici et maintenant).
De ce fait le « temps liturgique» de l’Église est une tension
permanente entre le Royaume qui interpelle l’histoire et l’histoire qui
tend déjà vers la pleine manifestation du Royaume.
2.2.2 C’est dans
cette optique orthodoxe de la « Divine Liturgie » que la notion de « catholicité »
(« kath-olon », qui veut dire « selon l’intégralité » en
grec) acquiert son sens théologique. Le terme se réfère à l’intégralité du
mystère du Christ ressuscité, manifestée et attendue (lors de
l’eucharistie-communion ecclésiale), à savoir à la « récapitulation »
eschatologique de l’ensemble de l’histoire et du monde en lui-même. De ce fait la
connotation théologique du terme est eschatologique (non pas simplement
historique) et ontologique (non pas simplement « ontique »,
substantialiste, quantitative ou qualitative). La « catholicité »
renvoie non pas à la « nature » même des réalités telles qu’elles
sont actuellement (lors d’une « ontologie descriptive ») mais à
la « manière d’être ultime» des réalités telles qu’elles seront
dans le Royaume (lors d’une « ontologie eschatologique »). La
catholicité se fonde donc à partir de la « manière d’être », ontologiquement
ultime, de « Dieu » incréé (catholicité trinitaire), donnée dans
celle de son « Royaume » eschatologique (catholicité eschatologique)
–en Christ ressuscité dans l’Esprit du Père– dont l’« Église »
(catholicité eucharistique) est l’icône. Catholicité manifestée et attendue
à la fois dans la vie du Ressuscité, réellement mais paradoxalement
perçue lors de la Divine Liturgie dans la participation eucharistique:
déjà-et-pas encore, comme à travers un miroir, de manière énigmatique[17].
2.2.3 Dans son contexte
liturgique orthodoxe, la « divine eucharistie-communion »
consiste dans l’action de grâces à Dieu et la participation à (et l’avant-goût
de) la vie incorruptible du Ressuscité à partir du (et dans le)
Royaume eschatologique. De ce fait les « saints mystères »
liturgiques, centrés autour de l’Eucharistie-Communion, constituent le site
d’une rationalité transfigurée en théologie -ou plus exactement
d’une rationalité en voie de transfiguration progressive- en Christ
(fondement eucharistique de la théologie), à partir du Royaume
(orientation doxologique de la théologie) et vers le monde
(modalité kérygmatique de la théologie). Cette remarque nous amène à la dernière
partie de notre introduction à l’Orthodoxie.
Aide
bibliographique :
* Alexander Schmemann, Pour la Vie du
monde : Sacrements et Orthodoxie, Desclée, Paris, 1969.
Alexander Schmemann, L'Eucharistie: Sacrement
du Royaume, éd. François-Xavier de Guibert, coll. « L'Echelle de
Jacob », Paris, 2005.
Jean Zizioulas, L’être ecclésial,
coll. « Perspective orthodoxe n° 3 », Labor et Fides, Genève, 1981.
* Jean Zizioulas, “Christologie et existence:
La dialectique créé-incréé et le dogme de Chalcédoine”, dans Contacts,
t. 36 (1984), p. 154-172.
* Jean Zizioulas, “Christologie et existence:
Le problème de la relation entre « hellénisme » et
« christianisme» et le problème de la mort”, dans Contacts, t. 37
(1985), p. 56-72.
* Jean Zizioulas, “La vision eucharistique du
monde et l’homme contemporain”, dans Contacts, t. 19 (1967), p. 83-92.
3. Foi eschatologique et rationalités théologiques
3.0 Comme il a été
relevé, de manière simplifiée certes mais néanmoins significative au niveau des
démarches théologiques, tandis que les penseurs chrétiens en Occident ont
tendance d’apprendre leur théologie à travers des livres dans la
bibliothèque, les orthodoxes apprennent la leur à travers la Divine
Liturgie et l’adoration dans le sanctuaire[18].
Pour l’héritage des
Pères Grecs, la « théologie » constitue, en premier lieu,
l’expression prophétique (non doctrinaire) de la conscience ecclésiale,
de la foi eschatologique et de l’existence eucharistique de
l’Église. De plus, à l’encontre de l’Occident chrétien, l’Orthodoxie n’envisage
pas l’essence de la théologie comme principalement kérygmatique, apologétique
et pratique mais d’abord comme doxologique, prophétique et eucharistique.
3.1.1 Entre
« Église » (cf. mystère du salut), « Liturgie » (cf.
eucharistie-communion) et « théologie » (cf. rationalité) il y a une
corrélation, instaurée à partir du Royaume présent et attendu (dans la
« vie incorruptible », selon la « grâce »), non pas à
partir de la seule histoire (dans la « vie corruptible », selon la
« nature »).
Bien que l’histoire institue
la « présence » du Christ parmi nous à travers une succession
ininterrompue de « communautés chrétiennes », c’est l’Esprit du
Royaume que constitue cette « présence » en tant
qu’anticipation paradoxale et avant-goût proléptique (mystérique,
eucharistique) de sa Parousie eschatologique, de son dernier avènement.
L’histoire institue des communautés à la suite des Apôtres (cf.
« succession apostolique ») que le Royaume (dans l’Esprit Saint,
l’Esprit des « derniers jours ») constitue en
« Églises » (Corps du Christ)[19]. Car l’œuvre propre
de l’Esprit Saint dans l’histoire c’est d’ouvrir l’histoire au Royaume,
de la rendre transparente à l’eschaton, créant ainsi des événements de
communion parmi nous à partir du (et vers le) Royaume de Dieu.
3.1.2 Ce
conditionnement eschatologique des réalités historiques (dans
l’Esprit du Royaume) s’applique également dans le cas de la « Tradition
ecclésiale » (avec majuscule, dans sa différence par rapport aux
«traditions théologiques ») ; « Tradition » en accord
avec l’eucharistie et de ce fait unique (selon l’expression célèbre
de saint Irénée (2e siècle).
3.1.3 Contextes et rationalités
en théologie - cas de figure : prière (cf. foi et contemplation), université
(cf. foi et sciences), Liturgie (cf. eucharistie-communion). C’est à
partir de ce dernier contexte (eucharistique et communionel) que l’Orthodoxie
envisage la « tradition ecclésiale » où, à l’encontre de la sagesse
humaine (philosophie, sciences), l’« être » ne se réfère plus à soi
même de manière tautologique (être=être) mais il se révèle identique à la
« vie » et de plus « en communion » avec l’Autre à partir
du Royaume (cf. ontologie eschatologique et communionnelle, ontologie
« selon la grâce », non pas simplement « selon la
nature »[20]).
3.2 Visions du monde et
différences dans les approches et les rationalités théologiques en
Orient et en Occident[21]:
3.2.1. Quant à l’identification
théologale du Christ incarné à la Vérité
et à la Vie de Dieu données dans l’histoire comme
vérité et vie du monde (= le présupposé fondamental, sotériologique de
la théologie chrétienne, cf. Jn 14,6) : rapport entre « mystère du
Christ » et « pensée philosophique » en théologie).
Cas de figure :
l’« hellénisme transfiguré » au sein eucharistique de
la théologie, à la suite des Cappadociens (d’Irénée de Lyon, d’Athanase
d’Alexandrie…), et le « christianisme hellénisant » entre philosophie
et théologie, à la suite de saint Augustin (de l’école
catéchétique d’Alexandrie, Clément, Origène …).
3.2.1.1. Il ne faut pas
confondre un christianisme « hellénisant » (ambigu au
point de vue de la christologie, de l’eschatologie et finalement de la sotériologie
orthodoxe de l’Église indivise) avec un christianisme carrément « hellénisé »
de type gnostique (hétérodoxe). Le fond de la question ici est la pertinence de
l’histoire (du monde) et du Royaume (de Dieu) dans l’événement du
salut (le Christ incarné, mort, ressuscité, glorifié et attendu) comme
incarnation eschatologique de la « philanthropie » de
Dieu (=l’amour et la compassion infinis du Père pour l’homme et le monde) au
sein de l’histoire.
3.2.2. Quant au mystère de
l’être incréé du Créateur (Dieu) par rapport à l’être créé des
créatures (homme et monde) et vice-versa (=mystère de l’altérité dans la
relation créé//incréé), ainsi que quant à celui de la vie incorruptible
du Royaume de Dieu par rapport à l’être corruptible de l’histoire
du monde et vice-versa (=mystère de l’altérité dans la relation temps//éternité):
approche doxologique et eucharistique du mystère en Orient, approche historique
et missionnaire en Occident.
3.2.3. Quant au mystère (unicité,
multiplicité, unité) de l’être de Dieu (en tant que « Dieu unique»)
mais aussi de l’être de l’Église (en tant qu’« Église unique
»): de la multiplicité vers l’unité -à travers l’unicité- en Orient (à
la suite des Pères cappadociens); de l’unité vers la multiplicité en Occident
(à la suite de saint Augustin).
3.3 Dieu (comme
« créateur incréé ») et le cosmos (comme
« création ex nihilo ») - une relation absolument
dialectique[22]:
3.3.1. Une ontologie
« close » (philosophique) : monisme grec païen
(penser=être, être=être dans un contexte unitaire, « cosmique »),
décalage aristotélicien entre « être » et « vie », la vie
comme avoir l’être (ontologie repliée sur le « même »,
« cosmo-logique », lors d’une approche « logo-logique »).
3.3.2. Une ontologie
« éclatée » (théologale) : transformation du sens
du « cosmos » (=création ex nihilo), du sens du
« logos » (=Parole ou Logos du Père, devenu homme tout en
restant incréé, sans séparation ni confusion), transformation
aussi du sens de l’« être » (=vie en communion) et de sa
« vérité » (être=vie=vérité=communion en liberté) ; cela veut
dire :
* quant à l’être créé (la
création créée, les créatures multiples): « être (vie)=être en
communion avec Dieu (par participation à sa vie
incorruptible) » ;
* quant à l’être incréé (le
Créateur incréé, le Dieu trinitaire): « être (vie
incorruptible) =être en communion (sans participation);
3.3.2.1 La vérité
de l’être est un événement de communion dans la liberté, la vérité est
communionelle (non substantielle), est identique à un événement libre de
communion (non à une substance nécessaire, donnée).
3.3.2.2. Le
« cosmos » comme « création ex nihilo » :
« être créé//être incréé »: la création (créée) et le Créateur
(incréé), considérés en eux-mêmes (selon leurs natures respectives, créée et
incréée), forment une dialectique absolue (ou bien/ou bien) : p.ex.
si l’on affirme que Dieu « est », il faut simultanément affirmer que
la création « n’est pas » (et vice-versa).
3.3.2.3. Cela est dû à
cause du statut ontologiquement paradoxal du Cosmos entendu non pas
comme éternel en soi-même et autoexplicatif (par participation à son
« logos cosmique»), mais comme Création « créée à partir du
néant ontologiquement absolu » (=d’un néant radical, sans aucun
rapport avec l’être). Il s’agit ici d’un abîme de non-être (et d’un
concept-limite, protologique) dans lequel le créé, dans son ensemble et
dans ses parties (monde, homme) plonge, et d’où il est constamment tiré par la
grâce eschatologique (non atemporelle, ni protologique !) de Dieu.
3.3.2.4 De ce fait
l’« être » est éclaté, il ne peut plus se référer à l’ensemble
du réel (Dieu et création) que par le biais des particularités
hypostatiques et extatiques à la fois (= « personnelles »)
lors d’un « événement de communion » diversifiée, libre
et ouverte de deux côtés ; non pas par le biais d’une « nature »
dynamique et/ou substantialisée en elle-même.
3.4.1 Paradigmes de
rationalités et de théologies - Une approche du contenu du Christianisme
dans la perspective occidentale semble postuler de manière quasi axiomatique la
nature rationnelle-scientifique de l’entreprise théologique, l’acception de la
« théologie » comme science rationnelle. Une telle perspective
-dont les éléments fondamentaux se retrouvent dès l’âge des premières
rencontres apologétiques du message évangélique avec la rationalité du
monde hellénique en Orient comme en Occident (à partir du 2e-3e
siècles)- se développe de manière paradigmatique à la « scolastique »
de l’Occident médiéval dans le contexte de l’émergence d’une nouvelle
rationalité du monde, concrétisée dans les « Sommes » du 13e siècle :
entreprise académique de rationalité « spéculative-scientifique »,
nouvelle par rapport à une rationalité « théologale[23] »
auparavant existante durant l’âge patristique (dans celle peut-être des
« écoles cathédrales » avant le « passage » de la théologie
aux universités), dont la caractéristique principale fut d’être détachée de la
vie concrète des communautés ecclésiales et partant d’être déracinée de la
« célébration eucharistique » et de la « vie en Christ »
(dans le rassemblement liturgique- eucharistique et la participation aux
« divins mystères » du Royaume à venir). En tant qu’étude analytique
et abstraite, l’entreprise « scolastique » -qui devint le
« paradigme » prépondérant à partir du Moyen-Age en théologie
occidentale -malgré la présence d’autres types de démarche théologique,
notamment « mystique »- était centrée sur l’interprétation des
propositions bibliques et patristiques en regard de Dieu et de sa relation au
monde, en les organisant en un ensemble plus ou moins autosuffisant et clos.
Or cette entreprise
« académique-spéculative » a également prévalu pour des raisons
historiques dans la production théologique de l’Orthodoxie, nous en avons fait
allusion à la 1ère partie des cours. Après la chute de l’empire
chrétien d’Orient, le monde orthodoxe ayant subi le vide culturel (sous
l’Empire ottoman) et successivement l’occidentalisation massive de la Rus, a vu
l’émergence des académies de théologie de type occidental en son sein. Ayant
subi la forte influence de la rationalité théologique de type « académique »
-et malgré la présence de la spiritualité « philocalique »- la
théologie orthodoxe a produit pendant de siècles des théologies de type
« confessionnel », des fausses formes théologiques d’une
« orthodoxie » simplement confessionnelle, déracinées de l’expérience
« ecclésiale » apostolique et patristique et partant du
« mystère » même du Christ vécu dans la Divine Liturgie[24]. Nous parlons ici
d’une véritable « captivité babylonienne de la théologie orthodoxe», qui a
duré en gros du 15e s. aux débuts du 20e s. (et au-delà
…), captivité vivement dénoncée par celui qui fût peut-être le plus grand parmi
les théologiens orthodoxes du 20e siècle, le p. G. Florovsky, le
premier qui a attiré l’attention sur l’importance de la manière patristique
de penser les réalités en théologie (« éthos patristique ») plutôt
que des formulations elles-mêmes des Pères.
3.4.2 La spécificité d’un « paradigme académique»
en théologie dans l’Occident chrétien réside à notre avis dans la
rationalité descriptive de type « scientifique-historique»
qu’il implique (dans la perspective d’une vision du monde et de son histoire tels
qu’ils sont actuellement, avant la « Parousie », la fin de
l’histoire). L’Orthodoxie de sa part plaide pour un « paradigme
eucharistique » en théologie dont la spécificité réside dans le type
de rationalité qui le soutient. Il s’agit d’une rationalité prophétique
de type « eucharistique-eschatologique » (d’une
raison humaine en voie de transfiguration eucharistique dans l’Esprit du
Royaume lors d’une approche des réalités non pas dans la simple perspective
descriptive, mais dans une perspective de la nouveauté eschatologique du
Royaume: d’une vision du monde et de l’histoire tels qu’ils seront aux
« eschata », dans la « méta-histoire »). Ce
« paradigme » l’Orient chrétien le discerne dans
l’« orthodoxie » doxologique et la « catholicité » eucharistique
de l’Église (apostolique, conciliaire et indivise), à travers son expérience eschatologique
dans la Divine Liturgie et sa vision du monde en communion avec Dieu.
Une approche des
réalités de Dieu, de l’homme et du monde (ou de l’éternité, de l’histoire et du
temps), pour se dire vraiment « orthodoxe » se doit d’être foncièrement
et d’abord une approche « liturgique ». Dans les
communautés « apostoliques » (époque fondatrice du Nouveau Testament)
comme dans celles des sept « conciles oecuméniques » (époque
patristique de l’Église indivise), le « dogme » et la
« spiritualité » étaient entendus dans le (et dévéloppés à partir du)
contexte de la célébration eucharistique des communautés, comprises en
tant qu’événement eschatologique ayant lieu dans l’histoire du
monde[25]. C’est à partir du
même contexte « liturgique-eucharistique » que les rapports avec le
monde, son histoire, sa science et sa sagesse pourraient être entamés de
manière « orthodoxe ».
Ce n’est pas un
hasard, affirme K. Ware, que le terme « orthodoxie »
(« orthè-doxa » en grec) signifie en même temps « justesse et
rectitude » aussi bien du credo (de la foi) que de l’adoration (de Dieu),
aussi bien de la « foi » (eschatologique) que de la
« glorification » (dans le Royaume) car les deux sens du terme
« ortho-doxie » sont indissociables dans la réalité même de l’action
liturgique. Le « dogme » n’est pas un système intellectuel appris
par le clergé et exposé aux laïcs, mais le contexte existentiel d’une vision
liturgique où toute chose sur terre est perçue dans sa relation aux réalités
célestes, où toute chose dans l’histoire est vécue dans sa relation à la
réalité de la résurrection du Christ et du Royaume eschatologique, présent et
attendu à la fois. Le Christianisme est une religion liturgique-eucharistique.
L’Église est d’abord une communauté célébrante. C’est la célébration qui
précède (dont le dogme, la théologie et la discipline s’en suivent).
C’est ici je pense
que se situe une difficulté majeure (existentielle et spirituelle) pour tous,
je le souligne sans exception, d’une approche « orthodoxe » de la Liturgie
dans son mystère - et par conséquent de l’Église et du Royaume
: c’est surtout dans le rapport dialectique d’une communion
existentielle qui s’instaure (dans l’Esprit du Royaume, le Saint Esprit), ici
et maintenant au sein de la Liturgie eucharistique (dans la communion pneumatique[26]),
entre l’histoire et l’eschatologie, le « déjà» et le « pas encore» de
la résurrection de l’homme et du monde.
Par ailleurs, ce modus
operandi liturgique exerce une influence directe non seulement sur la
rationalité théologique, mais également sur le développement et la
compréhension d’une vision orthodoxe du monde, lors d’une approche existentielle
(non pas abstraite) des réalités de Dieu, de l’homme et du monde vécues
littéralement de manière eucharistique. Ici le « dogme » (dont
la connotation est strictement sotériologique, non doctrinaire), enraciné
et développé à partir de la vie liturgique des communautés, de la « vie en
Christ » de chacun en communion avec les autres, concerne existentiellement
tous les fidèles (et pas simplement le clergé ou les universitaires).
C’est ici également
que nous avons tous sans exception, en Occident comme en Orient, une difficulté
supplémentaire pour envisager l’identité profonde du Christianisme orthodoxe -à
moins de le réduire ou bien à une manifestation byzantinisante et exotique du
Christianisme (en Occident), ou alors à une espèce de fondement idéologique des
peuples et des nations de l’Europe de l’Est (en Orient) : à savoir le
mystère d’une Église, d’une communion autour du Ressuscité, qu’il faudrait
d’abord vivre (pour comprendre) dans la cohérence eucharistique de sa vision
(et l’incohérence existentielle de ses fidèles). Ce sont là, je l’avoue, les
limites profondes de mon exposé d’introduction à l’Orthodoxie dont j’en suis
pleinement conscient.
Cela étant, la
question des paradigmes de rationalités et de théologies (qui soutiennent des
« visions du monde ») mérite d’être ultérieurement développée à
l’aide d’une interrogation sur la question des rapports entre Foi et Science.
3.4.3 Foi et
science: les retombées épistémologiques du dogme biblique de la création ex
nihilo et de son fondement eschatologique
Le sujet est vaste et
complexe et la question est épineuse et urgente : pour les rapports entre
l'Église et le monde dans l’histoire et en particulier dans celle de la
modernité. Je vous propose de l'effleurer en envisageant le rapport entre
« foi croyante » et « monde scientifique » à l'aide de deux
paradigmes de la vision de la « création », de l’« être
créé » en théologie: un paradigme issu de la tradition occidentale,
moderne et partant médiévale, et un autre, celui de la tradition patristique,
grecque en particulier.
Dans l'Occident
moderne, le rapport entre Foi et Science s'est souvent posé —en regard du dogme
biblique du monde comme « création » notamment— à l'aide d'une alternative
: « création ou évolution ? » Dans ce type d'interrogation, on
ne pourrait que constater une divergence foncière dans la conception de
la Foi et de la Science. C’est ce que nous appelons « une vision éclatée
du réel » en nous référant à la Modernité.
Pour la Tradition
ecclésiale et orthodoxe par contre, telle qu'on peut la considérer à travers
les écrits des Pères cappadociens notamment, une telle divergence foncière
n’aurait pas de sens. Les Pères avaient une vision convergente de la Foi
et de la Science. Et compte tenu de leur attitude face aux connaissances
scientifiques de leur époque, telle que l’on constate dans leurs écrits, notre
question portant sur la confrontation entre le dogme de la création et la
théorie de l’évolution recevrait par eux une réponse dialectique :
« création et évolution ». Pourquoi ?
Ce n’est pas parce
que les Pères vivaient justement dans une autre époque, pré-moderne, quand la
Foi et la Science convergeaient entre elles. Cela est indéniablement vrai, mais
la question porte justement sur le « pourquoi » et sur le
« comment » de cette convergence, bref sur leur « vision
du monde ».
La réponse à cette
double interrogation comprend un volet historique et culturel et un
volet théologique et spirituel. Le fait que l'opposition majeure entre
Foi et Science s'est manifestée, en pleine Modernité, à propos précisément du
dogme de la création, semble ne pas être un effet du hasard.
3.4.1. La science moderne
émerge avec la sortie du Moyen-Age occidental ; d’une époque où
l’équilibre, parfois instable, entre Foi et Connaissance (philosophique et
scientifique) était assurée par les grands scolastiques[27].
Or cet équilibre était assuré au prix de la reconnaissance, au sein de
l'Occident médiéval, d'une vérité double et hiérarchisée : la
vérité de la révélation (comme vérité supérieure) et la vérité philosophique
et scientifique (comme vérité inférieure). Il s'agissait donc d'une
synthèse hiérarchisée de manière théocratique, une synthèse effectuée par une soumission
de la Culture profane à l'Église, par une soumission —et non pas par une transfiguration—
de la Connaissance philosophique et scientifique, à la Théologie.
Avec l'avènement de
la Modernité, cette situation théocratiquement hiérarchisée se retourne contre
elle-même et la synthèse entre Foi ecclésiale et Connaissance scientifique se
brise. La Connaissance philosophique et scientifique se constitue contre la
Révélation et la Théologie. Le dogme de la foi et la connaissance scientifique
s'opposent désormais entre eux. Et la question à propos de la Bible et de la
Science, à propos du dogme de la création et de la théorie de l'évolution ne
pourrait fatalement que se poser comme alternative : « ou bien Création,
ou bien Évolution ».
Autrement dit : La
hiérarchisation théocratique de la double vérité du Moyen-Age —constitué
comme vérité supérieure (dogme) et vérité inférieure (connaissance)— se
renverse : suite à quoi le rapport des deux vérités se brise. La vérité
philosophique et scientifique, auparavant inférieure par rapport à la vérité
dogmatique, se constitue désormais contre les dogmes, prétendant parfois à une
vérité supérieure. Phénomène moderne auquel nous assistons tous. Et il ne faut
pas oublier que la dislocation initiale entre d’une part la philosophie et la
science, et d’autre part la théologie, risque de se poursuivre ultérieurement
dans une dislocation secondaire par rapport à l’originaire, celle entre
philosophie et science.
Double vérité au Moyen-Age donc,
« naturelle » et « sur-naturelle », structurée par une unique
connaissance ascendante (illuminée), du « naturel » au
« sur-naturel », et hiérarchisée comme valeur axiologique dans la
direction opposée : du « sur-naturel » au « naturel »,
du haut vers le bas pour ainsi dire. L’orientation de cette hiérarchie des
vérités s’inversant aux Temps modernes, la connaissance se retourne sur
elle-même (chez Descartes). Double vérité donc, constituée et structurée, par une
unique méthodologie, de manière hiérarchique. C’est cela le plus
significatif, et non pas le sens ni l’orientation de la hiérarchie des vérités
(du haut en bas ou du bas en haut).
3.4.2. On aurait tort à
projeter une situation semblable chez les Pères grecs, en particulier. Pour eux
ce qui était « double » ce n'était pas la vérité elle-même
(communionnelle et non ontique de toute manière) mais la méthodologie donnant
accès à la vérité. Double méthodologie de la connaissance, calquée sur
la différence irréductible et dialectique (ou bien/ou bien) entre « être
créé » et « être incréé ». Calquée sur ce que le dogme de la
création ex nihilo affirme : que le monde, existant par la seule
grâce de Dieu comme « création », n’est, radicalement, qu’en tant que
créé « à partir du néant absolu », de l’inexistence totale et
absolue. Créé et existant par pure grâce, d’une part, et à partir
de « rien ».
Le deux propositions
vont ensemble dans le dogme en question. L’une n’annule jamais l’autre. Car
pour la foi biblique, et contrairement au paganisme, entre l’être du Monde et
l’être Dieu il ne pourrait avoir aucune parenté, le néant absolu (ex
nihilo) interdisant toute « analogie d’être ». La relation donc entre
l’« être créé » (l’être de la création) et l’ « être
incréé » (l’être du Créateur) n’est ni analogique, ni hiérarchique mais dialectique,
à savoir extatique dans l’ouverture réciproque : événement de communion
libre, non nécessaire, de deux côtés pour ainsi dire. La relation, ou plus
précisément l’événement de communion libre, n’est que pure grâce ; et
c’est elle, la relation d’ouverture réciproque mais asymétrique, dans le Christ
-qui assume pleinement la vocation authentique, eschatologique d’Adam, la
prêtrise ontologique de l’homme pour la vie du monde- entre Créateur et
création, celle qui constitue son « être » précisément en tant que
créé (l’existence en tant que don reçu et partagé).
Il s’agit bien de la
grâce de l’incréé dont nous parlons ici, c’est-à-dire de la grâce de Dieu qui
ne peut qu’être librement reçue par la création créée, dans une ouverture,
libre et constante (en Adam/en Christ) à Celui qui se trouve de l’autre côté du
néant qui la sépare, du néant absolu d’où elle est constamment tirée, par son
ouverture au Dieu incréé.
Et du coup toute
tentation de chosification de la grâce incréée de Dieu est interdite. L’univers
est considéré comme « création» créée par Dieu, son Créateur,
Lui-même incréé. L’être créé (de la création) et l’être incréé (du
Créateur), pris en eux-mêmes -c'est-à-dire en dehors de la prêtrise de
l’homme en Christ- ne peuvent que costituer, l’un par rapport à l’autre, une
dialectique absolue : ou bien créé/ou bien incréé. Et la relation entre
l’être créé de la création et l’être incréé du Créateur ne peut qu’être une
relation dialectique au sens absolu : une relation entre création et
Créateur en l'homme parfait -le Christ- « sans séparation, ni confusion »[28].
Dans l’optique d’une
dialectique absolue, la question de la vérité ne pouvait qu’être
approchée selon une double théorie de connaissance qui structurait la
Foi et la Pensée de manière absolument dialectique dans leur
vérité respective : non pas de manière hiérarchique ou oppositionnelle
mais de manière dialectique et asymétrique ; comme quoi
entre Pensée (philosophique et/ou scientifique) et Foi (eschatologique) ne
pourrait jamais avoir de concurrence ou d’opposition, ni de synthèse non plus,
mais d’articulation ouverte à l’eschaton dans l’Esprit du Christ. Dialectique
asymétrique donc car la « connaissance » est « précédée » –eschatologiquement
mais non pas historiquement- par la « foi », la « foi »
n’étant ni supérieure ni inférieure par rapport à la « connaissance »
(et vice-versa) mais eschatologiquement fondatrice. La « foi »
(eschatologique) précède la « connaissance » (scientifique et
descriptive) ; mais elle la « précède » selon l'Esprit du
Christ, selon l’Esprit du Royaume, non pas selon l’histoire, étant incomparablement
« autre » par rapport à toute connaissance issue de l'observation
du monde tel qu’il est. Double théorie de la connaissance donc, double
méthodologie de « vérité » qui relie de manière asymétrique et
dialectique la Foi « selon le Christ d’après son Royaume» et
la Science « à partir du monde tel qu’il est actuellement».
Après la révolution
copernicienne et son importance historique et symbolique qui signe la sortie
définitive du Moyen-Age, les découvertes suivies du procès de Galilée au 17e siècle marquent
l’émancipation de la Science par rapport à une toute-puissance cléricale et la
réponse de celle-ci à l’outrage d’une désobéissance et le début de la Modernité
« spirituelle », de la Modernité proprement dite. Et si Galilée
réhabilite la valeur et la consistance du Monde, du « naturel »,
considéré auparavant comme inférieur par rapport à un « sur-naturel »
attribué à tort ou à raison à « Dieu », la date la plus importante et
significative pour les rapports problématiques (de deux côtés) entre Foi et
Science, la date où le conflit entre « naturel » et
« sur-naturel » devient encore plus intense, est celle par la Théorie
darwinienne au 19e siècle. Darwin
poursuit à sa manière la « revanche galiléenne » : la
réhabilitation d’un monde considéré inférieur par rapport à Dieu, la
justification de la « nature » du monde considérée impure et
inférieure dans une vision « surnaturaliste » de la grâce du
Créateur.
C'est cette double
théorie de la connaissance articulant dialectiquement la Foi et la Pensée qui
permettrait aujourd'hui aux Pères, me semble-t-il, de répondre à notre question
de manière dialectique et asymétrique, « sans séparation ni
confusion »: « et Création et Évolution ». Et cela permettrait
peut-être aussi à la Science de se constituer comme Science « du monde tel
qu’il est actuellement » (avec la Foi au monde de la nouveauté
eschatologique qui est là et qui vient) ; non pas comme Science
« selon le monde » (et contre la Foi). Et à la Sagesse humaine tout
court, de garder et de poursuivre sa vérité à elle (vérité créée) dans l'ouverture,
éventuellement, à Esprit du Royaume.
3.5 Les temps de la
méthode d’une « scolastique » tardive semblent être révolus, en
Occident comme en Orient chrétiens, mais le paradigme d’une rationalité scientifiquement
fondée et orientée en théologie, modelé sur la connaissance philosophique
avec l’apport ultérieur des sciences humaines, semble rester
profondément ancré dans la conscience théologique de l’Occident[29],
malgré la présence d’expressions monastiques et mystiques, malgré aussi les
réactions évangéliques en faveur d’une approche dialectique entre raison et
révélation dans la richesse incroyablement diversifiée de la théologie
occidentale en son ensemble.
Cependant, la requête
d’une rationalité véritablement « théologale », appropriée à la
démarche spécifiquement « ecclésiale » (non simplement
« inter-confessionnelle ») de la théologie, devient une affaire
urgente pour tous sans exception : à cause du scandale de la désunion
entre chrétiens, face à l’interpellation des autres religions et dans un monde
qui devient de plus en plus globalisé. La réconciliation entre la catholicité
romaine et la catholicité orthodoxe, la recomposition évangélique de l’unité
des Églises autour du Ressuscité dans l’histoire ne pourraient pas être
réalisées sans une convergence de part et d’autre vers le sens profond de
l’« orthodoxie » et de la « catholicité » à partir du
mystère même du Royaume dans l’eucharistie ecclésiale qui révèle le mystère
même de Dieu en Christ dans l’Esprit.
* Dans une
bibliographie déjà sélective, les travaux les plus significatifs pour notre
cours ont été signalés avec un astérisque.
[1] En me référant à la
relation de l’ « Église » (unique-et-multiple dans la communion) à
« Dieu » (unique-et-multiple dans la communion) en termes d’
« image », je ne suggère pas que « Dieu » soit un simple
modèle (esthétique ou éthique) pour l’ « Église ». Bien au
contraire « Dieu », précisément comme trinitaire
(=unique-et-multiple dans la communion des « hypostases
personnelles »), constitue le fondement ontologique, mieux
onto-eschatologique de l’Église, précisément en tant qu’Église d’Églises
(=unique-et-multiple dans la communion des « communautés eucharistiques »).
Or, ce fondement onto-eschatologique implique l’écart entre « image »
(eikôn) et « ressemblance » (homoiôsis) de l’ « Église »
dans l’histoire, par rapport à son prototype eschatologique
(« Dieu en son Royaume trinitaire »). C’est pour signaler cet écart
de l’actualité (image) par rapport à la vocation (ressemblance)
–être créé « à l’image » de quelqu’un afin de devenir parfaitement
« ressemblant » à lui– que j’utilise l’expression
« virtuellement ».
[2] Pour approfondir
cette thématique de l’unicité et de la multiplicité dans et par l’événement de
communion vous pouvez consulter Jean Zizioulas,
“Communion et altérité”, dans Service Orthodoxe de Presse n° 184
(janvier 1994), p. 23-33 (en anglais, sur internet, au site de Douglas Knight, Resources for Christian
Theology: http://www.resourcesforchristiantheology.org/mambo/content/blogcategory/16/42/),
ou encore, du même auteur, L’être ecclésial, coll. « Perspective
orthodoxe n° 3 », Labor et Fides, Genève, 1981, p. 11-22.
[3] L’un des éléments principaux qui caractérisent l’ « esprit du confessionnalisme » est une acception de la « foi » essentiellement comme processus intellectuel. Illuminé, l’esprit de l’homme deviendrait capable de formuler la vérité de la révélation en des formules propositionnelles. La « vérité » devient, par conséquent, essentiellement une affaire de propositions et notre acceptation de ces propositions équivaut alors à un acquiescement à la « foi ». Dans cette optique la « tradition » est entendue comme une suite de propositions théologiques et de credos —transmis de génération en génération, depuis les Apôtres jusqu’à aujourd’hui— propositions auxquelles il est nécessaire d’acquiescer sous la forme d’une “souscription”. La « théologie » acquiert son sens au titre de ces propositions, ou devient elle-même la promotrice de semblables propositions au terme d’un travail “systématique”. De son côté, dans l’esprit du confessionnalisme, l’ « Eglise » elle-même « acquiert son identité sur la base de ces propositions notionnelles telles qu’elles sont formulées à travers la théologie sous la garantie des auctoritates (et non plus sur la base de son expérience eucharistique lors de la « célébration liturgique » et de la « vie en Christ »). Ceci comporte comme résultat que la chrétienté consiste désormais en des corps confessionnels, identifiés à l’aide des quelques Credos, écrits ou non écrits, explicites ou implicites, auxquels les membres de ce corps adhèrent comme à une condition de foi.
[3] L’un des éléments principaux qui caractérisent l’ « esprit du confessionnalisme » est une acception de la « foi » essentiellement comme processus intellectuel. Illuminé, l’esprit de l’homme deviendrait capable de formuler la vérité de la révélation en des formules propositionnelles. La « vérité » devient, par conséquent, essentiellement une affaire de propositions et notre acceptation de ces propositions équivaut alors à un acquiescement à la « foi ». Dans cette optique la « tradition » est entendue comme une suite de propositions théologiques et de credos —transmis de génération en génération, depuis les Apôtres jusqu’à aujourd’hui— propositions auxquelles il est nécessaire d’acquiescer sous la forme d’une “souscription”. La « théologie » acquiert son sens au titre de ces propositions, ou devient elle-même la promotrice de semblables propositions au terme d’un travail “systématique”. De son côté, dans l’esprit du confessionnalisme, l’ « Eglise » elle-même « acquiert son identité sur la base de ces propositions notionnelles telles qu’elles sont formulées à travers la théologie sous la garantie des auctoritates (et non plus sur la base de son expérience eucharistique lors de la « célébration liturgique » et de la « vie en Christ »). Ceci comporte comme résultat que la chrétienté consiste désormais en des corps confessionnels, identifiés à l’aide des quelques Credos, écrits ou non écrits, explicites ou implicites, auxquels les membres de ce corps adhèrent comme à une condition de foi.
[4] Avec la prise de
Constantinople au 15e siècle, la théologie orthodoxe entre dans une longue
période durant laquelle la productivité créatrice fait place au conservatisme.
Elle perd sa créativité et son élan patristiques en devenant “un objet
archéologique précieux” conservé par le monachisme. En même temps, les contacts
des théologiens orthodoxes avec l’évolution de la théologie en Occident créent
une situation nouvelle. La méthodologie scolastique s’installe
profondément au sein de l’Orthodoxie. Cette problématique étant admise
sans discussion, les réponses des orthodoxes sont présentées dans le cadre
délimité par elle et par sa méthodologie. A la suite de la crise de la Réforme
protestante au 16e siècle, la théologie étant en Occident bloquée au sein de
l’opposition confessionnelle entre le catholicisme et le protestantisme,
l’Orthodoxie s’est trouvée obligée d’y prendre part, et donc de se situer pour
ainsi dire dans un cadre confessionnel. Les multiples “confessions orthodoxes”
(Pierre Moghila, Dosithée de Jésusalem, Cyrille Loukaris, etc.) donnèrent lieu
à un “confessionnalisme” qui a marqué l’Orthodoxie pour plusieurs
siècles ... Parallèlement à la méthodologie scolastique et au
“confessionnalisme” au sein de l’Orthodoxie, émerge l’idée d’une “théologie
académique”. Dans une telle perspective, la théologie devient une discipline
académique qui considère l’Université comme son “lieu” propre. On adopte en
conséquence une répartition de la théologie considérée comme “science”, en
théologie dogmatique, théologie exégétique, théologie historique,
théologie morale, même chez les orthodoxes, mais selon les modèles
occidentaux.
[5] Puisque je ne
m’inscrit pas dans une approche ontologique substantialiste (atemporelle ou
protologique) mais dans une approche événementielle et eschatologique,
tout au long de mon texte je postule une sorte de « différence
ontologique » entre d’une part l’ « Église » (de Dieu) et les
confessions (chrétiennes) et d’autre part le « Royaume »
(eschatologique) de Dieu et les cultures (historiques) de l’humanité. Du point
de vue orthodoxe, telle différence ontologique –qui se fonde à partir de
l’expérience eucharistique du Royaume dans la communion « aux saints
mystères » (cf. infra 2e partie)– dit l’irréductibilité
absolue de l’« eschatologique » au culturel (et à l’historique)
tout comme de l’« ecclésial » (et de l’eucharistique) au
confessionnel (et au cultuel). Elle ne va pas sans rappeler, sous certains
égards, le fonctionnement (mais non pas le fondement …) de la
différence ontologique entre l’« être » et les étants d’après la
célèbre distinction heideggerienne. Pour l’approfondissement du contexte
ontologique de ces cours qui envisagent l’« être » des étants non pas
sous l’angle des natures et de substances (atemporelles ou
protologiques, autoexistentes ab aeterno ou données au départ,
possédant en puissance des qualités inhérentes…), mais sous celui de l’événement
de communion, personnelle et eschatologique, cf. John Zizioulas (metropolitan of Pergamon), Towards
an Eschatological Ontology: A Paper given by Professor John D. Zizioulas at
King's College, London, 1999 (sur internet, au site de Douglas Knight, Resources for Christian
Theology).
[6] De ce fait, les
orthodoxes d’aujourd’hui, pas moins certes que les autres confessions
historiques qui forment le Christianisme, nous devons constamment nous mesurer
à la lumière de la grande Tradition de l’Église indivise (=Tradition
ecclésiale), dans le dialogue et l’ouverture aux autres Églises chrétiennes, et
face au Royaume qui advient constamment parmi nous.
[7] Je n’aborderai pas,
au moins pour le moment, la question, fondamentale à plus d’un titre, de la
compatibilité entre ces deux « modes » (tropoi) de
« catholicité » (hypostatique-personnelle) –ecclésiale et
trinitaire– de son degré de compatibilité et de ses presupposes.
[8] Cf. J. Zizioulas, "Le Mystère de
l'Église dans le tradition orthodoxe", dans Irénikon t. 60/3
(1987/3), p. 323.
[10] Du point de vue de l’expérience orthodoxe, la
dialectique du « déjà-et-pas encore » dans l’histoire se dit sous
l’angle de l’eschaton, non pas sous celui de l’histoire comme
telle: il s’agit du « déjà-et-pas encore » de la résurrection
(=réalité eschatologique par excellence), le « déjà » se référant au
Christ lui-même (Dernier Adam), déjà ressuscité, et le « pas
encore » à nous autres, au reste de l’humanité et de la création entière unis
au Christ, pas encore ressuscités. Dans l’Esprit Saint, le
Ressuscité (=Christ) et son Corps (=Église) sont indissolublement liés à l’aide
de cette dialectique eschatologique, de la dialectique de la résurrection
qui ouvre constamment le corps ecclésial du Christ (en attente de
la résurrection) à la vie de sa tête, au Christ (ressuscité dans son corps
glorieux) « assis à la droite du Père » (dans le Royaume). Ainsi
par l’Église, en Eucharistie (dans le corps eucharistique du Christ),
l’histoire (le temps) du monde est dialectiquement (=déjà-et-pas encore) inclue
dans le Royaume (l’éternité) de Dieu
[11] Cf. Jean Zizioulas, “Christologie et existence:
La dialectique créé-incréé et le dogme de Chalcédoine”, dans Contacts,
t. 36 (1984), p. 154-172 ; “Christologie et existence: Le problème de la
relation entre « hellénisme » et « christianisme» et le problème
de la mort”, dans Contacts, t. 37 (1985), p. 56-72 ;
« Vérité et communion », dans L’Etre ecclésial,
spécialement p. 90 ss.
[14] Affirmant cela je ne
suggère pas qu’ils existent des réalités créées se trouvant de fait
« en dehors » du Ressuscité ; cela c’est le Christ qui le sait
et ne nous le révélera qu’au « dernier jour » (=Jugement dernier). Je
souligne tout simplement que pour l’Église (orthodoxe), la possibilité de se
trouver « en dehors » du Christ ressuscité équivaudrait, pour toute
réalité créée (et de plus déchue en Adam), à un retour à sa corruptibilité
naturelle (rendue définitive dans l’état de chute). Dans ce cas, la corruption
et la mort seraient une fatalité ontologique (être=être pour la mort).
[15] Cf. Jean Zizioulas, “Le mystère de l’Église dans
la tradition orthodoxe”, dans Irénikon, t. 60 (1987),
p. 323-335 et sur internet : http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/theologie/mystere.htm.
[16] L’asymétrie de la
christologie orthodoxe selon les 5e et 6e Conciles
œcuméniques (« communion en Christ » du Dieu incréé et de
l’humanité créée dans la personne incréée du Fils incarné, par la
personne incréée de l’Esprit du Père) ne pourrait que se répercuter sur
l’asymétrie de la mystériologie, la théologie sacramentaire orthodoxe
(« communion en Église » du Royaume eschatologique et de
l’humanité historique dans la personne eschatologique du Christ
ressuscité, par la personne incréée de l’Esprit du Royaume).
[17] Pour la rationalité
théologale de l’Orthodoxie, comme nous le verrons dans la 3e partie
de l’introduction à l’Orthodoxie, l’affirmation catégorique de la
présence réelle du Christ parmi nous lors de la Liturgie et la communion
eucharistiques, ne pourrait pas s’exprimer dans un contexte ontique ni en
termes substantialistes (transubstantiation), mais dans le contexte liturgique
et ontologique qui lui est propre : celui de l’ « être » comme
« communion » (et par la communion) au Christ ressuscité et attendu
dans la plénitude eschatologique de son Corps (totus Christus, caput
et corpus d’après l’expression célèbre de saint Augustin). Pour la
thématique de la « catholicité » au niveau ecclésiologique
(=catholicité eucharistique) cf. en particulier J. Zizioulas, « Communauté eucharistique et catholicité de
l’Église », dans son L’être ecclésial, p. 111-135.
[18]Cf. Daniel
B. Clendenin (éd), introduction
dans Easter Orthodox Theology: A Contemporary Reader, Baker, Grands
Rapids, 1994, pp. 7-8.
[19] Pour la thématique
du conditionnement eschatologique (« pneumatique ») de l’histoire
dans le cas de la succession des communautés cf. J. Zizioulas, « La continuité avec les origines
apostoliques dans la conscience théologique des Églises orthodoxes », dans
son L’être ecclésial, p. 136-170.
[20] Non pas « selon
la nature seule » en amont de la « communion avec Dieu »
(grâce), ni « selon la nature telle qu’elle est actuellement »
(ontologie descriptive) mais « telle qu’elle sera » dans la
manifestation plénière de la grâce de communion lors de la résurrection de
tous, à la fin de l’histoire (ontologie eschatologique).
[21] Ce sujet étant
extrêmement vaste et complexe, nous ne pouvons ici que l’effleurer, en revoyant
à l’étude, fondamentale à plus d’un titre, de Jean Zizioulas, « Vérité et communion », dans L’être
ecclésial, p. 57-110.
[22] Pour cette
thématique complexe cf. Jean Zizioulas,
“Preserving God’s Creation: Three Lectures on Theology and Ecology”, dans King’s
Theological Review, n° 1 (1989), p. 1-5; n° 2 (1989), p. 41-45;
n° 1 (1990), p. 1-5. (cf. sur internet
dans le site de Douglas Knight, Resources
for Christian Theology), ainsi que son “Christologie et existence: La
dialectique créé-incréé et le dogme de Chalcédoine”, dans Contacts, t.
36 (1984), p. 154-172.
[23] Le terme rationalité
« théologale » renvoie à une manière précise d’être et de
penser : celui d’une rationalité authentiquement humaine en
communion avec Dieu et autrui – d’une rationalité christique
(divino-humaine) et prophétique (eschatologique)- qui se reçoit perpétuellement
à partir du « don » de la foi (au Ressuscité), dans l’espérance (au
Royaume) et la charité (envers tous) lors d’un processus de transfiguration
progressive (dans le « don » de la foi, de l’espérance et la
charité). Comme « théologale », ce type de rationalité, qui se reçoit
à partir de l’expérience du « don » de Dieu, reste irréductible à
tout type de rationalité « scientifique » (philosophique,
historique, technicienne …) qui se reçoit à partir de l’expérience « du
monde en lui-même », c’est-à-dire en amont et indépendament
de sa communion avec Dieu (dans l’homme transfiguré, tant bien que mal), aussi
bien en théologie comme en dehors de la théologie.
[24] La théologie
orthodoxe soutient l’irréductibilité de l’ « ecclésial » au
« confessionnel ». Dans son mystère l’Église « une, sainte,
catholique apostolique » (Una Sancta) ne pourrait pas être réduite
à des « confessions chrétiennes». De son côté, l’Orthodoxie
s’identifie à l’Église « une, sainte, catholique apostolique » mais
de manière « apophatique » : elle sait où l’Una Sancta se
trouve dans l’histoire (dans l’Orthodoxie) mais elle ignore où elle ne se
trouve pas.
[25] De manière
existentielle et sotériologique, non pas doctrinaire et dogmatique. Le but
principal de ces Conciles était le rétablissement d’une communion ecclésiale
brisée (ou en danger) et, par conséquant, la précision des conditions, des
limites (orion, oros=dogme) de ce rétablissement (contexte ecclésiologique ad
intra et non kérygmatique ad extra).
[26] Cf. exclamation
après la communion au Corps et au Sang du Christ: nous avons vu la
« vraie lumière », nous avons reçu le « Esprit
céleste », nous avons trouvé la « vraie foi » en adorant la
Trinité indivisible (de Dieu) qui nous a sauvés.
[27] Cependant, compte
tenu de nos remarques précédentes (cf. supra 2.1.0) on peut se demander
sur le contenu (et le sens) des réalités du « salut » (sens
eucharistique ou autre ?) et de la « foi » (sens eschatologique
ou autre ?) et, partant, de la « vérité » (sens communionnel ou
autre ?) et du « dogme » (sens existentiel ou autre ?) chez
les scolastiques. Cela revient à reposer autrement le même
problème…
[28] Je
reprends ici les termes du dogme du Concile de Chalcédoine traitant précisément
de cette relation entre être de la création et être du Créateur, parfaitement
réalisée en Christ (Dieu devenu homme) dans la liberté, l’ouverture
eschatologique du Saint-Esprit.
[29] Cf . David
K. Naugle, Worldview: The
History of a Concept, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.
2002, p. 44-45.